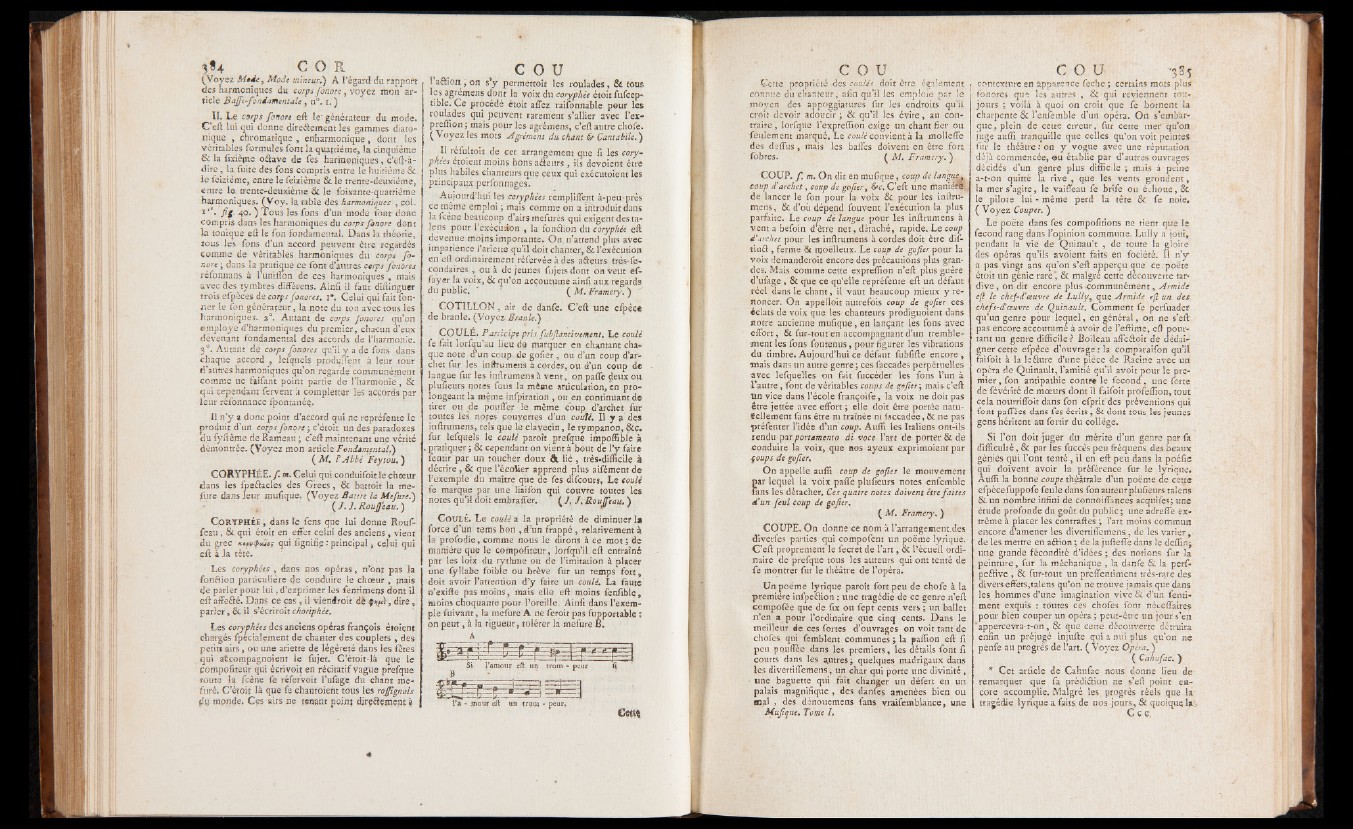
«f* C O R
(Voyez Mode, Mode mineur.) A l’égard du rapport
des harmoniques du corps fonore, voyez mon article
B affi fondamentale , n°. I, )
II. Le fonort eft le' générateur du mode.
C ’eft lui qui donne dire&ement les gammes diatonique
, chromatique , enharmonique, dont les
véritables formules fonç la quatrième, la cinquième
Si la fixièpie oâave de fes harmoniques , c’eft-à-
dire, la fuite des fons compris entre lë huitième &.
le fe i zièrae, entre le feizième 8c le trente-deuxième,
entre la. trenterdeuxième 8c le foixante-quatrième
harmoniques. (V o y . la table des harmoniques , col.
49. ) Xous les fons d’un mode font donc
compris dans les harmoniques du corps fonore dont
la tonique eft le fon fondamental. Dans la théorie,
tous les fons d’un accord peuvent être regardés
comme de véritables harmoniques dii corps fo -
nore • dans la pratique ce font d’autres" corps fonôres
réfonnans à 1 uniffon de ces harmoniques , mais
avec des tymbres difterens. Ainfi il faut distinguer
trois efpèces de corps fanons. 1®, Celui qui fait fon*
per le Ion générateur, la pote du ton avec tous les
harmoniques. a°. Autant de corps fonores qu’on
employé d’harmoniques du premier, chacun d’eux
devenant fondamental des accords de l’harmonie.
30. Autant de corps fonores qu’il y a de fons dans
chaque accprd , lefquels prpduffent à leur tour
d’autres harmoniques qu’on regarde communément
comme ne faifant point partie de l’harmonie , &
qui cependant fervent a completter les accords par
leur réfonnance fpontanée.
Il n’y a donc point d’accord qui ne repréfente le
produit d’un corps fonore ; c’étoit un des paradoxes
du fyftêjne de Rameau ; c’eft maintenant une vérité
démontrée. (Voyez mon article Fondamental.)
( M. F Abbé Feytou. )
CORYPHÉE, f . m. Celui qui conduifoitle choeur
dans les fpeélacles des G recs , & battoit la mesure
dans leur mufique. (Voyez Battre la Mefure?)
( J. J, Roujfeau. )
CpRTPHÉE, dans m fens que lui donpe Rouf-
feau , 8c qui étoit en effet celui des anciens , vient
du grec Kifvÿeuts qui lignifie : principal, celui qui
eft à Ja tête.
Les coryphées , dans nos opéras, n?ont pas la
fonction particulière de conduire le choeur , mais
de parler pour lu i, d’exprimer les fentimens dont il
eft affe&é. Dans ce c a s , il viendrait de iffîffè, dire,
parler, 8c il s-’écriroit choriphée.
Les coryphées des anciens opéras françois étoient
chargés fpécialement de chanter des couplets , des
petits airs, ou une ariette de légèreté dans les fêtes
. qui aCcompagnoient le fujèt. C ’étoit-là que le
compofiteur qui écrivoit en récitatif vague prefque
toute la fcèiie fe réfervoit l’ufage du chant mè-
furé. C ’étoit là que fe chantoieht tous les rojfignols
§4 mpitde. Ces airs ne tenant point dirçélçinçpt à j
c 0 u 1 aérion j on s’y permettoit les roulades, 8fi tous
les agremens dont la voix du coryphée étoit fufcep-
tible. Ce procédé étoit affez raifonnable pour les
roulades qui peuvent rarement s’allier avec l’ex-
preftion; mais pour les agrémens, c’eft autre chofe.
(V o y e z les mots Agrément du. chant & Cantabïle.)
Il réfultoit de cet arrangement que fi les coryphées
étoient moins bons aâeurs , ils dévoient être
plus habiles chanteurs que ceux qui exécutoient les
principaux perfpnnages.
Aujourd’hui les coryphées rempliftent à-peu-près
ce même empleri ; mais comme on a Introduit dans
la fcène beaucoup d’airs rnefurés qui exigent des ta-
}ens pour l’exéciison , la fonéfion du coryphée eft
devenue moins importante. On. n’attend plus avec
impatience l’ariette qu’il doit chanter, 8c l’exécution
en eft ordinairement réfervée à des aftçurs très-fe-
condaires , ou à de jeunes fujets dont on veut ef-
fayer la voix, 8c qu’on accoutume ainfi aux regards
du public. “ f ( M. Framery. ) «
C O T IL L O N , air de danfe. C ’eft une efpçc«
de branle. (Voyez Branle.)
COULÉ» Participe pris fubjlantivemeni. Le coulé
fe fait lorfqu’au lieu de marquer en chantant chaque
note d’un coup de gofier , ou d’un coup d’archet
fur les inftrumens à cordes, ou d’pn coup de
langue fur les inftrumens à vent, on pafte deux ou
plufièurs notes fous la même articulation, en prolongeant
la mçme infpiration, ou en continuant de
tirer ou de pouffer le même coup, d’archet fur
tontes les nppes couvertes d’un coi/ti. Il y ? des
inftrumens, tels que le clavecin, le tympanon, 8cç#
fur lefquels le coulé paraît prefque impoffible à
pratiquer ; 8c cependant on vient à bout de IV faire
fentir par un toucher doux 8t l i é , très-difficile à
décrire, 8c que l’écolier apprend plus aifément de
l’exemple du maître que de fes difeours. Le coulé
fe marque par une liaifon qui couvre toutes les
notes qu’il doit embraffer. ( J, ƒ .Roujfeau» )
Coulé. Le coulé a la propriété de diminuer I9
force d’un tems bon , d'un frappé, relativement à
la profodie, comme nous le dirons à ce mot ; de
manière que le compofiteur, lorfqifil eft entraîné
par les loix du rythme où de l’imitation à placer
une fyllabe foible ou brève fur un temps fort,
doit avoir l’attention d’y faire un coulé. La faute
n’exifte pas moins, mais elle eft moins fenfiblç,
moins choquante pour Poreille. Àinfi dans l ’exemple
fuivant, la mefure A ne ferait pas fupportable î
pn peut, à la rigueur, tolérer la mefure B.
A
Ta r rnouï eft un trot» - peur,
Cçttts
«
c o u
•Çette propriété des coulés doit être également
connue du chanteur, afin qu’il les emploie par le
moyen des âppoggiatures fur les endroits qu’il
croit devoir adoucir ; 8c qu’il les évite, au contraire
, lorfque l’expreffion exige un chant fier ou
feulement marqué. Le coulé convient à la molleffe
des deffus, mais les baffes doivent en être fort
fobres, ( M, Framery. )
COUP. f . m. On dit en mufique, coup de langutu
coup d'archet, coup de gofier, &c. C ’eft une manière
de lancer le fon pour la voix 8c pour les inftrumens
, 8c d’où dépend fouvent l’exécution la plus
parfaite. Le coup de langue pour les inftrumens à
vent a befoin d’être net, détaché, rapide. Le coup
d'archet pour les inftrumens à cordes doit être dif-
tinéi , ferme & moelleux. Le coup de gofier pour la
voix demanderait encore des précautions plus grandes.
Mais comme cette expreffion n’eft plus guère
d’ufage , 8c que ce qu’elle repréfente eft un défaut
réel dans le chant, il vaut beaucoup mieux y renoncer.
On appelloit autrefois coup de gofier ces
éclats de voix que les chanteurs prodiguoient dans
notre ancienne mufique, en lançant les fons avec
effort, 8c fur-tout en accompagnant d’un tremblement
les fons foutenus, pour figurer les vibrations
du timbre. Aujourd’hui ce défaut fubfifte encore ,
mais dans un autre genre; ces faccades perpétuelles
avec lefquelles on fait fuccéder les fons l’un à
l ’autre, font de véritables coups de gofier ; mais c’eft
Un vice dans l’école françoife, la voix ne doit pas
être jettée avec effort ; elle doit être portée naturellement
fans être ni traînée ni faccadée, 8c ne pas
préfenter l’idée d’un coup. Auffi les Italiens ont-ils
rendu par portamento di voce l’art de porter 8c de
conduire la voix, que nos ayeux exprimoient par
poups de gofier.
On appelle auffi coup de gofier le mouvement
par lequel la voix paffe plufièurs notes enfemble
lans les détacher. Ces quatre notes doivent être faites
d'un feul coup de gofier.
( M, Framery, )
COUPE. On donne ce nom à l ’arrangement.des
diverfes parties qui compofent un poème lyrique.
C ’eft proprement le fecret de l ’art, 8c l’écueil ordinaire
de prefque tous les auteurs qui ont tenté de
fe montrer fur le théâtre de l’opéra.
Un poème lyrique paraît fort peu de chofe à la
première infpeélion : une tragédie de ce genre n’eft
compofée que de fix ou fept cents vers ; un ballet
n’en a pour l’ordinaire que cinq cents. Dans le
meilleur de ces fortes d’ouvrages on voit tant de
chofes qui femblent communes ; la paffion eft fi
peu po.uffée dans les premiers, les détails font fi
courts dans les autres; quelques madrigaux dans
les divertiffemens, un char qui porte une divinité,
• une baguette qui fait changer un défert en un
palais magnifique , des danfes amenées bien ou
« a l , des dénouemens fans vraifemblauce, une
Mufique. Tome U
C O U -3S5
contexture en apparence feche ; certains mots plus
fonores que les autres , 8c qui reviennent tou-.
jours ; voilà à quoi on croit que fe bornent la
charpente 8c l’enlemble d’un opéra. On s’embarque
, plein de cette erreur, fur cette mer qu’on
juge auffi tranquille que celles qu’on voit peintes
fur le théâtre : on y vogue avec une réputation
déjà commencée, ou établie par d’autres ouvrages
décidés d’un genre plus difficile ; mais à peine
a-t-on quitté la rive , que les vents grondent,
la mer s’agite, le vaiffeau fe bri’fe ou échoue, 8c
le pilote lui - même perd là tête 8c fe noie,
( Voyez Couper. )
Le poète dans fes compolirions ne tient que le,
fécond rang dans l’opinion commune. Luliy a joui,
pendant la vie de Quinau’t , de toute la gloire
des opéras qu’ils avoient faits en fociété. 11 n’y
a pas vingt ans qu’on s’eft apperçu que ce. poète
étoit un génie rare’, 8c malgré cette decouverte tardive
, on dit encore plus «communément, Armide
eft le chef-d'oeuvre de Luliy, que Armide efl un des
chefs-d?oeuvre de Quinault. Comment fe perfuader
qu’un genre pour lequel, en général, on ne s’efl:
pas encore accoutumé à avoir de l’eftime, eft pourtant
un genre difficile ? Boileau affe&oit de dédaigner
cette efpèce d’ouvrage : la comparaifon qu’il
faifoit à la leélure d’une pièce de R.acine avec un
opéra de Quinault, l’amitié qu’il avoit pour le premier
, fon antipathie contf* le fécond , une forte
dè févérité de moeurs dont il faifoit profeffion, tout
cela nourriffoit dans fon efprit des préventions qui
font paffées dans fes écrits, 8c dont tous les jeunes
gens héritent au fortir du collège.
Si l’on doit juger du mérite d’un genre par fa
difficulté, 8c par les fuccès peu fréquens des beaux
génies qui l’ont tenté , il en eft peu dans la poéfie
qui doivent avoir la préférence fur le lyrique#
Auffi la bonne coupe théâtrale d’un poème de cetj:e
efpècefuppofe feule dans fon auteur plufièurs talens
8c un nombre infini de connoiffances acquifes; une
étude profonde du goût du public ; une adreffe extrême
à placer les contraftes ; l’art moins commun
encore d’amener les divertiffemens, de les varier,
de les mettre en aftion ; de la jufteffe dans le deffinj
une grande fécondité d’idées ; des notions fur la
peinture, fur la méchanique , la danfe 8c la perf-
peérive , 8c fur-tout un preffentiment très-r?,re des
divers effets,talens qu’on ne trouve jamais que dans
les hommes d’une imagination vive & d’un fenti-
ment exquis : toutes ces chofes font néceffaires
pour bien couper un opéra ; peut-être un jour s’en
‘appercevra-t-on, 8c que cette découverte détruira
enfin un préjugé injufte qui a nui plus qu’on ne
penfe au progrès de l’art. ( Voyez Opéra. )
( Cahufac. y
* Cet article de Cahufac nous donne lieu de
remarquer que fa prédiérion ne s’eft point encore
accomplie. Malgré les progrès réels que la
tragédie lyrique a faits, de nos jours, 8c quoique la,-
Ç ç ç.