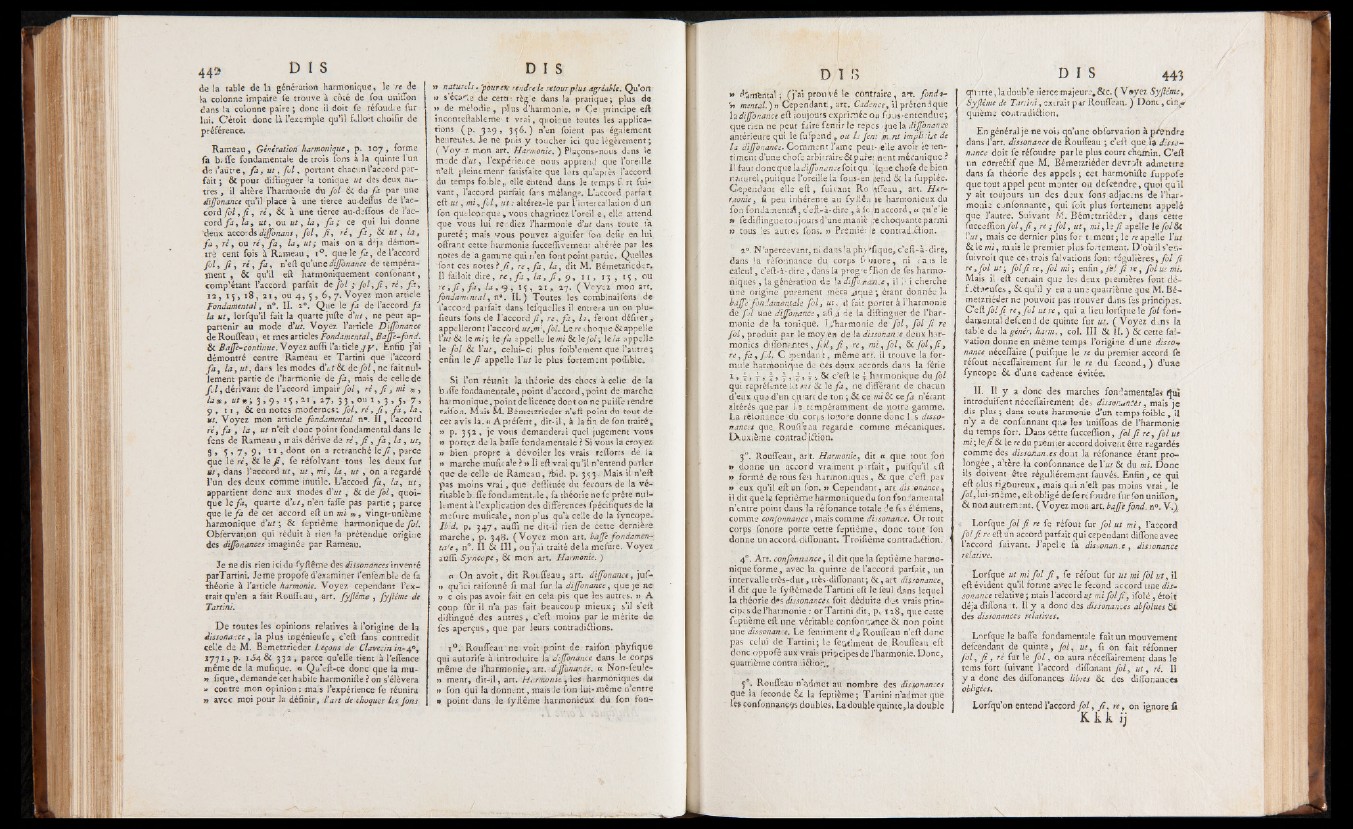
de la table de là génération harmonique, le re de
la colonne impure te trouve à côté de ton uniiTon
dans la colonne paire ; donc il doit fe réfoudre fur
lui. C ’étoit donc U l’exemple qu’il friloit choifir de
préférence.
Rameau, Génération harmonique, p. 10 7 , forme
fa brffe fondamentale de trois fons à la quinte l’un
de i’a ù r e , fa , ut, f o l , portant chacun Raccord parfait
; & pour diftinguer la tonique ut des deux autres
, il altère l’harmonie du fol & du fa par une
diffonanee qu’il place à une tierce au-deflus de l’accord
f o l , f i , ré, St à une tierce au-deffous de l’accord
fa , la, ut, ou ut, la , f a ; ce qui lui donne
■ deux accordsàiffonans, fo l, f i , ré, fa , & u t, la,
fa , ré, ou ré, fa , la, ut; mais on a déjà démontré
cent fois à Rameau, i ° . que le fa , de l’accord
fo l, f i , ré, fa , n’eft qu’unediffonanee de tempérament
, & qu’il eft harmoniquement confonant,
comp'étant l’accord parfait de fo l ; fo l, f i , ré, f i ,
12 , 15 , 18 , 2 1 , ou 4 , 5 , 6 , 7. Voyez mon article
Fondamental, n°. II. a°. Que le fa de l’accord fa
la ut, lorfqu’il fait la quarte jufte a ut , ne peut appartenir
au mode à*ut. Voyez l’article Diffonanee
de Rouffeau, et mes articles Fondamental, Baffe-fond.
& Baffe-continue. Voyez auffi l’aiticle j y , Enfin j’ai
démontré contre Rameau et Tartini que l’accord
fa , la, ut, dans les modes d'ut & de fo l , ne fait nullement
partie de l’harmonie de fa , mais, de celle de
f l , dérivant de l’accord impair fo l , ré, f i , mi » ,
la » , u t» ; 3 , 9 , 1 5 , 2 1 , 27, 33 , ou 1 , 3, 5, 7 ,
9 , 1 1 , & eu notes modernes; fol, r é , f i , fi1 , la,
ut. Voyez mon article fondamental n*. I I , l’accord
ré, fa , la , ut n’eft donc point fondamental dans le
fens de Rameau , irais dérive de ré, f i , fa , la , ut,
9* 5 » 7 » 9 * 1 1 » dont on a retranché 1 ë f i , parce
que le ré, St le y?, fe réfolvant tous les deux fur
ut, dans l’accord ut, u t , mi, la , ut , on a regardé
l’un des deux comme inutile. L’accord fa , la, ut,
appartient donc aux modes d'u t , & de fo l, quoique
le fa , quarte d'ut, n’en faffe pas partie; parce
que le fa de cet accord eft un mi » , vingt-unième
harmonique d'ut ; & feptième harmonique de fol.
Obfervàtion qui réduit à rien la prétendue origine
des diffonances imaginée par Rameau.
Je ne dis rien ici du fyftême des dissonances inventé
parTartini. Jemepropofe d’examiner Tenfemble de fa
théorie à l’article harmonie. Voyez cependant l’extrait
qu’en a fait Roufftau, art. fyflême , fyfiême de
Tartini.
D e toutes les opinions relatives à l’origine de la
dissonar.ee, la plus ingénieufe, c’eft fans contredit
celle de M. Bemetzrieder Leçons de Clavecin in-40,
1 7 7 1 , p. 1^4 & 332, parce qu’elle tient à l’effence
même de la mufique. « Q a ’eft-ce donc que la mu-
» fique, demande cet habile harmonifte ? on s’élèvera
» contre mon opinion : mais l’expérience fe réunira
» avec moi pour Ja définir, Fart de choquer les fions
» naturels. ‘pour etc rendre le retour plus agréable. Qu’on
»> s eça^e de cettt;: règ'e dans la pratique; plus de
» de mélodie, plus d’harmonie. » Ce principe eft
inconteftableme' t vrai, quoique toutes les applications
( p. 329 , 3 56. ) n’en foient pas également
heureuits. Je ne puis y toucher ici que légèrement ;
(V o y z mon art. Harmonie. ) Plaçons-nous dans le
mode d'ut, l’expérience nous apprend que l’oreille
n’eft pleinement* fatisfaite que lors qu’après l’accord
du temps fo;ble,, elle entend dans le temps f. rt fui-
vant, l’accord parfait fans mélange. L’accord parfa;t
eft ut, mi, fo l, ut: altérez-le par l ’interca'lation d'un
fon quelconque , vous chagrinez l’oreil e , elle attend
que vous lui rendiez l’harmonie d'ut dans foute ta
pureté ; mais vous pouvez a;guifer fon defir en lui,
offrant cette harmonie fuccefhvement altérée par les
notes de a gamme qui n’en font point partie. Quelles
font ces notes?/?, re, f a , la, dit M. Bémetzritder.
Il failoit.dirê, r<e, fa , la , f i , 9 , 1 1 , 1 3 , 13 , ou
re , f i , fa , la , »9 , 13 , 2 1 , 27. (V o y e z mon art.
fond ami nt a l, n*. II.) Toutes les combinaifons de
l’accord parfait dans lefquelles il entrera un ou plu-*
fieurs fons de l ’accord f i , r e ,f z , la, feront défirer,
appelleront l’accord ut,m , fol. Lere choque & appelle
Y ut & 1 emi; le fa appelle le mi & lefol", le la appelle
le fol & l'ut, celui-ci plus foib’ement que l’autre;
enfin le f i appelle l ut le plus fortement poflible.
Si l’on réunit la théorie des chocs à celte de la
biffe fondamentale, point d’accord, point de marche
harmonique, point de licence dont on ne puiffe rendre
raifon. Mais M. Bemetzrieder n’eft point du tout de
cet avis là. « Apréferit, dit-il, à la fin de fon traité,
» p. 332 , je vous, demanderai quel jugement vous
» portez de la baffe fondamentale ? Si vous la croyez
» bien propre à dévoiler les vrais refforts de la
» marche muficale ? » Ii eft vrai qu’il n’entend parler
que de celle de Rameau, ifoid. p. 333. Mais il n’eft
pas moins v ra i, que deftituée du fecours de la véritable
b:.ffe fondamentale, fa théorie ne fe prête nullement
à l’explication des différences fpécifiques de la
mefure muficale, non p’us qu’à celle de la fyncoper
Ibid. p. 347, auflî ne dit-il rien de cette dernière
marche, p. 348. (V o y e z mon art. baffe fon damen-
ta'c, n°. II ét III, ou j’ai traité de là mefure. Voyez
: aufii Syncope, & mon art. Harmonie. )
o On avoit, dit Rouffeau, art. diffonanee, juf-
n qu’ici raifonné fi mal fur la diffonanee, que je ne
n c ois pas avoir fait en cela pis que les autres. »> A
coup fur il n’a pas fait beaucoup mieux; s’il s’eft
diftingué des autres, c’eft moins par le mérite de
fes aperçus, que par leurs contradi&ions.
10.' Rouffeau ‘ ne voit point de raifon phyfique
qui autorife à introduire \dd:ffonance dans le corps
même de l’harmonie, art. dffan^nàe. « Non-feule-
» ment, dit-il, art. Harmonie.Vies harmoniques du
n fon qui la donnent, mais le Ion lui-même n’enrre
9 point dans le fyftême harmonieux du fon fon-
» d/âmental ; ( j ’ai prouvé le contraire, art. fonda- |
'» mental.) n Cependant., art. Cadence, il prétend que
la diffonanee eft toujours exprimée ou fjjus-entendue;
que rien ne peut faire fentir le repes < jue la diffonanee
antérieure qui le fufpend , ou h Jent jm.nt implique de
la diffonanee. Comment l’ame peut-/elle avoir ie ien-
timent d’uns chofc arbitraire & pure: /nent mécanique ?
Il haut donc que la diffonanee foit qu. '/{que chofe de bien
naturel,puilque l’oreille la fous-en /tend & la fupplée.
Cependant elle e f t , fuivant Ro (iffeau, art. Harmonie,
fi peu inhérente au fyllênke harmonieux du
fon fondamental, ceft-à-dire , à le /n accord, u qu’e’ le
>» fe diftingué toujours d’une manie M choquante parmi
» tous les autres fons. n Premier e contradiction.
20. N ’apercevant, ni dans la phy 'fique, c’eft-à-dire,
dans la réfonnance du corps fi viore, ni c'a.is le
calcul, c’eft-à-dire, dans la prog-e fïïon de fes harmoniques
, la génération de la dijjc./talnce, il il.i cherche
ünè origine purement méca nique; étant donnée la
baffe fondamentale fo l, ut ^ d fait porter à l’harmonie
de fo l une diffonanee, afi/i de la diftinguer de l’harmonie
de la tonique. I/'harmonie de f o l , fol f i re
fo l, produit par le moyjen de la dissonance deux harmonies
diffonv/ites, f i l , f i , re, mi, fol, & c fo l,fi,
re, fa , folf C /ipendan t , même art. il trouve la formule
harnfionique de ces deux accords dans la férié
1 > 7 » 7 » 7 > 7 »à!, \ > ÔC c’eft le y, harmonique du fol
qui repréfente Ica tni & le fa , ne différant de chacun
d’eux que d’un c|t!art de ton ; & ce miôc ce fa n’écant
altérés que par L ; tempéramment de notre gamme.
La réfonance du corps fonore donne donc l.s dissonances
que, Roufi'eau regarde comme mécaniques.
IX u xi è nie contracriéKon.
y°. Rouffeau, ar'lt. Harmonie, dit « que tout fon
» donne un accord vraiment parfait, puifqu’il eft
V formé de tous fes» harmoniques, & que c’eft par
w eux qu’il eft un fon. n Cependant, arc dissonance,
ii dit que le feptièrrieharmonique du fon fondamental
n’tntre point dans ?a réfonance totale de fts é’.émens,
comme confonnatj.ce mais comme dissonance. Or tout
corps fonore porte cette feptième, donc tout fon
donne un accord diffonant. Troifième contradiéfion. ‘
40. Art. confonnance, il dit que la feptième harmonique
forme, avec la quinte de l’accord parfait, un
intervalle très-dur, très-diffonant; & ,art. dissonance,
il dit que le fyftême de Tartini eft le feul dans lequel
la théorie d?s dissonances foit déduite dc-s vrais principes
de l’harmonie : orTartini dit, p.. 128, que cette
feptième eft une véritable ço.nfonuance &. non point
une dissonance. Le fentiment dj& Rouffeau n’eft donc
pas celui de Tartini; le fe:;,timent de Rouffeau eft
donc oppofé aux vrais principes de l’harmonie. Donc,
quatrième contra û&iori,
30, Rouffeau n’^dmet au nombre des dissonances
que la fécondé £/ la feptième; Tartini n’admet que
les çonfonnanç^s doubles. La double quinte, la double
qlnrte, la double tierce majeur^ &c. ( V»yez Syflémc,
/ Syflême de Tartini, extrait par Rouffean. ) Donc, cin^
quième coijtradiélion.
En général je ne vois qu’une obfervàtion à pre ndrg
dans l’art, dissonance de Rouffeau ; c’eft que la dissonance
doit fe réfoudre parle plus court chemin. C ’eft
un cOrreâif que M. Bémetzriéder devr~>tt admettre
dans fa théorie des appels ; cet harmonifte fuppofs
que tout appel peut monter ou defeendre, quoi qull
y ait toujours un des deux fons adjac.ns de l’harmonie
confonnante, qui foit plus fortement appelé
que l’autre. Suivant M. Bémetzriéder , dans cette
fucceflion fo l, f i , re ; fo l, ut, mi, le f i apelle le folfk
Y ut, mais ce dernier plus for tinrent; le re apelle Y ut
& le mi, mais le premier plus fortement. D ’oïl il s’er<-
fuivroit que ce^ trois falvations font régulières, ƒ?/ f i
re , fo l ut ; fo l f i re, fol mi ; enfin, fel f i re, fo l ut mi.
Mais il eft certain que les deux piemières font dê-
f.éhirufes, & qu’il y en a une quatrième que M. Bémetzriéder
ne pouvoir pas trouver dans fes principes.
C’eft fol f i reffol ut re, qui a lieu lorfque le fo l fondamental
défi end de quinte fur ut. ( Voyez dans la
table de la génér. harm. , col. III & il. ) & cette fal-
vation donne en même temps l’origine d une dïsso▼
nance néceffaire ( puifque le re du premier accord fé
réfout néceffairement fur le re du fécond, ) d’uae
fyncope & d’une cadence évitée.
II. Il y a donc des marches fondamental« qui
introduifent néceffairement des dissonants, mais je
dis plus ; dans toute harmonie d’un temps foible, il
n’y a de confonnant qua les unifions de l’harmonie
du temps fort. Dans cette fucceflion, fo l f i re, fo l ut
mi ; le f i &. le re du plumier accord doivent être regardés
comme des dissohan.es dont la réfonance étant prolongée
, a’tère la confonnance de Y ut & du mi. Donc
ils doivent être régulièrement fauvés. Enfin, ce qui
eft plus rigoureux, mais qui n’eft pas moins v ra i, le
fol, lui-même, eft obligé de fe rt foudre fur fon uniffon,
& non autrement. (V oyez mon art. baffe fond. ji°. V .f
Lorfque fol f i re fe réfout fur fol ut mi, l’accord
fo l f i re eft Un accord parfait qui cependant diffone avec
l’accord fuivant. J’apelle fa disionan.e, dissonance,
relative.
Lorfque ut mi fol f i , fe réfout fur ut mi fo l ut, il
eft évident qu’il forme avec le fécond accord une dissonance
relative ; mais l ’accord ut mi fo lf i, ifolé, étoit
déjà diffona :t. Il y a donc des dissonances abfolues St
des dissonances relatives.
Lorfque la baffe fondamentale fait un mouvement
descendant de quinte, fo l, ut, fi on fait réfonner
f o l ; f i , ré fur le f o l , on aura néceffairement dans le
tenis fort fuivant l’accord diffonant fol, ut, ré. 11
y a donc des diffonances libres & des diffonances
obligées.
Lorfqu’on entend l’accord f o l , f i , re, on ignore £
K k k ij