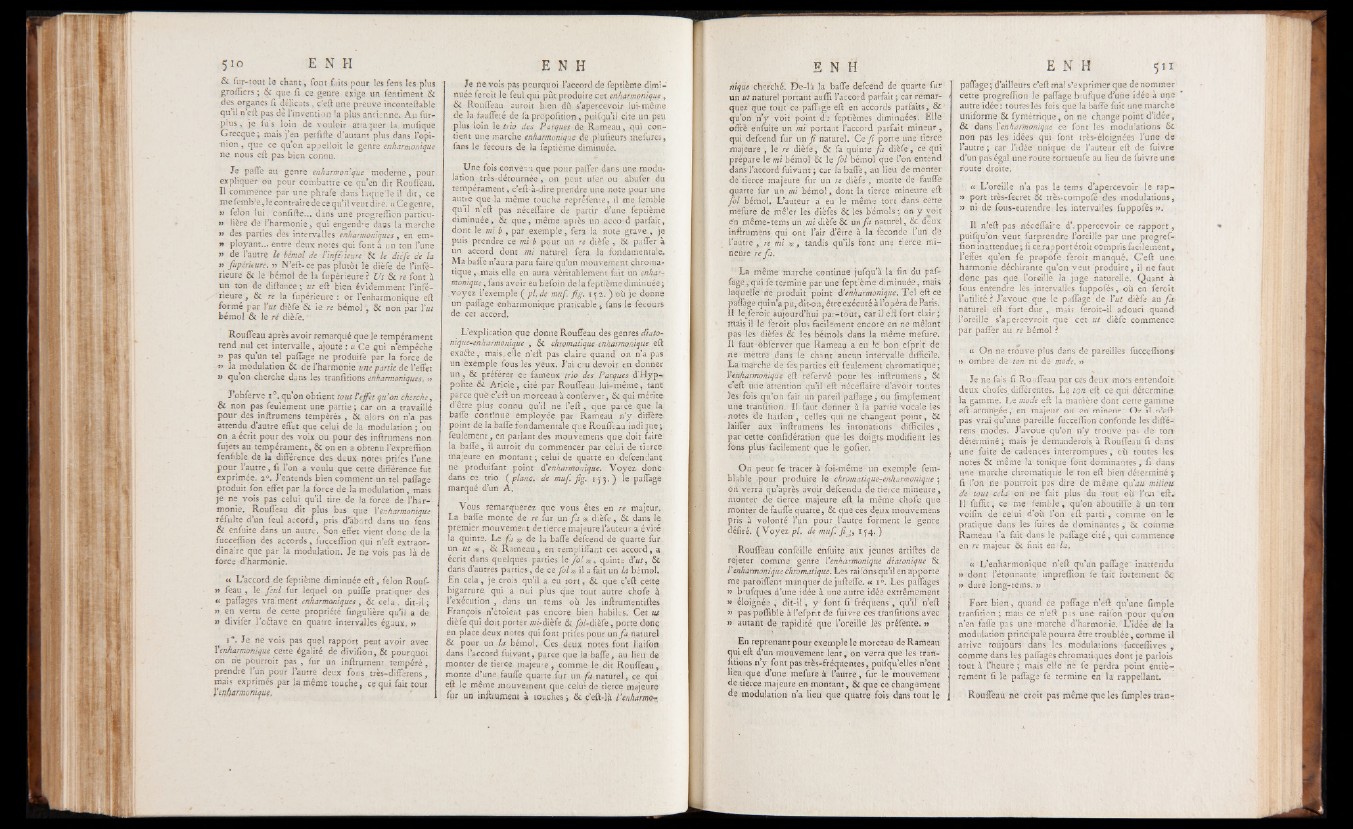
& fur-tout le chant, font faits- pour les fens les plus
greffiers ; & que fi ce genre exige un fentiment &
des or8anes £ délicats , c’eft une preuve inconteüable
qu il n’eft pas de l’invention la plus ancienne. A u fur-
plus , je fu s loin de vouloir attaquer la mufique
Grecque ; mais j’en perfide d’autant plus dans l'opinion
, que ce qu’on appelloit le genre enharmonique
ne nous eft pas bien connu.
Je paffe au genre enharmonique moderne, pour
expliquer ou pour combattre ce qu’en dit Rouffeau.
Il commence par une phrafe dans laquelle il dit, ce
me femble, le contraire de ce qu’il veut dire. « C e genre,
» félon lui. confifte... dans une progreffion particu-
» lière de l’harmonie, qui engendre daas la marche
» des parties des intervalles enharmoniques, en em-
j* ployant... entre deux notes qui font à un ton l’une
» de l’autre le bémol de t inférieure & le dièfe de la
” fupérieure. » N’eft- ce pas plutôt le dièfe de l’inférieure
& le bémol de la fupérieure ? Th & re font à
un ton de diftance ; ut eft bien évidemment l’inférieure
, & re la fupérieure : or l’enharmonique eft
formé par Yut dièfe & le re b ém o l, & non par Y ut
bémol & le ré dièfe.*'
Rouffeau après avoir remarqué que le tempérament
rend nul cet intervalle, ajoute : « C e qui n’empêche
» pas qu’un tel paffage ne produife par la force de
« la modulation & de l ’harmonie une partie de l’effet
» qu’on cherche dans les tranfitions enharmoniques, n
J’obferve i ° . qu’on obtient tout Yeffet qu’on cherche,
& non pas feulement une partie ; car on a travaillé
pour des inftrumens tempérés , & alors on n’a pas
attendu d’autre effet que celui de la modulation ; ou
on a écrit pour des voix ou pour des inftrumens non
fujets au tempérament, & on en a obtenu l’expreffion
fenhble de la différence des deux notes prifes l’une
pour l’autre, fi l’on a voulu que cette différence fut
exprimée. i° . J’entends bien comment un tel paffage
produit fon effet par la force de la modulation, mais
je ne vois pas celui qu’il tire de la force de l’harmonie.
Rouffeau dit plus bas que Y enharmonique.
réfulte d’un feul accord, pris d’abord dans un fens
& enfuite dans un autre. Son effet vient donc de la
fucceffion des accords, fuçceflion qui n’eft extraordinaire
que par la modulation. Je ne vois pas là de
force d’harmonie.
« L ’accord de feptième diminuée e ft , félon Rouf- j
» feau , le feul fur lequel on puiffe pratiquer des
« paffages vraiment enharmoniques, & c e la , dit-il:
s? en verra de cette propriété fmgulière qu’il a de
» divifer l ’oélave en quatre intervalles égaux. »
i e. Je ne vois pas quel rapport peut avoir avec
Je ne vois pas pourquoi l’accord de feptième diminuée
feroit le feul qui pût produire cet enharmonique ,
& Rouffeau suroit bien dû s’apercevoir lui* même
de la fauffeté de fa proportion, puifqu’il cite un peu
plus loin le trio des Parques de Rameau, qui contient
une marche enharmonique de plufieurs mefures,
fans le fecours de la feptième diminuée.
Une fois convenu que pour paffer dans une modulation
très-détournée, on peut ufer ou abufer du
tempérament, c’eft-à-dire prendre une note pour une
autre que la même touche reprêfente, il me femble
qu il n’eft pas néceffaire de partir d’une feptième
diminuée, & q u e , même après un accord parfait,
dont le mi b , par exemple, fera la note grave-, je
puis prendre ce mi b pour un re dièfe , &. paffer à
un accord dont mi naturel fera la fondamentale.
Ma baffe n’aura paru faire qu’un mouvement chromatique,,
mais elle en aura véritablement fait un enharmonique,
fans avoir eu bëfoin de la feptième diminuée;
vo y e z l’exemple ( pl. de muf fig. 1 52. ) où je donne
un paffage enharmonique praticable , fans le fecours
de cet accord.
L ’explication que donne Rouffeau des genres diatonique
enharmonique , & chromatique enharmonique eft
exaéfe, mais,elle n’eft pas claire quand on n’a pas
un exemple fous les yeux. J’ai cru devoir en donner
u n , & préférer ce fameux trio des Parques dH y p -
polite & A r ic ie , cité par Rouffeau lui-même, tant
parce qué'deft un morceau à conlérver, & qui mérite
d’être plus connu qu’il ne l’eft , que parce que la
baffe continue employée par Rameau n’y diffère
point de la baffe fondamentale que Rouffeau indique;
feulement, en parlant des mouvemens que doit faire
la baffe, il aurait du commencer par celui de tierce
majeure en montant ; celui de quarte en descendant
ne produifant point d’enharmonique. V o y e z donc
dans ce trio ( plane, de muf. fig. 15 3. ) le paffage
marqué d’un A .
Vous remarquerez que vous êtes en re majeur.
La baffe monte de re fur un fa # d ièfe, & dans le
premier mouvement de tierce majeure l’auteur a évité
la quinte. Le fa % de la baffe defeend de quarte fur
un ut * , & Rameau, en rempliffant cet accord, a
écrit dans quelques parties le f o l» , quinte d'ut, &
dans d’autres parties, de ce fol * il a fait un là bémol.
En ce la , je crois qu’il a eu to r t , & que c’eft cette
bigarrure qui a nui plus que tout autre chofe à
l’exécution , dans un tems où les inftrumentiftes
François n’étoient pas encore bien habiles. Cet 14
dièfe qui doit porter mi-dièfe & fol-dièfe, porte donç
en place deux notes qui font prifes pour un fa naturel
& pour un la bémol. Ces deux notes font liaifon
dans l’accord fuivant, parce que la baffe, au lieu de
monter de tierce majeure, comme le dit Rouffeau,
monte d’une fauffe quarte fur un fa naturel, ce qui
eft le même mouvement que celui de tierce majeure
Air un inftmtnent à Louches ; & c’eft-là l’tnharmQv,
Y enharmonique cette égalité de divifion, & pourquoi
on ne pôurroit pas , fur un inftrument tempéré ,
prendre i’un pour l’autre deux fons très-différens,
mais exprimés par la même touche, ce qui fait tout
Y enharmonique.
nique cherché. De-là la baffe defeend de quarte fur
un ut naturel portant aufli l’accord parfait ; car remarquez
que tout ce paffage eft en accords parfaits, &
qu’on n’y voit point de feptièmes diminuées. Elle
offre- enfuite un mi portant l’accord parfait mineur,
qui defeend fur un j? naturel. Ce f i porte une tierce
majeure , 1 e re dièfe, & fa quinte fa d ièfe, ce qui
prépare le mi bémol & 1 é fol bémol que l’on entend
dans l’accord fuivant; car la baffe, au lieu démonter
de’ tierce majeure fur un re dièfe , monte de fauffe
quarte fur un mi b émol, dont la tierce mineure eft
fol bémol. L’auteur a eu le même tort dans cette
mefure de mêler les dièfes & les bémols; on y voit
dn même-tems un mi dièfe ècunfia naturel, & deux
inftrumens qui ont l’air d’êrre à la fécondé l’un de
l'autre , re mi %, tandis qu’ils font une tierce mineure
re f i .
La même marche continue jufqu’à la fin du paffage,
qui fe termine par une feptième diminuée, mais
laquelle' ne produit point d‘enharmonique. T e l eft ce
paffage .qui n’a pu, dit-on, être exécuté à l’opéra de Paris.
Il leTeroir aujourd’hui par-tout, car il eft fort clair ;
mais il le' feroit plus facilement encore en ne mêlant
pas les dièfes & les bémols dans la même mefure.
Il faut-obferver que Rameau a eu le bon.efprit de
ne mettre dans le chant aucun intervalle difficile.
L a marche de fes parties eft feulement chromatique;
Yenharmonique eft refervé pour les inftrumens , &
c’ eft une attention qu’il eft néceffaire d’avoir toutes
les fois qu’on fait un pareil paffage j ou fim'plement
une tranfition. Il faut donner à la partie vocale les
notes de liaifon , celles qui ne changent point, &
laiffer aux inftrumens les intonations difficiles ,
par cette confidération que les doigts modifient les
fons plus facilement que le gofier.
O n peut fe tracer à foL-même - un exemple fem-
blable pour produire le chromatique-enhannonique ;
ôn verra qu’àprès avoir defeendu de tierce mineure,
monter de tierce majeure eft la même chofe que
monter de fauffe quarte, & que ces deux mouvemens
pris à volonté l’un pour l’autre forment le genre
défiré. (V o y e z pl. de muf. f i j , 154. )
Rouffeau confeille enfuite aux jeunes artiftes de
rejeter comme genre Yenharmonique diatonique &
l'enharmonique chromatique. Les raifons qu’il en apporte
me paroiffent manquer de jufteffe. « i° . Les paffages
’> brufques d’une idée à une autre idée extrêmement
» éloignée , d it- il, y font fi fréquens , qu’il n’eft
» pas poffible à l’efprit de fuivre ces tranfitions avec
» autant de rapidité que l’oreille les préfente. »
En reprenant pour exemple le morceau de Rameau
qui eft d’un mouvement lent, on verra que les tranfitions
n’y font pas très-fréquentes, puifqu’elles n’ont
lieu que d’une mefure à l’autre, fur le mouvement
de tierce majeure en montant, & que ce changement
de modulation n’a lieu que quatre fois dans tout le
paffage; d’ailleurs c’eft mal s’exprimer que dénommer
cette progreffion le paffage brufque d’une idée à une
autre idée : toutes les fois que la baffe fuit une marche
uniforme & fymétrique, on ne change point d’idée,
& dans Yenharmonique ce font les modulations &
non pas les idées qui font très-éloignées l’une de
l’autre ; car l’idée unique de l’auteur eft de fuivre
d’un pas égal une route tortueufe au lieu de fuivre une
foute droite.
u L ’oreille n’a pas le tems d’apercevoir le rap-
» port très-fecret & très-compofé des modulations,
jj ni de fotis-entendre les intervalles fuppofés j j .
Il n’eft pas néceffaire d’üppercevoir ce rapp ort,
puifqu’on veut furprendre l’oreille par une progreffion
inattendue ; fi ce rapport étoit compris facilement,
l’effet qu’on fe propofe feroit manqué. C ’eft une
harmonie déchirante qu’on veut produire, il ne faut
donc pas que l’oreille la juge naturelle. Quant à
fous entendre les intervalles fuppofés, où en feroit
l’utilité ? J’avoue que le paffage de Yut dièfe au fia
naturel eft fort dur , mais feroit-il adouci quand
l’oreille s’apercevrait que cet ut dièfe commence
par paffer au re bémol ?
« On ne trouve plus dans de pareilles fuccefîions
jj ombre de ton ni de mode, jj
Je ne fais fi Rouffeau par ces deux mors entendoit
deux chofes. différentes. Le ton eft ce qui détermine
la gammé. Le mode eft la manière dont cette gamme
eft arrangée, en majeur ou en mineur. O r il n’eft
pas vrai qu’une pareille fucceffion confonde les difté-
rens modes. J’avoue qu’on n’y trouve pas de ton
déterminé; mais je demanderais à Rouffeau fi dans
une fuite de cadences interrompues, cù toutes les
notes & même la tonique font dominantes, fi dans
une marche chromatique le ton eft bien détermine;
fi l’on ne pourrait pas dire de même qu 'au milieu
de tout cela- on ne fait plus du tout où' l’on eft.-
Il fuffit, ce me femble, qu’on abouriffe à un ton
voifin dé celui d’où l’on eft parti , comme on le
pratique dans les fuites de dominantes , & comme
Rameau l’a fait dans le paffage c ité , qui commence
en re majeur & finit en la.
u L ’enharmonique n’eft qu’un paffage inattendu
jj dont l’étonnante impreffion fe fait fortement ôç
jj dure long-tems. jj
Fort b ien , quand ce paffage n’eft qu’une fimple
tranfition ; mais ce n’eft p ;s une raifon 'pour qu’on
n’en faffe pas une 'marche d’harmonie. L ’idée de la
modulation principale pourra être troublée, comme il
arrive toujours dans les modulations fucceffives ,
comme dans les paffages chromatiques dont je parlois
tout à l’heure ; mais elle ne fe perdra point entièrement
fi le paffage fe termine en la rappellant.
Rouffeau ne croit pas même que les fimples tran