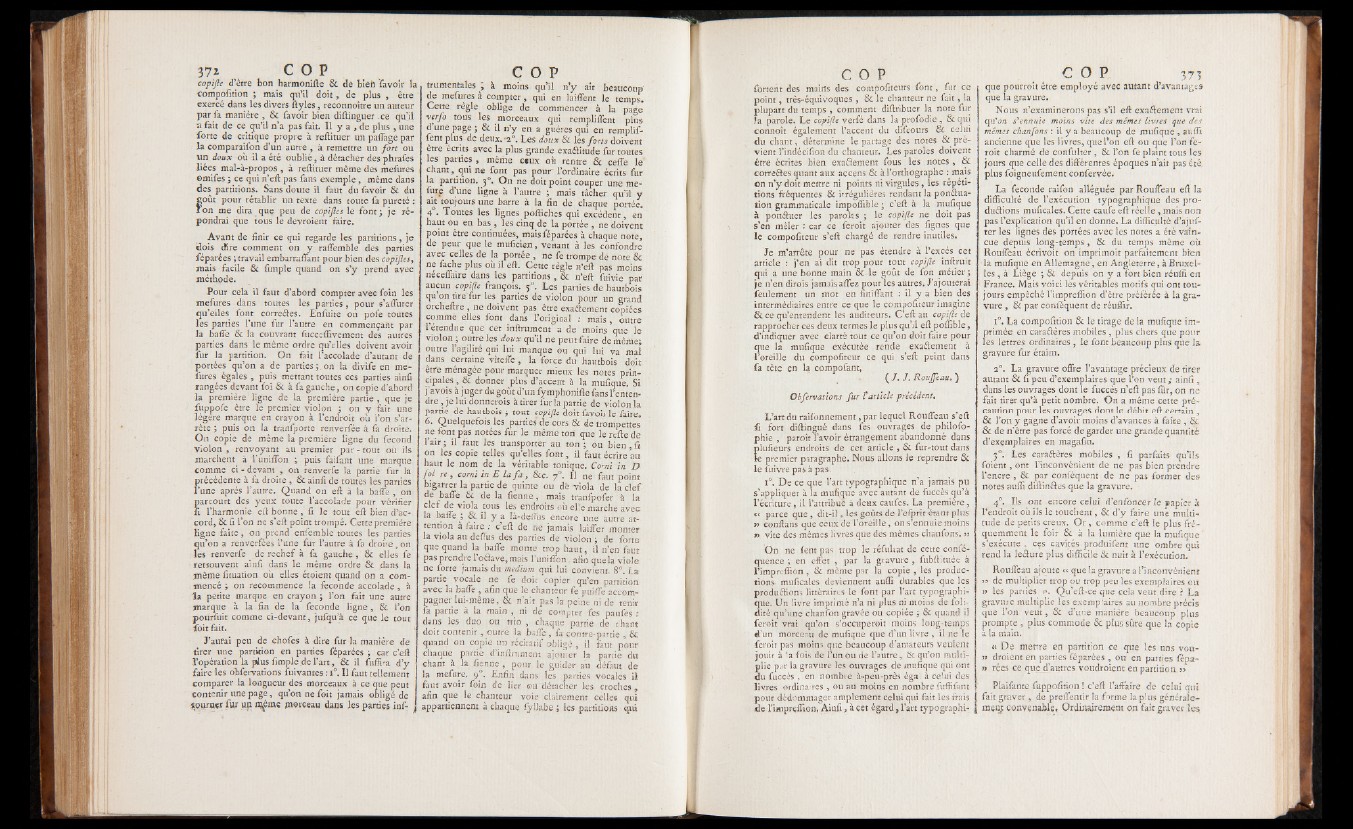
3 7 2 C O P
copifle d’être bon harmonise & de bien favoir la
compofition ; mais qu’il d o it, de plus , être
exercé dans les divers ftyle s , reconnoître un auteur
par fa manière , & fa voir bien diftinguer -ce qu’il
a fait de ce qu’il n’a pas fait. Il y a , de plus , une
forte de critique propre à reftituer un paffage par
la comparaifon d’un autre , à remettre un fort ou
un doux où il a été oublié, à détacher des phrafes
liées mal-à-propos , à reftituer même des mefures
©mifes ; ce qui n’eft pas fans exemple, même dans
dès partitions. Sans doute il faut du favoir & du
oût pour rétablir un texte dans toute fa pureté :
on me dira que peu de copijles le fon t; je répondrai
que tous le devroient faire.
Avant de finir ce qui regarde les partitions, je
dois dire comment on y raffemble des parties
féparées ; travail embarraffant pour bien des copijles,
mais facile & fimple quand on s’y prend avec
méthode.
Pour cela il faut d’abord compter avec foin les
mefures dans toutes les parties, pour s’aflùrer
qu’eiles font correâes. Enfuite 011 pofe toutes
les parties l’une fur l’autre en commençant par
la baffe & la couvrant fucceflivement des autres
parties dans le même ordre qu’elles doivent avoir
fur la partition. On fait l’accolade d’autant de
portées qu’on a de parties; on la divife en mefures
égales , puis mettant toutes ces parties ainfi
rangées devant foi & à fa gauche, on copie d’abord
la première ligne de la première partie , que je
fuppofe être le premier violon ; on y fait une
légère marque en crayon à l’endroit ou i’on s’arrête
; puis on la trànfporte renverfée à fa droite.
On copie de même la première ligne du fécond
violon , renvoyant au premier par - tout où ris
marchent à l'uniffon ; puis faifant une marqne
comme ci - devant , on renverfe la partie fur la
précédente à fa droite , & ainfi de toutes les parties
l ’une après l’autre. Quand on eft à la baffe, on
parcourt des yeux toute l’accolade pour vérifier
li l’harmonie eft bonne, fi le tout eft bien d’accord,
& fi l’on ne s’eft point trompé. Cette première
ligne faite, on prend enfemble toutes les parties
qu’on a renverfées l’une fur l’autre à fa droite/on
les renverfe de rechef à fa gauche, & elles fe
retrouvent ainfi dans le même ordre & .dans la
même fituation où elles étoient quand on a commencé
; on recommence la fécondé accolade , à
l a petite marque en crayon ; l’on fait une autre
marque à la fin de la fécondé ligne, 8c l’on
pourfuit comme ci-devant, jufqu’à ce que le tout
foit fait.
J’aufai peu de chofes à dire fur la manière de
tirer une partition en parties féparées ; car c’eff
l ’opération la plus fimple de l’art, & il fuffi-a d’y
faire les obfervations Suivantes : l°. Il faut tellement
comparer la longueur des morceaux à ce que peut
contenir une page, qu’on ne foit jamais obligé de
«ourner fur un n^ême morceau dans les parties inf- j
C O P
trumentales , a moins qu’il n’y ait beaucoup
de mefures à compter, qui en laiffent le temps.
Cette règle oblige de commencer à la page
verfo tous les morceaux qui rempliffent plus
d une page ; & il n’y en a guères qui en rempliffent
plus de deux. *2.°. Les doux 8c les forts doivent
être écrits avec la plus grande exaftitude fur toutes
les parties , même ceux où rentre & ceffe le
chant, qui ne font pas pour“ l’ordinaire écrits fur
la partition. 30. On ne doit point couper une me-
furp d’une ligne à l’autre ; mais tâcher qu’il y
ait toujours une barre à la fin de chaque portée.
4°. Toutes les lignes poftiches qui excèdent, en
haut ou en bas , les cinq de la portée , ne doivent
point être continuées, mais féparées à chaque note,
de peur que le muficien, venant à les confondre
avec celles de la portée , ne fe trompe de note 8c
ne fâche plus où il eft. Cette règle n’eft pas moins
néceffaire dans les partitions, & n’eft fuivie par
aucun copifte françois. 50. Les parties de hautbois
qu’on tireffur les parties de violon pour un grand
orcheftre , ne doivent pas être exactement copiées
comme elles font dans l’origioal ; mais , outre
l’étendue que cet instrument a de moins que le
violon ; outre les doux qu’il ne peut faire de même;
outre l’agilité qui lui manque ou qui lui va mal
dans certaine vîteffe , la force du hautbois doit
être ménagée pour marquer mieux les notes principales
, & donner plus d’accent à la mufique. Si
j’avois à juger du goût d’un fymphonifte fans l’entendre
, je lui donnerois à tirer fur la partie de violon la
partie de hautbois ; tout copifle doit favoir le faire.
6. Quelquefois les parties de cors 8c de trompettes
ne font pas notées fur le même ton que le refte de
l ’air ; il faut les transporter au ton ; ou bien, fi
on les copie telles qu’elles fon t, il faut écrire au
haut le nom de la véritable tonique. Cor ni \n j )
fo l re , corni in E la f a , 8cc. 70. 11 ne faut point
bigarrer la partie de quinte ou dé viola de la c le f
de baffe 8c de la fienne, mais tranfpofer à la
cle f de viola tous les endroits où elle marche avec
la baffe ; & il y a là-dellùs encore une autre attention
à faire ; c’eft de ne jamais laiffer monter
la viola au de fins des parties de violon ; de forte
que quand la baffe monte trop haut, il n’en faut
pas prendre 1 odave, mais l’uniffon. afin que la viole
ne forte jamais du medium qui lui convient. 8°. La
partie vocale ne fe doit copier qu’en partition
avec la baffe , afin que le chanteur fe puiffe accompagner
lui-même, & n’ait pas la peine ni de tenir
la partie à la main , ni de compter fe s paufes t
dans les duo ou trio , chaque partie de chant
doit contenir , outre la bsffe, fa contre-partie , 8c
quand on copie un récitatif obligé, il faut pour
chaque partie d’inftrument ajouter la partie du
chant à la fienne , pour le guider au défaut de
la mefure, 9 . Enfin dans les parties vocales il
faut avoir foin de lier ©u détacher les croches ,
afin que le chanteur voie clairement celles qui
appartiennent à chaque fyllabe ; les partitions qui
C O P
fortent des mains des compofiteurs fo n t, fur ce
point, très-équivoques , & le chanteur ne fa it, la
plupart du temps , comment diftribuer la note fur
la parole. Le copifle verfé dans la profodie, 8c qui
connoît également l’accent du difeours & celui
du chant, détermine le partage des notes & prévient
l’indécifion du chanteur. Les paroles doivent
être écrites bien exaélement fous les notes , &
correâes quant aux accens & à l’orthographe : mais
on n’y doit mettre ni points ni virgules, les répétitions
fréquentes & irrégulières rendant la ponélua-
tion grammaticale impoflible ; c’eft à la mufique
à ponéluer les paroles ; le copifle ne doit pas
s’en mêler : car ce feroit ajouter des lignes que
le compofiteur s’eft chargé de rendre inutiles.
Je m’arrête pour ne pas étendre à l’excès cet
article : j’ en ai dit trop pour tout copifte inftruit
qui a une bonne main & - le goût de fon métier ;
je n’en dirois jamais affez pour les autres. J’ajouterai
feulement un mot en finiffant : il y a bien des
intermédiaires entre ce que le compofiteur imagine
& ce qu’entendent les auditeurs. C ’eft au copifte de
rapprocher ces deux termes le plus qu’il eft poflible,
d’indiquer avec clarté tout ce qu’on doit faire pour
que la mufique exécutée rende exactement à
l’oreille du compofiteur ce qui s’eft peint dans
fa tête en la compofant,
( J. J. Roujfeau. )
Obfervations fur /’ article précèdent.
L ’art du raifonnement, par lequel Rouffeau s’eft
fi fort diftingué dans fes ouvrages de philofo-
phie , paroît l’avoir étrangement abandonné dans
plufieurs endroits de cet article , & fur-tout dans
te premier paragraphe. Nous allons le reprendre &
le fuivre pas à pas.
i°. De ce que l’art typographique n’a jamais pu
s’appliquer à la mufique avec autant de fuccès qu’à
l ’écriture , il l’attribué à deux caufes. La première,
<« parce que , dit-il, les goûts de l ’efprit étant plus
» conftans que ceux de l’oreille, on s’ennuie moins
» vite des mêmes livres que des mêmes chanfons'. >3
On ne lent pas trop le réfuhat de cette confé-
quence ; en effet , par la gravure , ftibftituée à
l ’imprefîion, & même par la copie , les productions
muficales deviennent aufli durables que les
produ&ions littéraires le font par l’art typographique.
Un livre imprimé n’a ni plus ni moins de foli-
dité qu’une chanfon gravée ou copiée ; & quand il
feroit vrai qu’on s’occuperoit moins long-temps
d’un morceau de mufique que d’un livre , il ne le
feroit pas moins que beaucoup d’amateurs veulent
jouir à la fois de l’un ou de l’autre, 8c qu’on multiplie
par la gravure les ouvrages de mufique qui ont
du fuccès , en nombre à-peu-près égal à celui des
livres ordinä res , ou au moins en nombre fuffifant
pour dédommager amplement celui qui fait les frais
de riüiprçffion, Ainfi, à cet égard, l’art typograpbi-
C O P 373
que pourroit être employé avec autant d’avantages
que la gravure.
Nous n’examinerons pas s’il eft exactement vrai
qu'on s'ennuie moins vite des mêmes livres que des
mêmes chanfons : il y a beaucoup de mufique , aufft
ancienne que les livres, que l’on eft ou que l’on feroit
charmé de eonftilter , & l’on fe plaint tous les
jours que celle des différentes époques n’ait pas été,
plus foigneufement confervée.
La fécondé raifon alléguée par Rouffeau eft la
difficulté de l’exécution typographique des productions
muficales. Cette caufe eft réelle , mais non
pas l’explication qu’il en donne. La difficulté d’ajuf-
ter les lignes des portées avec les notes a été vaincue
depuis long-temps , 8c du temps même où
Rouffeau écrivoit on imprimoit parfaitement bien
la mufique en Allemagne, en Angleterre, à Bruxelles
, à Liège ; & depuis on y a fort bien réulfi en
France. Mais voici les véritables motifs qui ont toujours
empêché l’impreffion d’être préférée à la gravure
, & par conféquent de réuffitr.
i°. La compofition & le tirage de la mufique imprimée
en caraélères mobiles , plus chers que pour
les lettres ordinaires , le font beaucoup plus que la
gravure fur étaim.
20. La gravure offre l’avantage précieux de tirer
autant & fi peu d’exemplaires que l’on veut ; ainfi ,
dans les ouvrages dont le fuccès n’eft pas fur, on ne
fait tirer qu’à petit nombre. On a même cette précaution
pour les ouvrages dont le débit eft certain ,
& l’on y gagne d’avoir moins d’avances à faire , 8c
8c de n’être pas forcé de garder une grande quantité
d’exemplaires en magafin.
30. Les caractères mobiles , fi parfaits qu’ils
foient, ont l'inconvénient de ne pas bien prendre
l’encre, & par conféquent de ne pas former des
notes auffi diftinCtes que la gravure.
40. Ils ont encore celui d’enfoncer îe papier à
l’endroit où ils le touchent, 8c d’y faire une multitude
de petits creux. O r , comme c’eft le plus fréquemment
le foir & à la lumière que la mufique '
s’exécute , ces cavités produifent une ombre qui
rend la leCture plus difficile 8c nuit à l’exécution.
Rouffeau ajoute « que la gravure a l’inconvénient
’> de multiplier trop ou trop peu les exemplaires ou
» les parties ». Q u ’eft-ce que cela veut dire ? La
gravure multiplie les exemplaires au nombre précis
que l’on v eut, 8c d’une manière beaucoup plus
prompte , plus commode 8c plus sûre que la copie
à la main.
« De mettre en partition ce que les uns von-
» droient en parties féparées , ou en parties fépa-
» rées ce que d’autres voudroient en partition. »
Plaifante fuppofition ! c’eft l’affaire de celui qm
fait graver , de preffentir la forme la plus généralement
convenable» Ordinairement on fait graver les