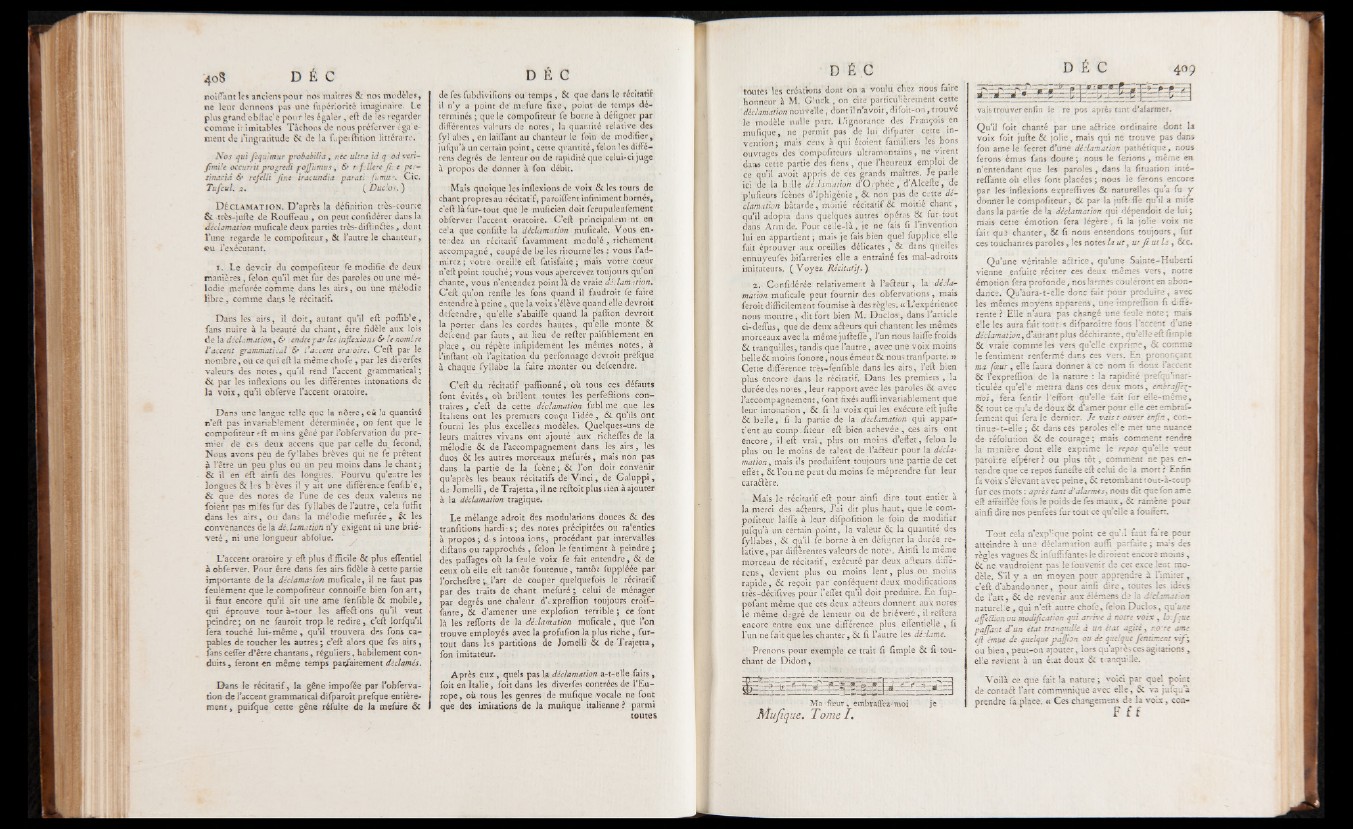
«Giflant les anciens pour nos maîtres & nos modèles,
ne leur donnons pas une (upériorité imaginaire. Le
plus grand obliac’e pour les égaler, eft de les regarder
comme i; imitables Tâchons de nous préfer ver cga’e-
ment de l’ingratitude & de la fiipetftition littéraire.
Nos qui fequimur prob&bilia , r.ec ultra id q od ven-
finale, occunit pragredi poJJ'umus, & r f.llere fi, e per-
tinacid & refelli fine iracundia parati fumur. Cic.
Tufcul. s . ( Duclos. )
D éclamation. D ’après la définition très-courte
& très-jufte de Rouffeau , on peut confidérer dans la
déclamation muficale deux parties très-diftinéles , dont
l’une regarde le compofiteur, & l’autre le chanteur,
eu l’exécutant.
i . Le devoir du compofiteur fe modifie de deux
manières , félon qu’il met fur des paroles ou une mélodie
mefurée comme dans les airs, ou une mélodie
libre, comme dar.s le récitatif.
Dans les airs, il doit, autant qu’il eft poffib’e ,
fans nuire à la beauté du chant, être fidèle aux lois
de la déclamation, 6» tendre parles inflexions & le nomire
l'accent grammatical & L'accent oratoire. C’eft par le
nombre, ou ce qui eft la même chofe , par les diverfes
valeurs des notes, qu’il rend l’accent grammatical ;
& par les inflexions ou les différentes intonations de
la voix, qu’il obferve l’accent oratoire.
Dans une langue telle que la nôtre, ou la quantité
n’eft pas invariablement déterminée, on fent que le
compofiteur eft moins gêné par i’obfervation du premier
de ces deux accens que par celle du_ fécond.
Nous avons peu de fyilabes brèves qui ne fe prêtent
à l’être un peu plus ou un peu moins dans le chant ;
& il en eft ainfi des longues. Pourvu qu’entre les
longues & les brèves il y ait une différence fenfib’e,
& que des notes de l’une de ces deux valeurs ne
foient pas mifes fur des fyilabes de l’autre, cela fuffit
dans les airs, ou dans la mélodie mefurée, & les
convenances de la déclamation n’y exigent ni une brièv
e té , ni une longueur abfolue.
L’accent oratoire y eft plus d'fficile & plus effentiel
à obferver. Pour être dans fes airs fidèle à cette partie
importante de la déclamation muficale, il ne faut pas
feulement que le compofiteur connoiffe bien fon art,
il faut encore qu’il ait une ame fenfible & mobile,
qui éprouve tour à-tour les affeél ons qu’il veut
peindre ; on ne fauroit trop le redire, c’eft lorfqu’il
fera touché lui-même, qu’il trouvera des fons capables
de toucher les autres ; c’eft alors que fes airs ,
fans ceffer d’être chantans, réguliers, habilement conduits
, feront en même temps parfaitement déclamés.
Dans le récitatif, la gêne impofée par l’obferva-
tion de l’accent grammatical difparoît prefque entièrement,
puifque cette gêne réfulte de la mefure &
de fes fubdivifions ou temps, & que dans le récitatif
il n’y a point de mefure fixe, point de temps déterminés
; que le compofiteur fe borne à déligner par
différentes valeurs de notes, la quantité relative des
fyl’abes , en laiffant au chanteur le foin de modifier,
jufqu’à un certain point, cette quantité, félon lesdiffé-
rens degrés de lenteur ou de rapidité que celui-ci juge
à propos de donner à fon débit.
Mais quoique les inflexions de voix & les tours de
chant propres au récitatif, paroiffent infiniment bornés,
c’eft là fur-tout que le muficien doit fc ru pu leu fe ment
obferver l’accent oratoire. C ’eft principalenvnt en
ce'a que conlifte la déclamation muficale. Vous entendez
un récitatif favamment modulé, richement
accompagné, coupé de belles ritourne'les : vous l’admirez;
votre oreille eft fatisfaite; mais votre coeur
n’eft point touché; vous vous apercevez toujours qu’on
chante, vous n’entendez point là de vraie dé.lamation.
C’eft qu’on renfle les fons quand il faudroit fe faire
entendre à peine, que la voix s’élève quand elle devroit
defcendre, qu’elle s’abaiffe quand la paffion devroit
la porter dans les cordes hautes, qu’elle monte &
defcend par fauts, au lieu de refter paifiblement en
place , ou répète infipidement les mêmes notes, à
l’inftant où l’agitation du perfonnage devroit prefque
à chaque fyllabe la faire monter ou defcendre.
C ’eft du récitatif paffionné, où tous ces défauts
font évités, où brillent toutes les perfeélions contraires,
c’eft de cette déclamation fubl me que les
Italiens ont les premiers conçu l’idée, & qu’ils ont
fourni les plus exceller.s modèles. Quelques-uns de
leurs maîtres vivans ont ajouté aux richeffes de la
mélodie & de l’accompagnement dans les airs , les
duos & les autres morceaux mèfurés, mais non pas
dans la partie de la fcène ; & l’on doit convenir
qu’après les beaux récitatifs de:Vinci, de Galuppi,
de Jomelli, de Trajetta, il ne rèftoit plus rien à ajouter
à la déclamation tragique.
Le mélange adroit des modulations douces & des
tranfitions hardi:s; des notes précipitées ou ralenties
à propos ; d s intona ions, procédant par intervalles
diftans ou rapprochés, félon le fentiment à peindre ;
des paffages où la feule voix fe fait entendre, & de
ceux où elle eft tantôt foutenue, tantôt fuppléée par
l’orcheftre £ l’art de couper quelquefois le récitatif
par des traits de chant mefuré ; celui de ménager
par degrés une chaleur d’cxpreffion toujours croif-
fante, & d’amener une explofion terrible ; ce font
là les refforts de la déclamation muficale, que l’on
trouve employés avec la profufion la plus riche, fur-
tout dans les partitions de Jomelli & de Trajetta,
fon imitateur.
Après eux, quels pas la déclamation a-t-elle fairs ,
foit en Italie, foit dans les diverfes contrées de l’Europe,
où tous les genres de mufique vocale ne font
que des imitations de la mufique italienne? parmi
toutes
toutes les créations dont on a voulu chez nous faire
honneur à M. G luck, on cite particulièrement cette
déclamation nouvelle, dont il n’a voit, difoit-on »trouvé
le modèle nulle part. L’ignorance des François en
mufique, ne permit pas de lui difputer cette invention;
mais ceux à qui étoient familiers les bons
ouvrages des compofiteurs ultramontains, ne virent
dans cette partie des Tiens, que l’heureux emploi de
ce qu’il avoit appris de ces grands maîtres. Je parle
ici de la b ..lie déclamation d’Orphée, d’Alcefte, de
plufieurs fcènes d’Iphigénie, & non pas de cette déclamation
bâtarde, moitié récitatif & moitié chant,
qu’il adopta dans quelques autres opéras & fur-tout
dans Armide. Pour celle-là, je ne fais fi l’invention
lui en appartient ; mais je fais bien quel fupplice elle
fait éprouver aux oreilles délicates , & dans quelles
ennuyeufes bifarreries elle a entraîné fes mal-adroits
imitateurs. (V o y e z Récitatif.)
2. Confidérée relativement à l’acleur , la déclamation
muficale peut fournir des obfervations, mais
ferait difficilement foumise à des règles. « L’expérience
nous montre , dit fort bien M. Duclos, dans 1 article
ci-deffus, que de deux aéleurs qui chantent les mêmes
morceaux avec la même jufteffe, l’un nous laiffe froids
& tranquilles, tandis que l’autre, avec une voix moins
belle & moins fonore, nous émeut & nous tranfporte. w
Cette différence très-fenfible dans les airs, l’eft bien
plus encore dans le récitatif. Dans les premiers , la
durée des notes , leur rapport avec les paroles & avec
l’accompagnement, font fixés auffi invariablement que
leur intonation , & fi la voix qui les exécute eft jufte
& belle, fi la partie de la déclamation qui appartient
au comptfiteur eft bien achevée, ces airs ont
éneore, il eft vrai, plus ou moins d’effet, félon le
plus ou le moins de talent de Paéteur pour la déclamation
^ mais ils produifent toujours une partie de cet
effet, & l’on ne peut du moins fe méprendre fur leur
caraftère.
Mais le récitatif eft potir ainfi dire tout entier a
la merci des aéleurs. J’ai dit plus haut, que le compofiteur
laiffe à leur difpofition le foin de modifier
jufqu’à un certain point, la valeur & la quantité des
fyilabes, & qu’il fe borne à en défigner la durée relative
, par differentes valeurs de note;. Ainfi le même
morceau de récitatif, exécuté par deux adeurs diffé-
rens, devient plus ou moins lent, plus ou moins
rapide, & reçoit par conféquent deux modifications
très-décifives pour l’effet qu’il doit produire. En fup-
pofant même que ces deux a fleurs donnent aux notes
le même degré de lenteur ou de briéveré, il reliera
encore entre eux une différence plus effentiel le , fi
l’un ne fait que les chanter, & fi l’autre les déclame.
Prenons pour exemple ce trait fi fimple & fi touchant
de Didon,
Ma foeur, embraflez-rnoi je
Mufique. Tomel.
*Z --ÉZZÉZ±
vais trouver enfin le re pos après tant d'alarmes.
Qu’il foit chanté par une aélrice ordinaire dont la
voix foit jufte & jolie, mais qui ne trouve pas dan»
fon ame le fecret d’une déclamation pathétique, nous
ferons émus fans doute ; nous le ferions, même en
n’entendant que les paroles , dans la fituation inté-
reffante où elles font placées ; nous le ferons encore
par les inflexions expreffives & naturelles qu’a fu y
donner le compofiteur, & par la jufbffe qu il a mife
dans la partie de la déclamation qui dépendoit de lui ;
mais cette émotion fera légère, fi la jolie voix ne
fait qu2 chanter, & fi nous entendons toujours, fur
ces touchantes paroles, les notes laut, ut f i ut la , &c.
Qu’une véritable aflrice, qu’une Sainte-Huberti
vienne en fuite réciter ces deux mêmes vers, notre
émotion fera profonde, nos larmes couleront en abondance.
Qu’aura-t-elle donc fait pour produire, avec
les mêmes moyens apparens, une impreffion fi différente
? Elle n’aura pas changé une feule note ; mais
elle les aura fait toutes difparoître fous l’accent d’une
déclamation, d’autant plus déchirante, qu’elle eft fimple
& vraie comme les vers, qu’elle exprime, & comme
le fentiment renfermé dar.s ces vers, hn prononçant
ma ficeur, elle faura donner à ce nom fi doux l’accent
& l’exprefüon de la nature : la rapidité prefqu*inar-
ticulée qu’el'e mettra dans ces deux mots, embraffeç-
nioi, fera fentir l'effort qu’elle fait fur elle-même,
& tout ce qu’a de doux & d’amer pour elle cet embraf-
fement qui fera le dernier. Je vais t ouver enfin, con-
tinue-t-elle ; & dans ces paroles elle met une nuance
de réfol urion & de courage ; mais comment rendre
la manière dont elle exprime le repos qu’elle veut
paraître efpérer ? ou plus tô t , comment ne pas entendre
que ce repos funefte eft celui de ia mort ? Enfin
fa voix s’élevant avec peine, & retombant tout-à-coup
fur ces mots : après tant d'alarmes, nous dit que fon ame
eft affaiffée fons le poids de fes maux, & ramène pour
ainfi dire nos penfées fur tout ce qu’elle a fouffert.
Tout cela nexp’ lqne point ce quM faut fa re pour
atteindre à une déclamation auffi parfaite ; ma-s des
règles vagues & infuffifantes le diraient encore moins,
& ne vaudraient pas le louvenir de cet exce leot modèle.
S’il y a un moyen pour apprendre à fimirer
c’eft d’abandonner, pour ainfi dire, toutes les idées
de l’a rt, & de revenir aux éiémens de la déclamalam
naturelle , qui n’eft autre chofe, fe'on Duclos, qu’aie
affection ou modification qui arrive à notre voix , h. feue
pajfant d'un état tranquille à un état agite , r.o re ame
eft émue de quelque paffion ou de quelque fenwmnî v if y
ou bien, peut-on ajouter, lors qu’après ces agitations,
elle revient à un état doux & tranquille.
Voilà ce que fait la nature ; voici par quel point
de contaô l'art communique avec elle, & va juiqu’à
prendre fa place. « Ces changemens de la voix, con-
F f t