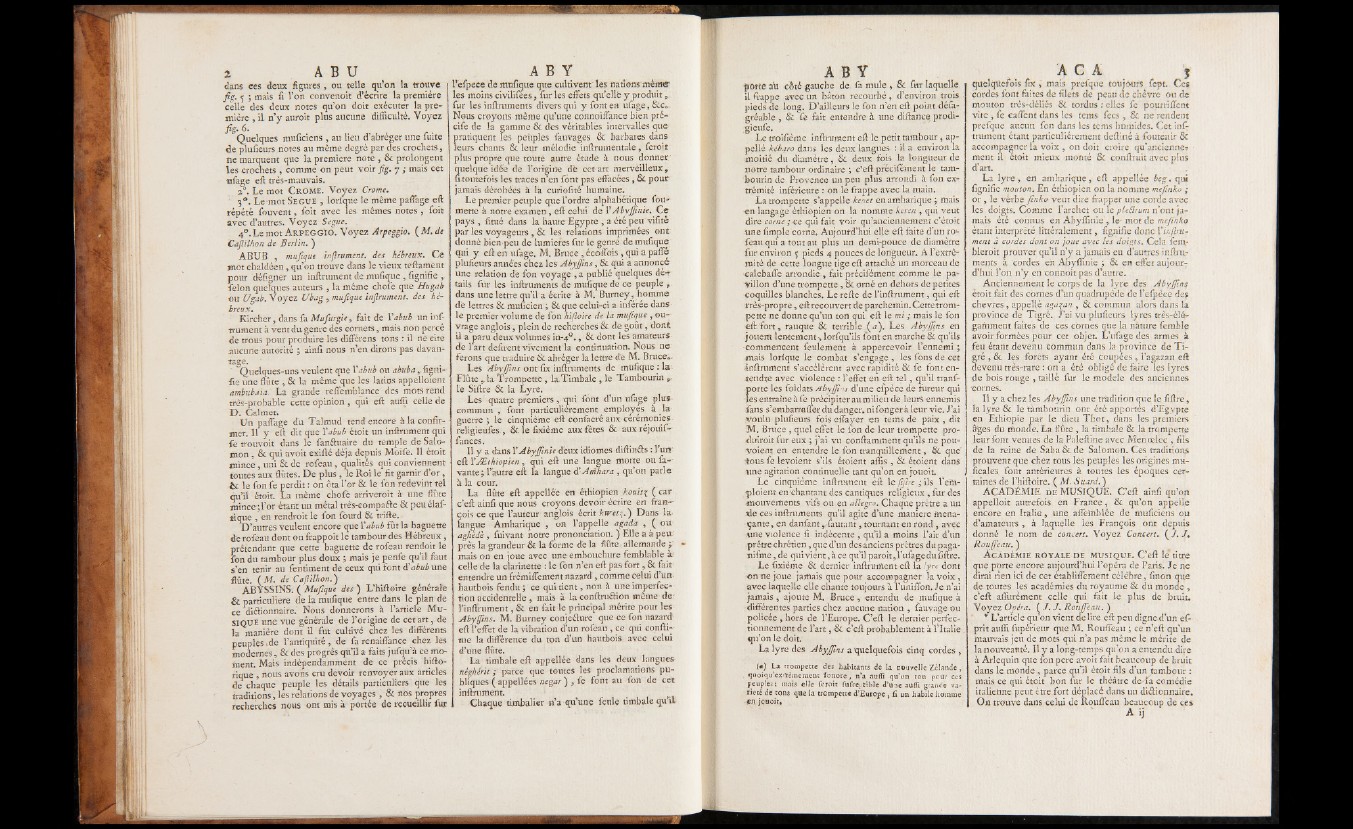
dans ces deux figures, ou telle qu*on la trouve
fig. 5 ; mais fi l’on convenoit d’écrire la première
celle des deux notes qu’on doit exécuter la première
, il n’y auroit plus aucune difficulté. Voyez
figi 6.
Quelques muficiens , au lieu d’abréger une luite
de plusieurs notes au même degré par des crochets,
ne marquent que la première note , & prolongent
les crochets , comme on peut voir fig. 7 ; mais cet
nfage eft très-mauvais.
20. Le mot C rome. Voyez Crome.
30. Le mot Segue , lorfque le même paflage eft
répété fouvent, foit avec les mêmes notes , foi*
avec d’autres. Voyez Segue.
4 ° .Le mot A r p e g g ïO. Voyez Arpeggio. ( M. de
m m ^e Berlin. )
ABUB , mufique injlrument. des hébreux. Ce
mot chaldéen, qu’on trouve dans le vieux teftament
pour défigner un infiniment de mufique , fignifie ,.
félon quelques auteurs , la même choie que Hugab
ou Ugab. Voyez Ubag, mufique injlrument. des hébreux.
. '
Kircher,. dans fa Mufurgie, fait de Vabub un inf-
trument à vent du genre des cornets, mais non percé
de trous pour produire les différens tons : il ne cite
aucune'autorité ; ainfi nous n’en dirons pas davantage.
Quelques-uns veulent que Vabub ou abuba y fignifie
une flûte , & la même que les latins appelloient
ambubaia. La grande reffemblance des mots rend
très-probable cette opinion , qui eft auffi celle de
O . Calmet.
Un paflage du Talmud tendencore à la confirmer.
Il y eft dit que Vabub étoit un infiniment qui
fe trouvoit dans le fânéhiaire du temple de Salomon
, & qui avoit exifté déjà depuis Moïfe. Il étoit
mince, uni & de rofeau, qualités qui conviennent
toutes aux flûtes. De plus , le Roi le fit garnir d’o r ,
t e le fon fe perdit : on ôta l’or & le fôn redevint tel
qu’il étoit. La même chofe arrivèrent à une flûte
mince;l’or étant un métal très-eompaéle & peuélaft
tique , en rendroit le fon fôurd & trifte.
D ’autres veulent encore que Vabub fut la baguette
de roféau dont on frappoit le tambour des Hébreux,
prétendant que cette baguette de rofeau rendoit le
fon du tambour plus doux ; mais je penfe qu’il faut
s’en tenir au fentiment de ceux qui font d'abub une
flûte. ( M. de Cajlillion. J
ABYSSINS. ( Mufique des ) L’hiftoire générale
& particulière de la mufique entre dans le plan de
ce diélionnaire. Nous donnerons à l’article Musique
une vue générale de l’origine de cet art,, de
la manière dont il fut cultivé chez les différents
peuples tde l ’antiquité, de fà renaiffance chez les
modernes, & des progrès qu’il, a faits jufqu’à ce moment.
Mais indépendamment de ce précis hifto-
rique , nous avons cru devoir renvoyer aux articles
de chaque peuple les détails particuliers que les
traditions, les relations de voyages , & nos propres
recherches nous ont mis à portée de recueillir fur
l’efpece de mufique que cultivent les nattons même*
les moins civilifees, fur les effets qu’ellfe y produit,
fur les inftruments divers qui y font en ufage, &c~
Nous croyons même qu’une connoiffance bien pré-
cife de la gamme & des véritables intervalles que
pratiquent les peuples fauvages & barbares dans
leurs chants & leur mélodie inftrumentale, feroit
plus propre que toute autre étude à nous donner
quelque idée de l’origine de cet art mervèilleux,
I fi toutefois les traces n’en font pas effacées, Se pour
jamais dérobées à la curiofité humaine.
Le premier peuple que l’ordre alphabétique fou~
mette à notre examen, eft celui de V Abyjfinie. C e
pays , fitué dans la haute Egypte , a été peu vifitè
par les voyageurs , Se les relations imprimées ont:
donné bien peu de lumières fur le genre de mufique
qui y eft en ufage. M. Bruce, écoflbis, qui a paffè
plufieurs années chez les AbyJJins, Se qui a annonce
une relation de fon voyage , a publié quelques dé-r
tails fur les inftruments de mufique de ce peuple ,
dans une lettre qu’il a écrite à Mi Burney, homme
de lettres & muficien ; Se que celui-ci a inférée dans
le premier volume de fôn hifioire de la mufique , ouvrage
anglois, plein de recherches Se de goût, dont
il a paru deux volumes in-49. , & dont les amateurs
de fart défirent vivement la continuation. Nous ne
ferons que traduire Se abréger la lettre de M. Bruce.-
Les AbyJJins ont fix inftruments de mufique : la-
Flûte,.là Trompette, laTimbale, le Tambourin r
le Siftre & la Lyre.
Les quatre premiers, qui font d’un ufage plus-
commun , font particulièrement employés à la
guerre ; le cinquième eft confacrê aux ceremonies-
religieufës., Se. le fixième aux fêtes & aux réjouift^
fances.
Il y a dans VAbyjfinie deux idiomes diftinéls : l’un'
eft VÆthiopien, qui eft une langue morte ou fa-
vante; l’autre eft la langue (VAmhara , qu’on parle
à la cour.
La flûte eft appellée en éthiopien kouit^ ( car
c’eft ainfi que nous croyons devoir écrire en fran-
çois ce que l’auteur anglois écrit kwet{. ) Dans la
langue Amharique , on l’appelle agadh , ( ou
aghèdè , fuivant notre prononciation. ) Ëllë a à peu;
près la grandeur & la forme de la flûte allemande
mais on en joue avec une embouchure femblable a;
celle de la clarinette : le fôn n’en eft pas fo r t, & fait
entendre un frémiffement nazardcomme celui d’un;
hautbois fendu ; ce qui tient, non à une imperfection
accidentelle, mais à la conftruéfion même de.
l’inftrument, & en fait le principal mérite pour les
Abyffins. M. Burney conjecture que ce fon nazard
eft l’effet de la vibration d’un rofeau , ce qui confti-
tue la différence du ton d’un hautbois avec celui
d’une flûte.
La timbale eft appellée dans les deux langues
néghérit ; parce que tontes les proclamations publiques
(appellées negar ) , fe font au fon de cet
infiniment.
Chaque timbalier n’a qu’une feule timbale qu’il
porte ail côté gauche de fa mule , & fur laquelle
il frappe avec un bâton recourbé , d’environ trois
pieds de long. D ’ailleurs le fon n’en eft point défa-
gréàble , & fe fait entendre à une diftance prodi-
gieufe.
Le troifième infiniment eft le petit tambour, ap-
pelle kébaro dans les deux langues : il a environ la
moitié du diamètre, Se deux fois la longueur de
notre tambour ordinaire ; c’eft préciféftient le tambourin
de Provence un peu plus arrondi à fon extrémité
inférieure : on le frappe avec la main.
La trompette s’appelle kenet en amharique ; mais
en langage éthiopien on la nomme keren , qui veut
dire corne ; ce qui fait Voir qu’anciennement c’étoit
une fimple corne, Aujourd’hui elle eft faite d’un ro<-
feau qui a tout au plus un demi-pouce de diamètre
fur environ 5 pieds 4 pouces de longueur. A l’extrémité
de cette longue tige eft attache un morceau de
calebaffe arrondie , fait précifément comme le pavillon
d’une trompette, & orné en dehors de petites
coquilles blanches. Le refte de l’inftrument, qui eft
très-propre, eft recouvert de parchemin. Cette trompette
ne donne qu’un tort qui eft le mi ; mais le fon
eft. fort, rauqüe & terrible .(<2). Les Abyffins en
jouent lentement-, lorfqu’ils font en marche & qu’ils
•commencent feulement à appercevoir l’ennemi ;
mais lorfque le combat s’engage , les fions de cet
infiniment s’accélèrent avec rapidité Se fe font entendre
avec violence : l’effet en eft t e l , qu’il tranf-
porte les foldats AbyJJins d’une efpèce de fureur qui
les entraîne à fe précipiter au milieu de leurs ennemis
fans s’embarrafîer du danger, ni fongér à leur vie. J’ai
Voulu plufieurs fois effâyer en tems de paix , dit
M. Bruce , quel effet le ion de leur trompette pro-
duiroit fur eux ; j’ai vu conftamrhent qu’ils ne pourvoient
en entendre le fon tranquillement, & que'
tous fe levoient s’ils ètoient affis , & étoient dans
une agitation continuelle tant qu’on en jouoit.
Le cinquième inftru-ment eft le fijlre ; ils l’emploient
en'chantant des Cantiques religieux , fur des
.mouvements vifs ou en allegro. Chaque prêtre a un
-rie ces inftru/nents qu’il agite d’une maniéré menaçante
, en danfant y fautant, tournant en rond , avec
une violence fi indécente , qu’il a moins l’air d’un
prêtre chrétien, que d’un des anciens prêtres du paga-
nifme, de qui vient, à ce qu’il paroît, Image du fiftre.
Le fixième & dernier infiniment eft la lyre dont
on ne joue jamais que pour accompagner la voix ,
avec laquelle elle chante toujours à Punition. Je n’ai
jamais , ajoute M. Bruce , entendu de mufique à
différentes parties chez aucune nation , fàuvage ou
policée, hors de l’Europe. C ’eft le dernier perfectionnement
de l’art, & c’eft probablement à l’Italie,
qu’on le doit.
La lyre des AbyJJins a quelquefois cinq cordes ,
U) La trompette dés habitants de la nouvelle Zélande ,
ejuoiqu’exrtèmement îonore, n’a auffi qu’un ton polir ces
peuples; mais elle feroit fufceptible d’une auffi grande variété
de tons que la trempette d’Europe, fi un habile homme
«en jçuoit«
quelquefois fix , mais prefque toujours fept. Ces
Cordes font faites de filets de peau de chèvre ou de
mouton très-déliés & tordus : elles fe pourriftent
vite , fe caftent dans les tems fées , & ne rendent
prefque aucun fon dans les tems humides. Cet infT
trument étant particuliérement deftiné à foutenir &
accompagner la voix , on doit croire qu’ancienne?
ment il etoit mieux monté & conftruit avec plus
d’art.
La ly r e , en amharique, eft appellée beg% qui
fignifie mouton. En éthiopien on la nomme mefinko ;
or , le vèrbe fin ko veut dire frapper une corde avec
les doigts. Comme l’archet ou le pleftrum n’ont jamais
été connus en Abyffinie‘, le- mot de mefinko
étant interprêté littéralement, fignifie donc Vinfiniment
à cordes dont on joue avec les doigts. Cela fen\-
bleroit prouver qu’il n’y a jamais eu d’autres inftrur
ments à cordes en Abyfîinie ; & en effet aujour^
d’hui l’on n’y en connoît pas d’autre.
Anciennement le corps de la lyre des AbyJJins
étoit fait des cornes d’un quadrupède de l’efpëce deç
chevres , appellé aga^an , & commun alors dans la
province de Tigré. J’ai vu plufieurs lyres très-élégamment
faites de ces cornes que la nâture femble
avoir formées pour cet objet. L’ufage des armes à
feu étant devenu Commun dans la province de T igré
, & les forêts ayant été coupées , l’agazan eft
devenu très-rare : on a été obligé de faire les lyres
de bois rouge , taillé fur le modèle des anciennes
‘cornes.
Il y a chez les AbyJJins une triadition que le fiftre,
la lyre & le tambourin ont été apportés d’Egypte
en Ethiopie par le dieu T h ot, dans les premiers
âges du monde. La flûte , la timbale & la trompette
leur font venues de la Paleftine avec Menoelec , fils
de la reine de Saba oc de Salomon. Ces traditions
prouvent que chez tous les peuples les origines mw-
iicales font antérieures à toutes les époques certaines
de l’hiftoire. ( M. SuardA
ACADÉMIE de MUSIQUE. C e ft ainfi qu’on
appelloit autrefois en France, & qu’on appelle
encore en Italie, une affeimblée de muficiens ou
d’amateurs , à laquelle les François ont depuis
donné le nom de concert. Voyez Concert. ( J. / ,
Roujfeau. )
A cadémie royale de m u siqu e . C ’eft lé titre
que porte encore aujourd’hui l ’opéra de Paris. Je ne
dirai rien ici de cet établiflement célèbre, finon que
de toutes les académies du royaume & du monde ,
c’eft afîiirément celle qui fait le plus de bruit.
Vo yez Opéra. ( / . J. Roujfeau. )
* L ’article qu’on vient déliré eft peu digne-d’un eft
prit auffi fupérieur que M. Rouïïeaii ; ce n’eft qu’un
mauvais jeu de mots qui n’a pas même le mérite de
la nouveauté. Il y a long-temps qu’on a entendu dire
à Arlequin que lonpere avoit fait beaucoup de bruit
dans le monde, parce qu’il étoit fils d’un tambour :
mais ce qui étoit bon fur le théâtre de-fa comédie
italienne peut être fort déplacé dans un diâionnaire.
On trouve dans celui de Rouflêau beaucoup de ces