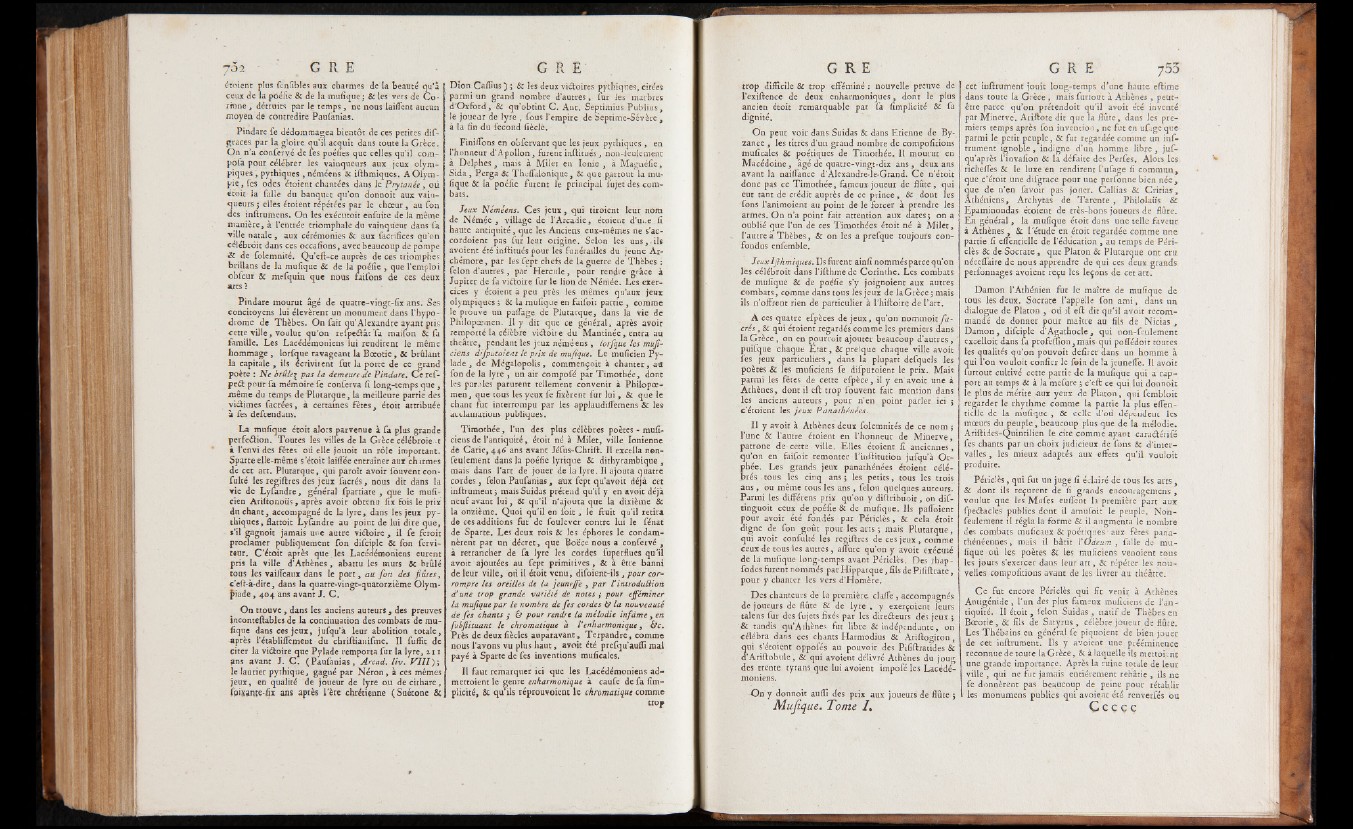
étoient plus fenfibles aux charmes de la beauté qu’à
ceux de la poéfie 8c de la mufique; 8c les vers de C o rinne
, détruits par le temps , ne nous laiflent aucun
moyen de contredire Paufanias.
Pindare fe dédommagea bientôt de ces petites dif-
graces par la gloire qu’il acquit dans toute la Grèce.
On n’a conferyé de les poéfies que celles qu’il com-
pôfa pour célébrer les vainqueurs aux jeux olympiques,
pythiques , néméens Sc ifthmiques. A O lymp
ia , Tes odes étoient chantées dans le Prytanée , où
étoit la falle du banquet qu’on donnoit aux vainqueurs
; elles étoient répétées par le choeur, au fon
des inftrumens. On les exécuroit enfuite de la même
manière, à l’entrée triomphale du vainqueur dans fa
ville natale, aux cérémonies & aux facrifices qu'on
célébrôit dans ces occafions, avec beaucoup de pompe
& de folemnité. Qu’ell-ce auprès de ces triomphes
brillans de la mufique & de la poéfie , que l’emploi
obfcur 8c mefquin que nous raifons de ces deux
a rts}
Pindare mourut âgé de quatre-vingt-fix ans. Ses
concitoyens lui élevèrent un monument dans l’hypo-
drome de Thèbes. On fait qu’Alexandre ayant pris
cette v ille , voulut qu’on refpe&ât fa maillon & fa
famille. Les Lacédémoniens lui rendirent le même
hommage , lorfque ravageant la Bccotie, & brûlant
la capitale , ils écrivirent fur la porte de ce grand
poète : Ne brûleç pas la demeure de Pindare. C e refc
pe<ft pour fa mémoire fe conferva fi long-temps q u e ,
même du temps de Plutarque, la meilleure partie des
victimes facrees, à certaines fê te s , étoit attribuée
à fes defcendans.
La mufique étoit alors parvenue à fa plus grande
perfection. Toutes les villes de la Grèce célébroie t
à l’envi des fêtes où elle jouoit un rôle important.
Sparte elle-même s ’étoit laiffée entraîner aux charmes
de cet art. Plutarque, qui paroît avoir fôuvent con-
fulté les regiftres des jeux facrés, nous dit dans la
vie de Lyfan dre, général fpartiate , que le mufi-
cien Ariftonoiis, après avoir obtenu fix fois le prix
du chant, accompagné de la ly re , dans les jeux pythiques,
ilattoit Lyfandre au point de lui dire que,
s’il gagnoit jamais une autre victoire , il fe feroit
proclamer publiquement fon difciplc & fon fervi-
t«ur. C ’étoit après que.les Lacédémoniens curent
pris la ville d’Athènes, abattu les murs 8c brûlé
tous les vai/Teaux dans le porc, au fon des fiâtes,
cefl-à-dirc, dans la quatre-vingt-quatorzième O lympiade
, 404 ans avant J. C .
On trou ve, dans les anciens auteurs, des preuves
inconteftables de la continuation des combats de mufique
dans ces jeux , jufqu’à leur abolition totale,
après Pétablifiement du chriftianifme. 11 fuffit de
citer la victoire que Pylade remporta fur la lyre, z 11
gns avant J. C . (Paufanias, Arcad. liv. V I I I )$
le laurier pythique, gagné par N éron , à ces mêmes
jeux , en qualité de joueur de lyre ou de cithare,
fpisanjç-fix ans après l ’ère chrétienne (Suétone 6c
Dion Cafiïus ) ; & les deux victoires pythiques, citées
parmi un gfand nombre d’autres, fur les marbres
d’Ox fo rd , & qu’obtint C . Ant. Septimius Publius,
le joueur de lyre , fous l’empire de Septime-Sévère ,
à la fin du fécond fièclé.
Finilfons en obfervant que les jeux pythiques , en
l’honneur d’Apollon, furent inftitués, non-leulemenc
à Delphes , mais à Milet en Ionie , à Magnéfie,
S id a , Perga 8c TliL-fTalonique, & que partout la mufique
Sc la poéfie furent le principal fujet des combats.
Jeux Néméens. Ces je u x , qui tiroient leur nom
de Ném^e , village de l’Arcadie, étoient d‘u».e fi
haute antiquité, que les Anciens eux-mêmes ne s’ac-
cordoient pas fur leur origine. Selon les uns,rils
avoient été inftitués jiour les funérailles du jeune Ar-
chémore, par les fept chefs de la guerre de Thèbes :
félon d’autres, par Hercule, pour rendre grâce à
Jupiter de fa victoire fur le lion de Némée. Les exercices
y étoient à peu près les mêmes qu’aux jeux
olympiques ; 8c la mufique en faifoit partie , comme
le prouve un paifage de Plutarque, dans la vie de
Philopoemen. Il y dit que ce général, après avoir
remporté la célèbre victoire du Mantinée, entra au
théâtre, pendant les jeux néméens , lorfque les muß-
ciens difputoieat le prix de mufique. Le muficien Pylade
, de Mégalopolis, commençoit à chanter, au
fon de la lyre , un air compofé par Timothée, dont
les paroles parurent tellement convenir à Philopoe-,
men, que tous les yeux fe fixèrent fur lu i , & que le
chant fut interrompu par les applaudifTemens & les
acclamations publiques.
Timothée, l’un des plus célèbres poètes - mufi-
ciens de l'antiquité , étoit né à Milet, ville Ionienne
de Carie, 446 ans avant Jéfus-Chrift. Il excella non-
feulement dans la poéfie lyrique 8c dithyrambique ,
mais dans l’arc de jouer de la lyre. Il ajouta quatre
cordes, félon Paufanias , aux fept qu’avoit déjà cet
inftrument ; mais Suidas prétend qu’il y en avoit déjà
neuf avant lu i, Sc qu’il n’ ajouta que la dixième 8c
la onzième. Quoi qu’ il en foit , le fruit qu’il retira
de ces additions fut de foulever contre lui le fénat
de Sparte. Les deux rois 8c les éphores le condamnèrent
par un décret, que Boëce nous a confervé ,
à retrancher de fa lyre les cordçs fuperflues qu’il
avoit ajoutées au fept primitives, & à être banni
de leur ville , où il étoit venu, difoient-ils, pour corrompre
les oreilles de la jeunejfe , par Vintroduction
d’ une trop grande variété de notes ; pour efféminer
la mufique par le nombre de fes cordes & la nouveauté
de fes chants ,• & pour rendre la mélodie infâme , en
fubftituant le chromatique a l ’enharmonique, &c.
Près dedeuxfiècles auparavant, Terpandrc, comme
nous l’avons vu plus haut, avoit été prefqu’auifi mal
payé à Sparte de fes inventions muficales.
Il faut remarquer ici que les Lacédémoniens ad-
mettoient le genre enharmonique à caufe de fa fim-
plicité, 6c qu’ils réprouvoient le chromatique comme
trop
trop .difficile 8c trop efféminé : nouvelle preuve de
l’exiftence de deux enharmoniques, dont le plus
ancien étoit remarquable par fa fimplicité 6c fa
dignité.
On peut voir dans Suidas 8c dans Etienne de Byzance
, les titrés d’un grand nombre de compofîtions
muficales 6c poétiques de Timothée. U mourut en
Macédoine, âgé de quatre-vingt-dix ans , deux ans
avant la naiffance d’Alexandre-le-Grand. C e n’étoit
donc pas ce Timothée, fameux-joueur de flûte, qui
eut tant de crédit auprès de ce prince, 6c dont les
fons l’animoient au point de le forcer à prendre les
armes. On n’a point fait attention aux dates; on a
oublié que l’un de ces Timothées étoit né à M ile t ,
l ’autre à Thèbes, 6c on les a prefque toujours confondus
enfembie.
Jeuxljihmiques. Ils furent ainfi nommés parce qu’on
les célébrôit dans l’ifthmede Corinthe. Les combats
de mufique 8c de poéfie s’y joignoient aux autres
combats, comme dans tous les jeux de la G rè ce ; mais
ils n’offrent rien de particulier à l ’hiftoire de l ’art.
A ces quatre efpèces de jeu x , qu’on nommoit fa crés
,6c qui étoient regardés comme les premiers dans
la G rè c e , on en pourroit ajouter beaucoup d’autres, ‘
puifque chaque E ta t , 6c prefque chaque ville avoit
fes jeux particuliers, dans l a plupart defquels les
poètes 6c les muficiens fe difputoient le prix. Mais
parmi les fêtes de cette efpèce, il y en avoit une à
Athènes, dont il eft trop fouvent fait mention dans
les anciens auteurs, pour n’en point parler ici 5
c ’étoient les jeux Panathénées.
Il y avoit' à Athènes deux folemnités de ce nom 5
l’une 8c l'autre étoient en l’honneur de Minerve,
patrone de-cette ville. Elles étoient fi anciennes,
qu’on en faifoit remonter l’ inftitution jufqu’à O rphée.
Les gratids jeux panathénées étoient célébrés
tous les cinq ans ; les petits, tous les trois
an s , ou même tous les an s , félon quelques auteurs.
Parmi les différens prix qu’on y difiribuoit, on dif-
tinguoit ceux de poéfie 8c de mufique. Ils pafloient
pour avoir été fondés par Périclès, 8c cela écoit
digne de fon goût pour les arts ; mais Plutarque,
qui avoit confulté les regiftres de ces jeux , comme
ceux de tous les autres, aflùre qu’on y avoit exécuté
de là mufique long-temps avant Périclès.. Des rhap-
fodes furent nommés par Hipparque, fils de Pififtrate,
pour y chanter les vers d’Homère.
Des.chanteurs de la première, clafTe , accompagnés
de joueurs de flûte 8c de lyre , y exerçoient leurs
talens fur des fujets fixés par les directeurs dés jeux ;
8c tandis qu’Athènes fut libre 8c indépendante, on
célébra dans ces chants Harmodius 8c Ariftogiton,
qui s’étoient oppofés au pouvoir des Pififtratides 8c
d’Ariftobule, 8c qui avoient délivré Athènes du joug
des trente, tyrans que lui avoient impofé les Lacédémoniens.
O n y donnoit auffi des prix aux joueurs de flûte ;
Mufique. Tome I .
cet infiniment jouit long-temps d’ une haute eftime
dans toute la Grèce , mais furtout à Athènes, peut-
être parce qu’on prétendoit qu’il avoir été inventé
par Minerve. Ariftote die que la flûte, dans les premiers
temps après fon invention, ne fut en ufage que
parmi le petit peuple, 8c fut regardée comme un inftrument
ignoble, indigne d’un homme lib re , juf-
qu’après l'invafion 8c la défaite des Perfes. Alors les
richefTes 8c le luxe en rendirent l’ufage fi commun*
que c’étoit une difgrace pour une perfonne bien n ée ,
que de n’en favoir pas jouer. Callias 8c C r it ia s ,
Athéniens , Archytas de Tarente , Philolaus 8c
Epaminondas étoient de très-bons joueurs de flûte.
En général, la mufique étoit dans une telle faveur
à Athènes , 8c l ’étude en étoit regardée comme une
partie fi effentielle de l’éducation , au temps de Périclès
8c de Socra te, que Platon 8c Plutarque ont cru
nécefTaire de nous apprendre de qui ces deux grands,
perfonnages avoient reçu les leçons de cet art.
Damon l’Athénien fut le maître de mufique de
tous les deux. Socrate l’appelle fon am i, dans un
dialogue de Platon , où il eft dit qu’ il avoit recommandé
de donner pour maître au fils de Nicias ,
Damon, difciple d’Agathocle , qui non-feulement
excelloit dans fa profeffion, mais qui pofledoit toutes
les qualités qu’on pouvoit defirer dans un homme à
qui l’on vouloit confier le foin de la jeuneffe. Il avoit
furtùut cultivé cette partie de la mufique qui a rapport
au temps 8c à la mefure ; c'eft ce qui lui donnoit
le plus de mérite -aux yeux de Platon, qui fembloit
regarder le rhythme comme la partie la plus eflen-
tielle de la mufique , 8c celle d’où dépendent les
moeurs du peuple, beaucoup plus que de la mélodie.
Ariftides-Quintilien le cire comme ayant caraCtérifé
fes chants par un choix judicieux de fons 8c d’intervalles
, les mieux adaptés aux effets qu’il vouloit
produire.
Périclès, qui fut un juge fi éclairé de tous les a r ts ,
8c dont ils reçurent de fi grands encouragemens ,
voulut que les Mufes eufTenc h première part aux
fpeCtacles publics dont il amufoi: le peuple. N on -
feulement il régla la forme 8c il augmenta le nombre
des combats muficaux 8c poétiques • aux fêtes pana-
thénéennes, mais il bâtit VOdeum , falle de mufique
où les poètes 8c les muficiens venoient tous
les jours s’exercer dans leur a r t , 8c répéter les nouvelles
cômpofitions avant de les livrer au théâtre.
C e fut encore Périclès qui fie venir à Athènes
Antigénide, l’ un des plus fameux muficiens de l’antiquité.
Il é to it , félon Su ida s, natif.de Thèbes en
Boeotie, 8c fils de Satyru s, célèbre joueur de flûte.
Les Thébains en général fe piquoient de bien jouer
de cet inftrument. Ils y avoient une prééminence
reconnue de toute la G rè ce, 8c à laquelle ils mettoient
une grande importance. Après la ruine totale de leur 1 ville , qui ne fut jamais entièrement rebâtie , ils ne
fe donnèrent pas beaucoup de peine pour rétablir
les monumens publics qui avoient été renverfés ou