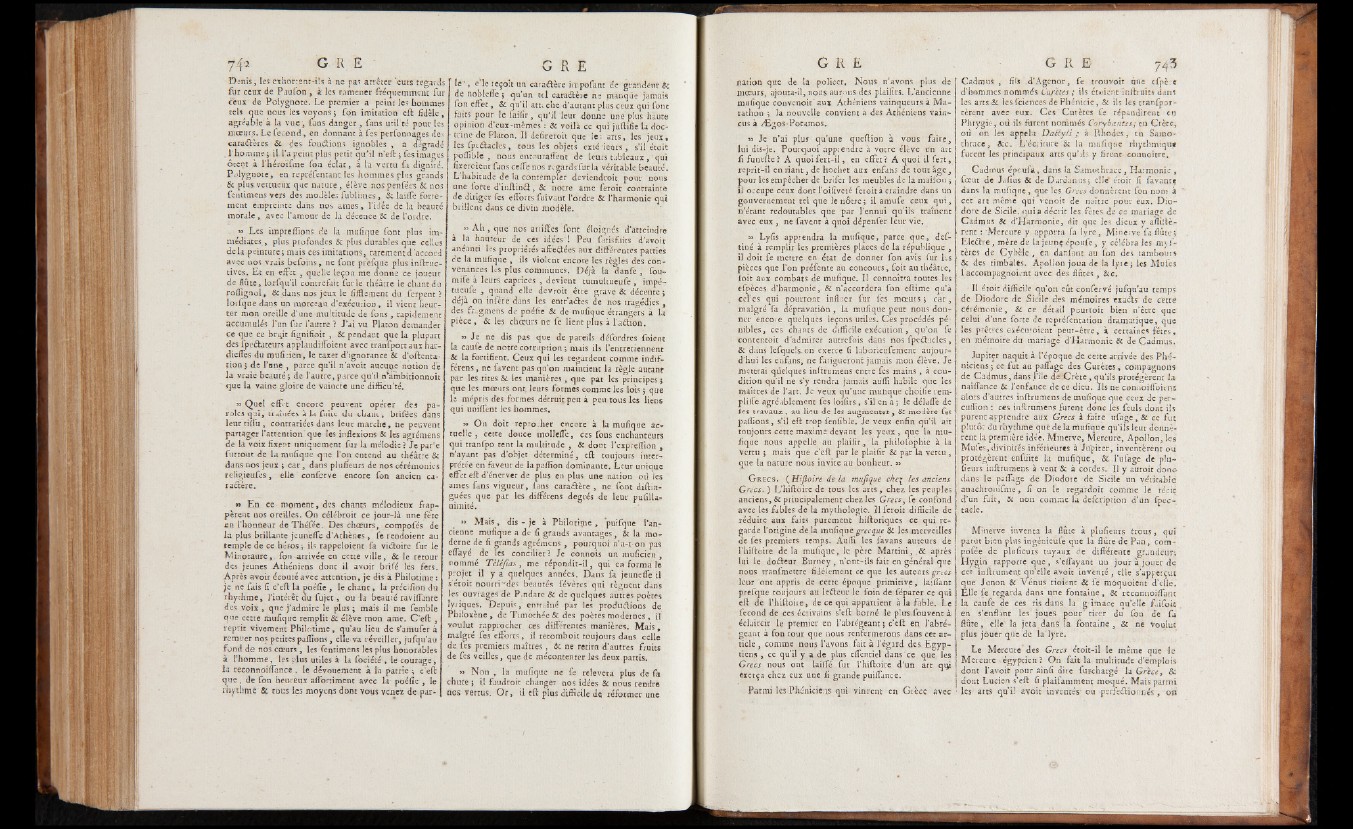
Denis , les cxhonent-ils à ne pas arrêter 'eurs regards
fûr ceux de Paufon , à les ramener fréquemment fur
ceux de Poiygnote. Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons ; fon imitation eft fidèle,
agréable à la vue^ fans danger, fans utilité pour les
mceijrs. Le fécon d , en donnant à fes per fon nages des
caractères Çc des fonctions ignobles , a dégradé
. l'homme.;, il l’a peint plus petit qu'il n’eft ; fes images
ôtent à l’héroïfme fon éc la t, à la vertu f i dignité.
Poiygnote, en repréfentant les hommes plus grands ;
& plus vertueux que nature, élève nospentées & nos
fentimens vers des modèles fublhnes, & lai fié fortement
empreinte dans nos âme s, l'idée de la beauté
morale, avec l’amour de la décence & de l’ordre.
»» Les impie filon s. de fa mufique font plus immédiates,
plus profondes & plus durables que celles
de la peinture ; mais ces imitations, rarement d ’accord
avec nos vrais befoins, ne font prefquc plus inftruc-
tives. E t en effet , quelle leçon me donne ce joueur
de flûte, lorfqu’ il contrefait furie théâtre le chant dû
roflignol, & dans nos jeux le fifflement du ferpent ?
loifque dans un morceau d’exécution, il vient heurter
mon oreille d’une multitude de fon s , rapidement
accumulés l’un fur l’autre ? J’ai vu Platon demander
ce que ce briÿt fignifioit , & pendant que la plupart
des fpe&ateurs applaudifibicnt avec cranfportaux har-
diefles du muficien, le taxer d’ignorance & d’oftenta-
tion ; de l’nne , parce qu’il n’avoit aucune notion dé
la vraie beauté; de l’autre, parce qu’il n^mbitjonnoic
que la vaine gloire de vaincre une difficulté.
» Quel effet encore peuvent opérer des pa-1
rôles qui, traînées à la fuite du chant, brifées dans
leur tiflii, contrariées dans leur marche, he peuvent
partager l’attention'que les inflexions & les agrémens
de la voix fixent uniquement fur la mélodie? Je par'e
furtout de la mufique que l’on entend au théâtre &
dans nos jeux ; c a r , dans plufieurs de nos cérémonies
religieufes, elle confier ve encore fon ancien caractère.
» E n ce moment, des chants mélodieux frappèrent
nos oreilles. On célébroit çe jour-là une fête
en l’honneur de Théfée. Des choeurs, compofés de
la plus brillante jeunefle d’Athènes , fe rendoient au
temple de ce héros ; ils rappeloient fa viétoirc fur le
Minptaure, fon-arrivée en cette v ille , & le retour
des jeunes Athéniens dont il avoir brifé lés fers.
Après avoir écouté avec attention, je dis à Philotime :
je ne fais fi c’eft la poéfîe , le ch an t, la précifion du
rhydhmc, l’intérêt du fu je t , ou la beauté ravîflante
des voix , que j’admire le plus ; mais il me femble
que cette mufique remplit & élève mon ame. C ’eft ,
reprit vivement Philotime, qu’au lieu de s’amufer à
remuer nos petites pallions, elle-va réveiller, jùfqu’au
fond de nos coeurs, les fentimens les plus honorables
à l’homme, lj;s plus utiles à la fociété , le courage,
la reeonnoiffance , le dévouement à la patrie; c’eft
q u e , de fon heureux affortiment avec la poéfîe , le
rhythme & cous les moyens donc vous venez de parle’
, e le reçoit un carà&ère impofant de grandeur Sc
de nobleffe ; qu’un tel ca raâ èie ns manque jamais
fon e ffe t, & qu’il atti che d’autant plus ceux qui font
faits pour lë fa if îr , qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes : St voilà ce qui juftifie la doctrine
de Platon. Il defiretoit que le> arts, les jeux,
les fpt&acles, tous les objets exté ieùrs, s’il étoit
poflible , nous entouraffent de Ieuts tableaux , ' qui
fixercienr fans ceffe nos i\gardsfiirla véritable beauté.
L habitude de la contempler dcviendroic. pour nous
une forte d’in f t in d , & notre ame feroit contrainte
de diriger fes efforts fuivant l’ordre & l’harmonie qui
brillent dans ce divin modèle.
« A h , que nos artiffes font éloignés d’atteindre
à la hauteur de ces idées ! Peu fatisfaits d’avoir
anéanti les propriétés affectées aux différentes parties
de la mufique , ils violent encore les règles des convenances
les plus communes. Déjà la danfe , fou-
mife à leurs caprices , devient tumultueufe , impé-
tueufe , quand elle devroit être grave & décente;
déjà on infère dans les entraxes de nos tragédies ,
des fn.gmens de poéfîe & de mufique étrangers à la
pièce , & les choeurs ne fe lient plus à l'â&ion.
» Je ne dis pas que de pareils défordres foient
la caufe de notre corruption ; mais ils l’entretiennent
& la fortifient. Ceux qui les regardent comme indif-
férens, ne favent pas qu’on maintient la règle autant
; par les rites & les manières, que par les principes ;
que les moeurs ont, leurs formes comme les lois ; que
h mépris fies formes détruit peu à peu tous les lien«
qui unifient les hommes.
>» On doit reproiher encore à la mufique actuelle
, cette douce mollelTe, ces fons enchanteurs
qui tranfpo tent la multitude , & dont l’cxprefiîon ,
n’ayant pas d’objet déterminé, cft toujours interprétée
en faveur de la paffion dominante. Leur unique
effet eft d’énerver de plus en plus une nation où les
aines fans vigueur, fans caractère , ne font diftin-
guées que par les différens degrés de leur publia-
nimité.
** M a is , dis - je à Philotiçne, puifque l’ancienne
mufique a de fi grands avantages, & la moderne
de fi grands agrémens , pourquoi n’a-t-on pas
effayé de les conciliër? Je connois un muficien ,
nommé Téléfias, me répondit-il, qui en forma le
projet il y a quelques années. Dans fa jeunefle il
s’étoit nourri'vdès beautés févères qui régnent dans
les ouvrages dé P.ndarc 8c de quelques autres poètes
lyriques. Depuis, entraîné par les produirons de
Ph iloxène , de Timothée & des poètes modernes , il
voulut rapprocher ces différentes manières. M a is ,
malgré fes efforts, il retômboit toujours dans celle
de fes premiers maîtres , & ne retira d’autres fruits
de fes veilles, que de mécontenter les deux partis.
» Non , la mufique ne fc relèvera plus de fa
chute ; il faudroit changer nos idées & nous rendre
nos vertus. O r , il cft pius difficile dç réformer une
îiation que de la policer. Nous n’avons plus de
moeurs, ajouta-il, nous aurons des plaifirs. L ’ancienne
mufique convenoiriaux Athéniens vainqueurs à M arathon
; la nouvelle convient à des Athéniens vain*-
cus à Ægos-Potamos.
m Je n’ai plus qu’une queftion à vous fairç ,
lui dis-je. Pourquoi apprendre à votre élève un art
fi funefte? A q u o ife r t - il, en effet? A quoi il fert,
reprit-il en r iant, de hochet aux enfans de tout â g e ,
pour les empêcher de brifer les meubles de la maifon ;
il occupe ceux dont l’oifiveté feroit à craindre dans un
gouvernement tel que le nôtre; il amufe ceux qui ,
n’étant redoutables que par l’ennui qu'ils traînent
avec eux , ne favent à quoi dépenfer leur vie.
m Lyfis apprendra la mufique, parce q ue , def-
tiné à remplir les premières places de la république ,
il doit fe mettre en état de donner fon avis fur les
pièces que l’on préfente au concours i foit au théâtre,
foit aux combats de mufique. Il connoîtm toutes les
efpèçes d’harmonie, & n’accordera fon eftime qu’à
cel'es qui pourront inflocr fur fes moeurs; car,
malgré fa dépravation , la mufique peut nous donner
encore quelques leçons utiles. Ces procédés p énibles,
ces chants de difficile exécution , qu'on fe
contentoit d ’admirer autrefois dans nos fpeCtacles,
& dans lefquels..on exerce fi laborieufement aujourd’hui
les enfans, ne fatigueront jamais mon élève. Je
mettrai quelques inftrumens entre fes mains, à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aiiffi habile que les
maîtres de l’art. Je veux qu’une muiique choifie rempli
ffe agréablement fes loifîrs, s’il en a ; le délaffe de
les travaux, au lieu de les augmenter, & modère fes
paffions, s’il eft trop fenfible. Je veux enfin qu’il ait
toujours cette maxime devant les y e u x , que la mufique
no,us appelle au plàifîr , la philofophie à la
vertu ; mais que c ’eft par le plaifîr & par la vertu ,
que la nature nous invite au bonheur. »
G rec s. ( Hîfioire de la mufique che{ les anciens
Grecs. ) L ’hiftôirc de tous les arts, chez les peuples
anciens, & principalement chez les Grecs, fe confond
avec les fables de la mythologie. Il feroit difficile de
réduire aux faits purement hiftoriques ce qui regarde
l’origine de la mufique grecque & les.merveilles
de fes premiers temps. Audi les favans auteurs de
l’hiftoire de la mufique, le père Martini, 8t après
lui le doCteur Burney , n’ont-ils fait en général que
nous rrânfmettre fidèlement ce que les auteurs grecs
lcu*r ont appris de cette époque primitive, laiflant
prefque toujours au lcéleur le foin de féparer ce qui
cft de l’hiftoire, de ce qui appartient à la fable. Le
fécond de ces écrivains s’eft borné le plus.fou vent à
éclaircir le premier en l’abrégeant ; c’eft en l’abrégeant
à fon tour que nous renfermerons dans cet art
ic le , comme nous l’avons Fait à l’égard des E g yp tiens
, ce qu’il y a de plus cflentiel dans ce que les
Grecs nous ont laiffé fur l’hiftoire d’un art qiji
exerça chez eux une fi grande puiffance.
Parmi les Phéniciens qui vinrent en Grèce avec
CadmuS , fils d’Agenor, fe trouvoit âne cfnè e
d’hommes nommés Cu/etes ; ils étcienrinftruits dans
les arts. & fesfciences de Phénicie, & ils les tranfpor-
tèrent avec eux. Ce s Curètes fe répandirent en
Phrygie, où ils furent nommés Coryhantes/ en Crète,
où on les appela Dailyli y à Pdiodes, en Sarno-
thrace, Scc. L ’écjinire & la mufique rhythmiqut
furent les principaux arts qu’ ils y firent connoîtrc.
Cadmus épeufa, dans la Samothrnce, Harmonie ,
foeur de Jafius & de Dardanus; elle' étoit fi favante
dans la mufique, que les Grecs donnèrent fon nom à
cet art même qui venoit de naître pour eux. D io -
dorc de Sicile, qui a décrit les fêtes de ce mariage de
Cadmus & d’H armonie, dit que les dieux y affilièrent
: Mercure y apporta fa ly r e , Minerve fa flûte;
Elcé tre , mère de la jeunç époufe, y célébra Jes m yf-
tères de Cybè le , en danfant au fon des tambours
& des timbalfes. Apollon joua de la lyre ; les Mufcs
1 accompagnoknt avec des flûtes , &c.
Il étoit difficile qn’on eût confervé jufqu’au temps
de Diodorc de Sicile des mémoires exaifts de cette
cérémonie, & ce détail pourvoie bien n’ être que
celui d’une forte de repréfentation dramatique, que
les prêtres exécutoient peut-être, à certaines fêtes,
en mémoire du mariage d’Harmonie & de Cadmus.
Jupitçr naquit à l’époque de cette arrivée des Phéniciens;
ce fut au paffage des C u rètes, compagnons
de Cadmus,dansJ’iie de-C r è te , qu’ils protégèrent la
naiffance & l’enfance de ce dieu. Ils ne connoiffoicns
alors d’autres inftrumens de mufique que ceux de per-
cullïon : ces inftrumens furent donc les feuls dont ils
purent apprendre aux Grecs à faire u fage , & ce fut
plutôt du rhythme que de la mufique qu’ils leur donnèrent
la première idée. Minerve, Mercure, Apollon, les
Mutes, divinités inférieures à Jupiter, inventèrent ou
protégèrent enfuite la mufique, & l’ufage de plu-
fieurs inftrumens à vent & à cordes. Il y auroit donc-
dans le paffage de Diodore de Sicile un véritable
anachronifme, fi on le regardoit comme le réciç
d’un fait, St non comme la defeription d’un fpcc-
tacle.
Minerve inventa la flûte à plufieurs trou s, qui
parut bien plus ingénieule que la flûte de Pan, cora-
pôfée de plufieurs tuyaux de différente grandeur;
Hygin rapporte que, s’effayant un jour à jouer de
cér infiniment qu’elle avoir inventé , elle s’apperçut
que Junon & Vénus rioient & fe môquoient d’elle.
Elle fe regarda dans une fontaine, & reconnoiffant
la caufe de ces ris dans la grimace qu’elle faifoic
en s’enflint les joues p o u r'tirer du fon de fa
flû te , elle’ la jeta.dans la fontaine , & ne voulut
plus jouer que de la lyre.
Le Mercure des Grecs étoit-il le même que le
Mercure égyptien ? On fait la multitude d’emplois
dont l’avoir pour ainfi dire furchargé la Grèce, &
dont Lucien s’eft fi plaifamment moqué. Mais parmi
les arts qui! avoir inventés’ ou perfectionnés, on