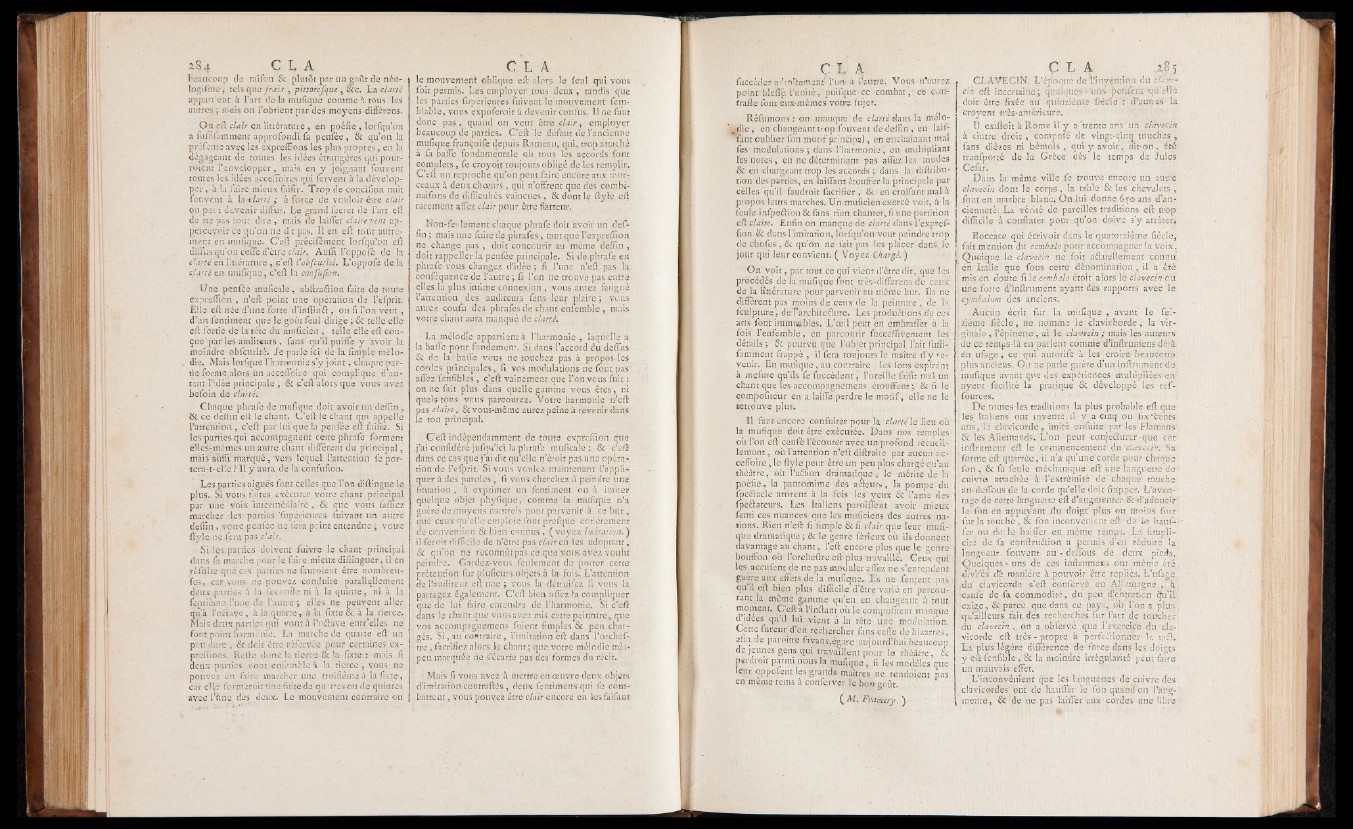
284 C L A
beaucoup de raifon & plutôt par un goût de néo-.
logifme i tels que frais , pittorefque , ©te. La clarté
appart'ent à l’art de la mufique comme à tous les
autres ; mais on l’obtient par des moyens différens.
On eff clair en littérature , en poéfie , lorfqu’on
a fuffifamment approfondi fa penfée, & qu’on la
pr-Mcnte aveç les expreffions les plus propres, en la
dégageant de toutes les idées étrangères qui pour-
roient l’envelopper, mars en y joignant fouvent
toutes les idées acceiToires qui fervent à la développ
e r , à la faire, mieux faifir. Trop de coneifion nuit
foilvenf à la 'clarté ; à force de vouloir être clair
on peut devenir diffus. Le grand fecret de l’art eff
de ne pas tout dire , mais de laiffer claire vent ap-
perçevoir ce qü’on ne, d't pas. lie n eff tout autrement
en mufique.' C ’eft précifément lorfqu’on eff
diffus qu’on ceffe d’être clair. Auffi Toppofé de la
clarté en littérature , c ’eff Cobfcurite. L’oppofé de la
clarté en mufique, c’eff la confujîon.
Une penfée muficale, abftra&ion faite de toute
expreffien , n’eft point une opération de l’efprit.
Elle eff née d’une forte d’inffinél, ou fi l’on v e u t ,
d’un Sentiment que le goût feu! dirige ; & telle elle
eff fortiè de là tête du muficien , telle elle eff conçue
par les auditeurs , fans qu’il puiffe y avoir, la
moindre obfcuritê. Je parle ici de la fimple mélo--
die. Mais lorfque l’harmonie s’y joint, chaque partie,
forme alors un acceffoire qui complique d’autant
l’idée principale, & c’eff alors que vous avez
befoin de clarté.
Chaque phrafe de mufique doit avoir un dèffin ,
& ce dèffin eff le chant. C ’eff le chant qui appelle
l’attention , c’eff par lui que la penfée eff faifie. Si
les parties qui accompagnent cette phrafe forment
elles-mêmes un autre chant différent du principal,
mai:> auffi. "marqué, vers lequel ^attention fe portera
t-elle ? Il y aura de la confufion.
Les parties aiguës font celles que l’on diftingue le
plus. Si vous faites exécuter votre chant principal
par une voix intermédiaire, & que vous famez
marcher les parties ‘fupérieiires fuivant un autre
deflin, votre penfée ne fera peint entendue ; votre
ffyle.ne fera pas clair.
Si les parties doivent fuivre le chant principal
dans fa marche pour le faire mieux diffinguer, il en
rémi te■ ■ que ces parties ne fauroient être nombreu-
fes, car vous ne pouvez conduire . parallellement
deux parties à la fécondé ni à la quinte, ni à h
feptième. l’une de■ fautre ; elles ne peuvent aller
qu’à TcClaye, à la quarte, à la fixte & à la tierce.
Mais deux parties qui vont à l’o&àve entr’elles ne
font point harmonie. La marche de quarte eff un
peu dure , & doit être réfervée pour certaines ex-
preffîons. Relie donc la tierce & la fixte : mais fi
deux parties vont enfemble à la tierce , vous ne
pouvez en faire marcher une trôifième à la fixte,
car elle formeroit une fuite de quorresou de quintes
avec Finie des deux. Le mouvement contraire ou
C L A
le mouvement oblique eff alors le feul qui vous
foit permis. Les employer .tous deux , tandis, que
les parties fupérîeures fuivent le mouvement fem-
blable, vous expoferoit à devenir confus. Il ne faut
donc pas, quand on veut être clair, employer
beaucoup de parties. C ’eft le défaut de l’ancienne
mufique françoife depuis Rameau, qui, trop attaché
à fa baffe fondamentale ait tous les accords font
complets, fe croyoit toujours obligé de les remplir.
C ’eff un reproche qu’on peut faire encore aux morceaux
à deux choeurs , qui n’offrent que des combi-
naifons de difficultés vaincues, & dont le ffyle eff
rarement affez clair pour être flatteur.
Non-fe*. lement chaque phrafe doit avoir un def-
fin; mais une fuite de phrafes, tant que l’èxprefîion
ne change pas , doit concourir au même deflin ,
doit rappeller la penfée principale. Si de phrafe en
phrafe vous changez d’idée ; fi l’une n’eft pas la
conféquence de l’autre ; fi l’on ne trouve pas entre
elles la plus intime connexion , vous aurez fatigué,
l’attention des auditeurs fans leur plaire ; Vous
aurez coufu des phrafes de chant eniemble , mais
votre chant aura manqué de clarté.
La mélodie appartient à l’harmonie , laquelle a
la baffe pour fondement. Si dans l ’accord du deffus
& de la-baffe-vous ne touchez pas à propos les
cordes principales, fi vos modulations ne font pas1
affez fenfiblss , c’eft vainement que l’on vous fuit :
on ne fait plus dans quelle gamme vous êtes, ni
quels tons vous parcourez. Votre harmonie n’eft
pas claire, & vous-même aurez peine à revenir dans
le ton principal.
C ’eft indépendamment de toute exprefiion que
j’ai confidéré jüfqu’ici la phrafe muficale ; & c’eff
dans ce casque j’ai dit qu’elle n’émit pas une opération
de l’efprit. Si vous voulez maintenant l’appliquer
à des paroles, fi vous cherchez à peindre une
fituation, à exprimer un fentiment ou à imiter
quelque objet phyfique, comme la mufique n’a
guère de moyens naturels pourparvenir à ce b u t,
que ceux qu’elle emploie font prefque entièrement
de convention & bien connus , (v o y e z Imitation.)
il feroit difficile de n’être pas clair en les adoptant,
& qu’on ne reconnût pas ce que vous avez voulu
peindre. Gardez-vous feulement de porter cette
prétention fur plufieurs objets à la fois. L’attention
de l’auditeur eff une ; vous la déta,liiez fi vous la
partagez egalement. C’eff bien affez la compliquer
que de lui faire entendre de l’harmonie. Si c’eff
dans le chant que vous avez mis cette peinture, que.
vos açcompagnemens foient Amples & peu chargés.
Si, au contraire , l’imitation eff dans l’orcfief*
tre,. fa cri fie z alors le chant; que. votre mélodie très-
peu marquée ne s'écarte pas des formes du récit.
« Mais fi vous avez à mettre en oelivre deux objets
d’imitation ccntraftés, deux fentimens qili fe combattent
, vous pouvez être clair encore en les faifaat
C L A
fuccéder adroitement l’iifi'à l’autre. Vous n*aurez
point blefle. l ’unité, puifque ce-combat,' ce co'n-
frafte font eux-mêmes votre fujer.
Réfumons: on manque de clarté dans la mélo-
&die , en changeant trop fouvent de défian , en b iffant
oublier fon motif principal, en enchaînant mal
fes modulations; dans l’harmonie j en multipliant
lés notes , en ne déterminant pas affez les modes
& en chargeant trop les accords ; dans la cliftribu-
tion des parties, en laiffant étouffer la principale par
celles qu’il faudrbit facrifiér , & en crqifant mal à
propos leurs marches. Un-muficien exercé voit, à la
feule infpeftion & fans rien chanter, fi une partition
eff claire. Enfin on manque de clarté dans l’expref-
fion & dans l imitation, l'orfqu’on veut peindre trop
de cliofes , & qu’on ne fait pas les placer dans7 le
jour qui leur convient. (V o y e z Chargé. )
On v o it, par tout ce qui vient d’être dit, que les
procédés de la mufique font très-différens de ceux
de la littérature pour parvenir au même but. fis ne
diffèrent pas moins de ceux de la peinture, de la
fculpture, de Farchiteâure. Les productions de ces
arts font immuables. L ’oeil peut en embraffer à la
fois l’enfemble, en parcourir fueceflivement les
détails ; & pourvu que l’objet principal l’ait fuffî-
faminent frappé , ■ il fera toujours le maître d'y revenir.
En mufique , au contraire , les fous expirent
à mçfure qu’ils fe fuccèdent, l’oreille faifit mal un
chant que les accompagnemens étouffent ; & fi le
compofitéur en a laifté perdre le motif, elle ne le
retrouve plus.
Il faut encore eonfultër pour la clarté lé lieu où
la mufique doit être exécutée. Dans nos temples
où‘l’on eff çenfé l’écouter avec un profond recueillement
, où l’attention n’eft diftraite par aucun ac-
ceffoire , le ftyle peut être un peu plus chargé qu’au
théâtre, où l’aClion dramatique, le mérite de la
poéfie, la pantomime des atteur;,, la pompe du
fpeChvele attirent à la fois les yeux & l’âme des
fpeffateürs. Les Italiens paroiffènt avoir mieux
fend ces nuances que les muficieris des autres nations.
Rien n’eft fi fimple & fi clair que leur mufi-
qtie dramatique; & le genre férieux où ils donnent
davantage au chant, l’eft encore plus que le genre
bouffon où l’orcheffre eff plus travaillé. Ceux qui
les accident de ne pas moduler aflez ne s’entendent
guère aux effets de la mufique. .Iis, ne fente,nt pas j
qu’il eff bien plus difficile d’être varié en parcourant
la même gamme qu’en en changeant à tout
moment. C ’eft à Pinftant où le compofitéur manque
d idées qu’il lui vient à la tête une modulation.
Cette fureur d’en rechercher fans ceffe de bizarres,
afin de paroître favans,égare aujourd’hui beaucoup
de jeunes gens qui travaillent pour le théâtre, &
perdroit parmi nous la mufique, fi les modèles que .
leur Qppofent les grands maîtres ne tendoient pas
en même te,ms à conferver le bon goût.
( hi. Framery. )
C L A .285
CLAVECIN. L’époque de l’invenfton du clavecin
eff incertaine'; quelques- uns penfehî 'qù’elic
doit être fixée au quinziéme fiècle : d’autres la
croyent très-antérieure.
Tl exïftoit à Rome il y a ‘trente ans un clavecin
à cintre droit , compofé de vingt-cinq touches ,
fans dièzes ni bémols , qui y avoit, dit-on , été
tranfporté de la Grèce dès le temps de Jules
Cefar.
Dans la même ville fe trouve encore un autre
clavecin dont le corps, la table & les chevalets ,
font en marbre : blanc; On lui donne 650 ans d’ancienneté.
Là vérité de pareilles traditions eff trop
difficile à conftater pour qu’on doive s’y arrêter.
Boccace qui écrivoit dans le quatorzième fiècle,
■ fait mention du cenibàlo pour accompagner la voix.
‘ Quoique le cla-veciti ne foit aétuellement 'connu
; én Italie que fous cette dénomination , il a été
■ mis en doute fi le cembalo ëtoit alors lé clavecin ou
une forte d’inftrument ayant des rapports avec le
• eyrnbalurn des anciens.
Aucun, écrit fur là mufique , avant le fei-
‘ ziênie fiècle, ne nomme le clavichorde , la vir-
j giiiale | l’épinette , «i le clavecin ; mais les auteurs
de ce temps-là en parlent comme d’inffrum'ens déjà
en ufage, ce qui autorife à les croire beaucoup
plus anciens. On ne parle guère d’un infiniment de,
mufique avant que des expériences multipliées en
ayent facilité la pratique & développé les ref-
fources. '
De toutes les traditions la plus probable eff que
les Italiens ont inventé, il y a cinq ou fix'cents
ans, le clàvicorde , imité en fuite par les Flanians
& les Allemands. L’011 peut ebnjeéhirer que ce t-
inftrument eff le commencement du clavecin. Sa
forme eff quarrée , il n’a qu’une corde pour chaque
fon , & fa feule méchanique eff une languette de'
cuivre attachée à l’extrémité de chaque' touche
au-deffous de la corde qu’elle doit frapper. L ’avan--
tagè de cette languette eft d’augmenter & d’adoucir
le ; fon en appuyant du doigt" plus ou moins fort
fur la touche , & fon inconvénient eff ds ie hàiif- -
fer ou de le baiffer en meme temps. La fimpli-
cité de fa cônffruétion a permis d’en réduire la
longueur fouvent au - deffous de deux pieds.,
Quelques-uns de ces infini mens ont .même été,
divifés dé manière à pouvoir être repliés. L’ufage
,du clàvicorde s’eff conferyp., en Allemagne , à
‘caufe de fa commodité, du peu d’entretien ^u’il
exige, & parce que dans ce pays, où- l’on a plus
iqu’ailleurs fait des recherches fur l’art de toucher
du clavecin, on a obfervé que L’exe(icice du eia-
vîcorde eff très - propre à perfectionner lé "taCl.
Là plus légère différence de‘ force dans les doigts
y èff fenfible , & la moindre irrégularité peut faire
un mauvais effet.
L’inconvénient que les languettes de cuivre dés
! clavicordes ont de hàufler le fon quand on l’aug-
; mente, & de ne pas laiffer aux cordes une libre