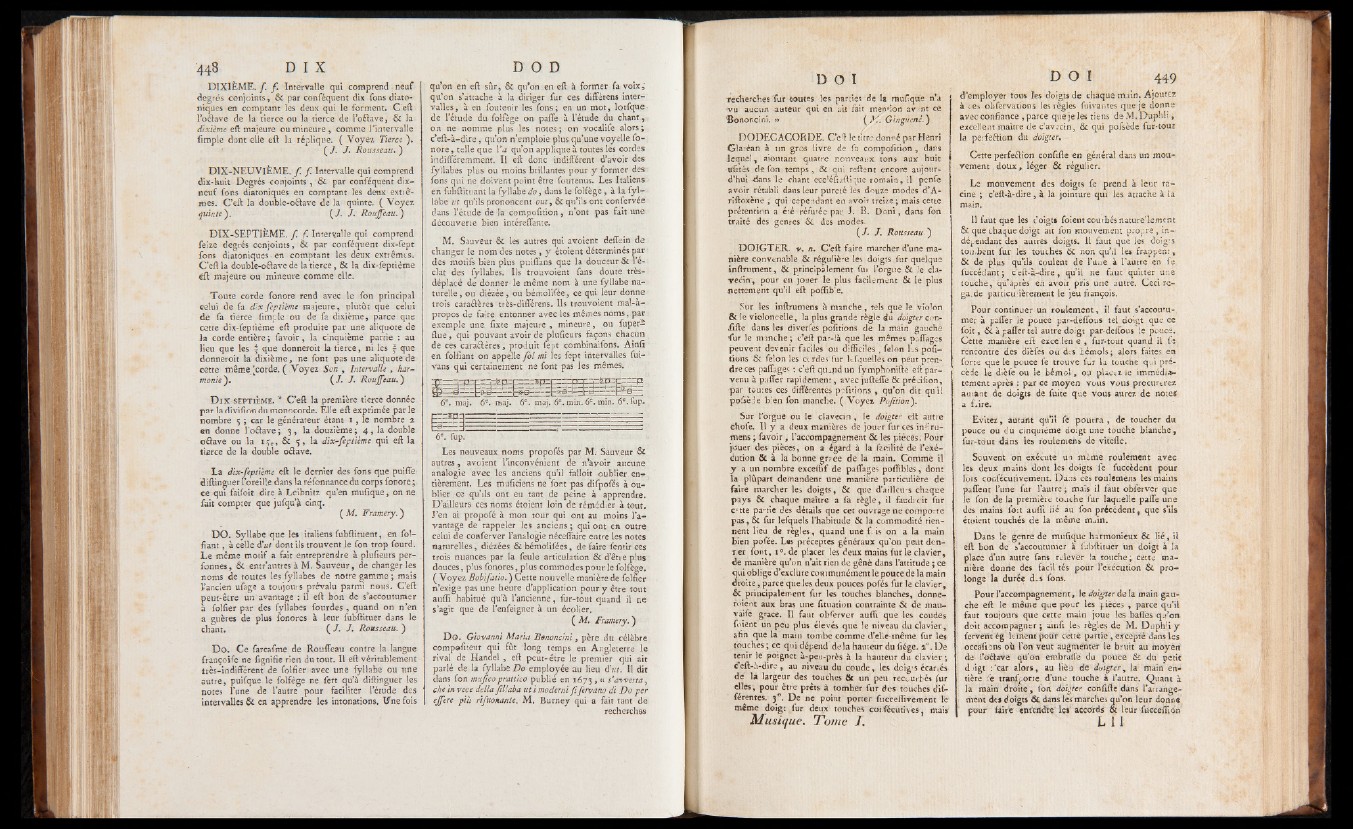
448 D I X
DIXIÈME, ƒ. ƒ. Intervalle qui comprend neuf
degrés conjoints, & par conféquent dix fons diatoniques
en comptant les deux qui le forment. C'eft
l’oélave de la tierce ou la tierce de l’oôave, & la
dixième eft majeure ou mineure, comme l’intervalle
(impie dont elle eft la réplique. ( Voyez, Tierce ).
( 7. J. Rousseau. )
DIX-NEUVIÈME, f . f . Intervalle qui comprend
dix-huit Degrés conjoints , & par conféquent dix-
neuf fons diatoniques en comptant les deux exttê'-
mes. C ’eft la double-o&ave de la quinte. ( Voyez
quinte'). - ' ( J. J. Roujfeau.)
DIX-SEPTIÈME, f i f . Intervalle qui comprend
feize degrés conjoints, & par conféquent dix-fept
fons diatoniques - en comptant les deux extrêmes-.
C ’eft la double-o&ave de la tierce, & la dix-feptième
eft majeure où mineure comme elle.
Toute corde fonore rend avec le fon principal
celui de fa dix feptième majeure, plutôt que celui
de fa tierce fimjle ou de fa dixième, parce que
cette dix-feptième eft produite par une aliquote de
la corde entière ; favoir, la cinquième partie : au
lieu que les ~ que donneroit la tierce, ni les f que
donneroit la dixième, ne font pas une aliquote de
cette même [corde. ( Voyez Son , Intervalle , harmonie),
(/ . J. Roujfeau.)
D i x septième. * C ’eft la première tierce donnée
par la divifion du monocorde. Elle eft exprimée par le
nombre 3 ; car le générateur étant i , le nombre 2
en donne l'oélave ; 3 , la douzième ; 4 , la double
oftave ou la i.çe> & la dix-feptième qui eft la
tierce de la double oélave.
La dix-feptième eft le dernier des fons que puiffe-
diftinguer l’oreille dans la réfonnance du corps fonore;
ce qui faifoit dire à Leibnitz qu’en mufique, on ne
fait compter que jufqu’à cinq.
(M. Framery.)
DO. Syllabe que les italiens fubftituent, en fol-
fiant, à celle d’ut dont ils trouvent le fon trop fourd.
Le même motif a fait entreprendre à plufieurs per-
fonnes, & entr’autres à M. Sauveur, de changer les
noms de toutes les fyllabes de notre gamme ; mais
Pancien ufage a toujours prévalu parmi nous. C ’eft
peut-être un avantage : il eft bon de s’accoutumer
à folfier par des fyllabes lourdes, quand on n’en
a guères de plus fonores à leur fubftituer dans le
chant. ( / . ^ Rousseau. )
D o . Ce farcafme de Rouffeau contre la langue
françoife ne lignifie rien du tout. Il eft véritablement
très-indifférent de folfier avec une fyliabe ou une
autre, puifque le folfège ne fert qu’à diftinguer les
notes l’une de l’autre pour faciliter l’étude des
intervalles & en apprendre les intonations. Une fois
D O D
qu’on en eft sûr, & qu’on en eft à former fa voix,'
qu’on s’attache à la diriger fur ces différens intervalles,
à en foutenir les fons; en un mot, lorfque
de l’étude du folfège on paffe à l’étude du chant,
on ne nomme plus les notes; on vocalife alors;
c’eft-à-dire, qu’on n’emploie plus qu’une voyelle fo-
nore, telle que Va qu’on applique à toutes lès cordes
indifféremment. Il eft donc indifférent d’avoir des
fyilabes plus ou moins brillantes pour y former des
fons qui ne doivent point être foutenus. Les Italiens
en fubftituant la fyliabe do, dans le folfège, à la fy l-
labe ut qu’ils prononcent out, & qu’ils ont confervée
dans l’étude de la compofition , n’ont pas fait une
découverte bien intéreflante.
M. Sauveur & les autres qui avoient deffein de
changer le nom des notes, y étoient déterminés par
des motifs bien plus puiffans que la douceur & l’éclat
des fyllabes. Ils trouvoient fans doute très-
déplacé de donner le même nom à une fyliabe naturelle
, ou diézée, ou bémolifée, ce qui leur donne
trois caraftères très-différens. Ils trouvoient mal-à-
propos de faire entonner avec les mêmes noms, par
exemple une fixte majeure , mineure, ou fuper-
flue, qui pouvant avoir de plufieurs façons chacun
de ces cara&ères, produit fept combinaifons. Ainfi
en folfiant on appelle fol mi les fept intervalles fui-
vans qui certainement ne font pas les mêmes.
6e. ma}. 6e.; maj. 6e. maj. 6e. min. 6e. min. 6e. fup.
6e. fup. >
Les nouveaux noms propofés par M. Sauveur &
autres, avoient l’inconvénient de n’avoir aucune
analogie avec les anciens qüfil falloit oublier entièrement.
Les muficiens ne font pas difpofés à oublier
ce qu’ils ont eu tant de peine à apprendre.
D ’ailleurs ces noms étoient loin de rémédier à tout.
J’en ai propofé à mon tour qui ont au moins l’avantage
de rappeler les anciens ; qui ont en outre
celui de conferver l’analogie néceffaire entre les notes
naturelles, diézées & bémolifées, de faire fentir ces
trois nuances par la feule articulation & d’être plus
douces, plus fonores, plus commodes pour le folfège.
( Voyez Bobifatio. ) Cette nouvelle manière de folfier
n’exige pas une heure d’application pour y être tout
aulîi habitué qu’à l’ancienne, fur-tout quand il ne
s’agit que de l’enfeigner à un écolier.
( M. Framery. )
D o . Giovanni Maria Bononcini, père dû célèbre
compofiteur qui fût long temps en Angleterre le
rival de Handel, eft peut-être le premier qui ait
parlé de la fyliabe Do employée au lieu d'ut. 11 dit
dans fon muficoprattico publié en 1673 > “ s’avverta,
che in vece délia fillaba ut i moderni fifirvano di Do per
ejfere piu rifuonanle. M. Burney qui a fait tant de
recherches
D o 1
•recherches fur toutes les parties de la mufique n’a
vu aucun -auteur qui en ait fait menton av nt ce
Bonor.cini. » •( Af Gmgùcnè.)
DODECACORDE. C ’eft le titre donné par Henri
Glaréan à un gros livre de fa compofition , dans
lequel., aioutant quatre nouveaux tons aux huit
ufités de fon temps , & qui reftent encore aujourd’hui
-dansle chant ecc’.éfiaftiqiie romain, il penfe
avoir rétabli dans leur pureté les douze modes d’A-
riftoxène , qui cependant en avoir treize; mais cette
prétention a été réfutée par. J. B. Doni, dans fon
traité des genres & des modes.
(A A Rousseau.)
DOIGTER, v. n. C ’eft faire marcher d’une manière
convenable & régulière les doigts fur quelque
infiniment, & principalement fui l’orgue & le clavecin',
pour en jouer le plus facilement & le plus
.nettement qu’il eft poflib'e.
Sur les inftrumens à manche, tels que le violon
& le violoncelle, la plus grande règle du doigter con-
iifte dans les diverfes pofitions de la main gauche
fur le manche ; c’eft par-là que les mêmes partages
peuvent devenir faciles ou difficiles , félon h s pofitions
& félon les ctrdes fur kfquelles on peut prendre
ces paffages : c’eft qu^id un fymphoriifte eft parvenu
à paffer rapidement, avec jufteffe & précifion,
par toutes ces différentës polirions , qu’on dit qu’il
pofsède bien fon manche. ( Voyez Pofition).
Sur l’orgue ou le clavecin , le doigter eft autre
éhofe. Il y a deux manières de jouer fur ces in fi rumens
; favoir , l’accompagnement & les pièces: Pour
jouer des pièces, on a égard à la facilité de l’exé-
dution & à la bonne gr? ce de la main. Comme il
y a un nombre exceftif de paffages poflibles, dont
la plûpart demandent une manière particulière de
faire marcher les doigts, & que d’aillcu-s chaque
pays & chaque maître a fa règle, il faudicit fur
c~tte pa-tie des détails que cet ouvrage ne comporte
pas, & fur lefquels l’habitude & la commodité tiennent
lieu de règles, quand une f . fis on a la main
bien pofée. Les préceptes généraux qu’on peut donner
font, i° . de placer les deux mains furie clavier,
de manière qu’on n’ait rien de gêné dans l’attitude ; ce
qui oblige d’exclure communément le pouce de la main
droite, parce que les deux pouces pofés fur le clavier,
& principalement fur les touches blanches, donne-
roient aux bras une fituation contrainte & de mau-
vaife grâce. Il faut obferver aufli que les coudes
foient un peu plus élevés que le niveau du davier,
afin que la main tombe comme d’elie-même fur les
touches ; ce qui dépend delà hauteur du fiége. a°. De
tenir le poignet à-peu-près à la hauteur du clavier ;
c’eft-à-dire, au niveau du coude, les dcig'S écartés
de la largeur des touches 6c un peu recourbés fur
elles , pour être prêts à tomber fur des touches différentes.
3®. De ne point porter fucceflivement Je
même doigt fur deux touches coï.fécutives, mais
Musique. Tome T.
D O I 449
d’employer tou« tes doigts de chaque main. Ajoutez
à ces obfervations les règles fuivantes que je donne
avec confiance , parce que je les tiens de M.Duphli,
excellent maître de c'avecin, &. qui pofsède fur-tout
la perfection du doigter.
Cette perfeélîon confifte en général dans un mouvement,
doux, léger & régulier.
Le mouvement des doigts fe prend à leur racine
; c’eft-à-dire, à la jointure qui les attache à ia
main.
11 faut que les doigts foient courbés nature'lement
& que chaque doigt ait fon mouvement propre, indépendant
des autres doigts, il faut que les doigrs
tombent fur les touches &, non quM les frappenr,
& de plus qu’ils coulent de Tune à l ’autre en fe
fuccédant ; c'eft-à-dire, qu’il ne faut quitter une
touche, qu’àprès en avoir pris une autre. Ceci re-
ga.de particufièrement le jeu françois.
Pour continuer un roulement, il faut s’accoutumer
à paffer ie pouce par-déffous tel doigt que ce
foit, & à paffer tel autre doigt par-deffous le ptxicé.
Cette manière eft exce.len e , fur-tout quand il fe
rencontre des'diètes ou des bémols; alors faites en
forte que le pouce fe trouve fur la touche qui précède
le dièfe ou le bémol , où placez le immédiatement
après : par ce moyen vous vous procurtrez
autant de doigts de fuite que vous aurez de notes
a Lire.
Evitez, autant qü’ii fë pdurra, de toucher du
pouce ou du cinquième doigt une touche blanche ,
fur-tout dàns les roulemens de vîteflè.
Souvent on exécute un meme roulement avec
les deux mains dont les doigts fe fuccèdent pour
lors cofifécutivemènt. Dans ces roulemens les mains
paffent l’une fur l’autre ; mais il faut oblerver que
le fon de la première touche fur laquelle paffe une
des mains fort aufifi fié au fon précédent, que s’ils
étoient touchés de la même main.
Dans le genre de mufique harmonieux & lié, il
eft bon de s’accoutumer à fubftituer un doigt à la
place d’un autre fans relever la touche; cette manière
donne des facil tés pour l’exécution & prolonge
la durée d.s fons.
Pour l’accompagnement, le doigter delà main gauche
eft le même que pour les {.ièces , parce qu’il
faut toujours que c*tte_main joue les baffes qu’on-
doit accompagner ; ainfi le* règles de M. Duphfi y
fervent ég lemènt pour c'ettè partie , excepté dans les
occâfions oh l’on veut augmenter le bruit au moyen
de l’ô&ave qti’on embraffé du pouce & du petit
dfigt :'car alors, au lieu de doigter, la main en-
: tière fe tranf^orte d’une touche à l’autre. Quant à
la main droite, fort doigter confifte dans l’arrânge-
; ment des doigts ÔC, dans les'marches qu’on leur donne
pour faire cnt'efldïe les1 accords & leur fucceifion
L 1 1