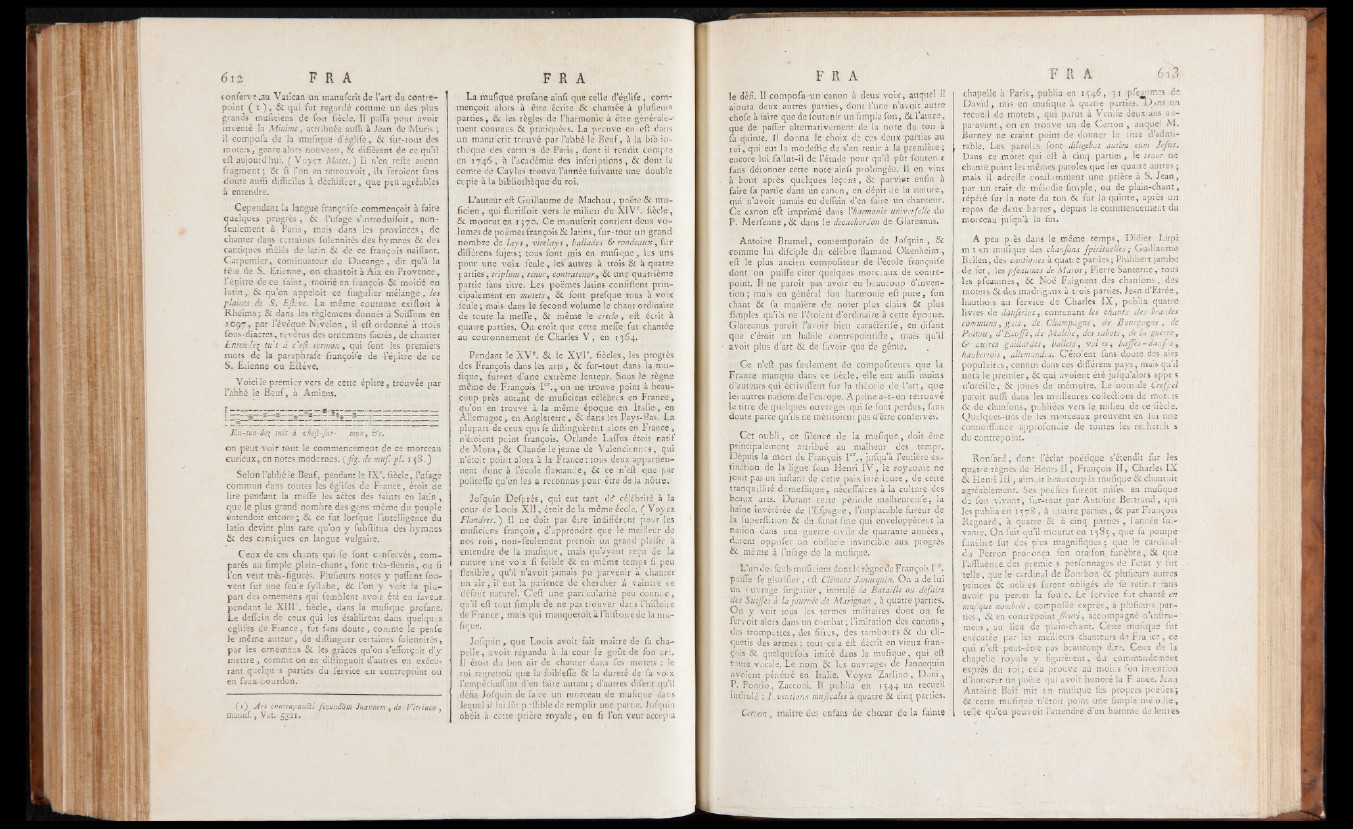
conferve.au Vatican un manuferit de l’art du contrepoint
( 1 ) , & qui fut regardé comme un des plus
grands muficiens de fon fiècle. Il pafla pour avoir
inventé la Minime, attribuée auffi à Jean de Mûris ;
il compofa de la mufique d’églife, & fur-tout des
motets, genre alors-nouveau, & différent de ce qu’il
eft aujourd'hui. (V o y e z Motet.') Il n’en refte aucun
fragment; & fi l’on en retrouvoit, ils feroient fans
doute auffi difficiles à déchiffrer, que peu agréables
à entendre.
Cependant la langue françoife commençoit à faire
quelques progrès, & l’ufage s’introduisit, non-
feulement à Paris, mais dans les provinces, de
chanter dans certaines folennités des hymnes & des
cantiques mêlés de latin & de ce françois naiffant.
Carpentier, continuateur de Ducange, dit qu’à la
fête de S. Etienne, on chantoit à Aix en Provence,
l’épître de ce faint, moitié en françois &L moitié en
latin, & qu’on appeloit ce fingulier mélange, les
plaints de S. Eftive. La même coutume exi.fl.oit à
Rheims; & dans les règlemens donnés à Soiffons en
1097, par l’évêque Nivelon, il eft ordonné à trois
fous-diacres, revêtus des ornemens facrés, de chanter
Entende£ tu t à c’ejl sermon, qui font les premiers
mots de la paraphrafe françoife de l’épître de ce
S. Etienne ou Eftève.
Voici le premier vers de cette épître, trouvée par
l’abbé le Beuf, à Amiens.
En-ten-de\ tuità -chejl-far- mon} &c.
on peut vorf tout le commencement de ce morceau
curieux, en notes modernes, (fig. de muf. pi. 158.)
Selon l’abbé le Beuf, pendant le IXe. fiècle, l’ufage
commun dans toutes les ég’ifes de France, étoit de
lire pendant la meffe les a êtes des faints en latin ,
que le plus grand nombre des gens même du peuple
entendoit encore ; & ce fut lorfque l’intelligence du
latin devint plus rare qu’on y fubftitua des hymnes
& des cantiques en langue vulgaire.
Ceux de ces chants qui fe font confervés, comparés
au Ample plain-chant., font très-fleuris, ou fi
l’on veut très-figurés. Piufieurs notes y paffent fou-
vent fur une feu'e fyllabe, & l’on y voit la plupart
des ornemens qui femblent avoir été en faveur,
pendant le XIIIe. fiècle, dans la mufique profane.
Le deffei.n de ceux qui les établirent dans quelques
églifes de France, fut fans doute, comme le penfe
3e même auteur, de diftinguer certaines folennités,
par les ornemens & les grâces qu’on s’efforçoit d’y
mettre, comme on en diflinguoit d’autres en exécu-t
tant quelques parties du fervice en contrepoint ou
en faux-bourdon.
(1) A n contrapunfti ftcundùm Joannem.de Vilriaco.
manuf., Vaf. 5321,
La mufique profane ainfi que celle d’églife, commençoit
alors à être écrite & chantée à plufieui s
parties , & les règles de l’harmonie à être générale-'
ment connues & pratiquées. La preuve en eft dans
un manuferit trouvé par l’abbé le Beuf., à la bib io-
thèque des carm?s de Paris, dont il rendit compte
en 1746 , à l’académie des inferiptions, & dont le
comte de Caylus trouva l’année fuivante une double
copie à la bibliothèque du roi.
L ’auteur eft Guillaume de Machau , poète & mu-
ficien, qui floriffoit vers le milieu du XIVe. fiècle,
& mourut en 1370. Ce manuferit contient deux volumes
de poèmes françois & latins, fur-tout un grand
nombre de lays, virelays, ballades 6* rondeaux, fur
différens fujeis; tous font mis en mufique, les uns
pour une voix feule, les' autres à trois & à quatre
parties, triplum, ténor, contratenor, & une quatrième
partie fans titre. Les poèmes latins confiflent principalement
en motets, & font prefque tous à voix
feule; mais dans le fécond volume le chant ordinaire
de toute la meffe, & même le credo, efl écrit à
quatre parties. On croit que cette meffe fut chantée
au couronnement de Charles V , en 1364.
Pendant le XVe. & le XVIe. fiècles, les progrès
des François dans les arts, & fur-tout dans la mufique,,
furent d’une extrême lenteur. Sous lé règne
même de François Ier. , on ne trouve point à beaucoup
près autant de muficiens célèbres en France,
qu’on en trouve à la même époque en Italie, en
Allemagne, en Angleterre, & dans les Pays-Bas. La
plupart de ceux qui fe diftinguèrent alors en France ,
n’éiôient point françois. Orlande Laflus étoit natif
de Mons, & Claude le jeune de Valenciennes, qui
n’étoit point alors à la~ France : tous deux appartiennent
donc à l’école flamande, & ce n’eft que par
politeffe qu’on les a reconnus pour être delà nôtre.
Jofquin Defprés, qui eut tant de* célébrité à la
cour de Louis X II, étoit delà même école. (V oy e z
Flandres. ) Il ne doit pas être indifférent pour les
muficiens françois, d’appréndre que le meilleur de
nos rois, non-feulement prenoit un grand plaifir à
entendré de la mufique, mais qu’ayant reçu de la
nature une voix fi foible & en même temps fi peu
flexible , qu’il n’avoit jamais pu parvenir à chanter
un air, il eut la patience de chercher à vaincre ce
défaut naturel. C ’eft une particularité peu'connue,
qu’il eft tout fimple de ne pas trouver dar.s Thiftoire
de France, mais qui manqueroit à l’hiftoiie de la mufique.
Jofquin , que Louis avoit fait maître de fa chapelle
, avoit répandu à la cour le goût de fon arr.
Il étoit du bon air de chanter dans fes motets : le
roi regrettoir que la foibleffe & la dureté de fa voix
l’empechaffent d'en faire autant ; d’autres difent qu’il
, défia Jofquin de faire un morceau de mufique dans
lequel il lui fût pffiible de remplir une partie. Jofquin
obéit à cette prière royale , ou fi l’on veut accepta
le défi. Il compofa-un canon à deux voix, auquel il
ajouta deux autres parties, dont l’une n’avoit autre
chofe à faire que de foutenir un fimple fon, & l’autre,
que de paffer alternativement de la note du ton à
fa quinte. Il donna le choix de ces deux parties au
roi, qui eut la modeftie de s’en tenir à la première ;
encore lui fallut-il de l’étude pour qu’il pût foutemr
fans détonner cette note ainfi prolongée. Il en vint
à bout après quelques leçons, & parvint enfin à
faire fa partie dans un canon, en dépit de la nature,
qui n’avoit jamais eu deffein d’en faire un chanteur.
Ce canon eft imprimé' dans Yharmonie univerfelle du
P. Merfenne , & dans le decachorJon de Glareanus.
chapelle à Paris, publia en 1546, 31 pfeaumes de
David, mis en mufique à quatre parties. Dins un
recueil de motets, qui parut à Venife deux ans au-
pa-avant, on en trouve un de Certon , auquel M.
Burney ne craint point de donner le titre d’admirable.
Les paroles font diligebat auùm eum Je fus.
Dans ce motet qui éft à cinq parties, le ténor ne
chante point les mêmes paroles que les quatre autres ;
mais il adreffe cofiftarr.ment une prière à S. Jean,
par un trait de mélodie fimple, ou de plain-chant,
répété fur la note du ton & fur la quinte, après un
repos de deux barres, depuis le commencement du
morceau jufqu’à la fin.
Antoine Brumel, contemporain de Jofquin, &
comme lui difciple du célèbre flamand Okenheim,
eft le plus ancien compofiteur de l’-école françoife
dont, on puiffe citer quelques more.aux de contrepoint.
Il ne paroît pas avoir eu beaucoup d’invention
; mais en général fon harmonie eft pure, fon
chant & fa manière de noter plus clairs &t plus
Amples qu’ils ne l’étoient d’ordinaire à cette époque.
Glareanus paroît l’avoir bien caraélérifé, en difant
que c’étoit un habile contre pointillé, mais qu’il
avoit plus d’art & de favoir que de génie.
- Ce n’eft pas feulement de compofiteurs que la
France manqua dans ce fiècle,'elle eut auffi moins
d’auteurs qui éctiviffent fur la théorie de l’art, que
les autres nations de l’eut ope. A peine a-t-ôn retrouvé
le titre de quelques ouvrages qui fe font perdus, fans
doute parce qu’ils ne méritoient pas d’être confervés. -
Cet oubli, ce filence de la mufique, doit être
principalement attribué au malheur des temps.
Depuis la mort de François Ier. , jufqu’à l’entière extinction
de la ligue fous Henri IV , le royaume ne
jouit pas un inftant de cette paix intérieure, de cette
tranquillité demeftique, néceiTaires à la culture des
beaux arts. Durant cette période malheureuse, la
hai ne invétérée de l’Efpagne, l’implacable fureur de
la fuperftition & du fanatifme qui enveloppèrent la
nation dans une guerre civile de quarante années,
durent oppofer un obfiade invincible aux progrès
& même à l’ufage de la mufiquê.
L’un des feuls muficiens dont le règne de François I r.
puiffe fe glorifier, eft Clément Jannequin. On a de lui
un c uvrage fingulier, intitulé la Bataille ou défaite
des Suiffes à la journée de Marignan , à quatre parties.
On y voit tous les termes militaires dont on fe
fer voit alors dans un combat ; l’imitation des canons,
des trompettes, des fifres, des tambours & du cliquetis
des armes : tout-cela eft décrit en vieux françois
& quelquefois imité dans la mufique, qui eft
toute vocale. Le nom & les ouvrages de Jannequin
avoient pénétré en Italie. Voyez Zarlino, Doni,
P. Pontio, Zacconi. Il publia en 1544 un recueil
intitulé : L: vendons muf cales à quatre & cinq parties.
Certon, maître des enfans de choeur de la fainte
A peu près dans, le même temps, Didier Lupi
m t en mufique des chanforts Jpirituelles; Guillaume
Brilen, des cantiques à quatre parties; Philibert jambe
de fer, lespfeaumes de Marot;• Pierre Santerne, tous
les pfeaumes , & Noë Faignent des chanfons , des
motets & des madrigaux à trois parties. Jean d’Etrée,
hautbois au fervice de Charles IX , publia quatre
livres de danferïes, contenant les chants des branles
communs, g d s , de Champagne, de Bourgogne ,.. de
Poitou , d’EcoJfé, de Malthe, des sabots, de la guerre,
autres gaillardes, ballets, vol: es, baffes - danfs t
hauberrois, allemandes. C ’étolent fans d.oute des airs
populaires, connus dans ces diftérens pays, mais qu’il
nota le premier, & qui avoient été jufqu’alors appr s
d’oreille, & joués de mémoire. Le nomade Crefpel
paroît auffi dans les meilleures colle&ions de mot; ts
& de chanfons, publiées vers le milieu de ce fiècle.
Quelques-uns de fes morceaux prouvent en lui une
connoiflance approfondie de toutes les reJierch s
du contrepoint.
Ronfard, dont l’éclat poétique s’étendit fur les
quatre règnes de Henri I I , François II, Charles IX
& Henri III, ainvoit beaucoup la mufique & chantoit
agréablement. Ses poëfies furent mifes en mufique
de fon vivant,, fur-tout par Antoine Bertrand, qui
les publia en 1578 , à quatre parties, & par François
Regnard, à quatre & à cinq parties , l'année fuivante.
On fait qu’il mourut en 1585 , que fa pompe
funèbre fut des plus magnifiques ; que le cardinal ■
du Perron proronça fon oraifon^ funèbre, & que
l’affluence, des premie-s perfonnages de l’etat y fut
telle , que le cardinal de Bourbon & plufieurs autres
princes & nob.es furent obligés de fe retii\ r-fans
avoir pu percer la foule. Le lervice fut chanté en
muf que nombrée, compofée exprès, à plufieu'S parties,
& en contrepoint fleuri, accompagné d’inftru-
mens , au lieu de plain-chant. Cette mufique fut
exécutée par les meilleurs chanteurs de Fra ice, ce
qui n’eft peut-être pas beaucoup- dire. Ceux de la
chapelle royale y figurèrent, du commandement
exprès du roi; cela prouve au moins fon intention
d’honorer un poète qui avoit honoré la Fiance. Jean
Antoine Baïf mit en mufique fes propres poëfies;
& cette mufique n’étoit point une fimple mélodie,
telle qu’on pouvoir l’attendre d’un homme de lettres