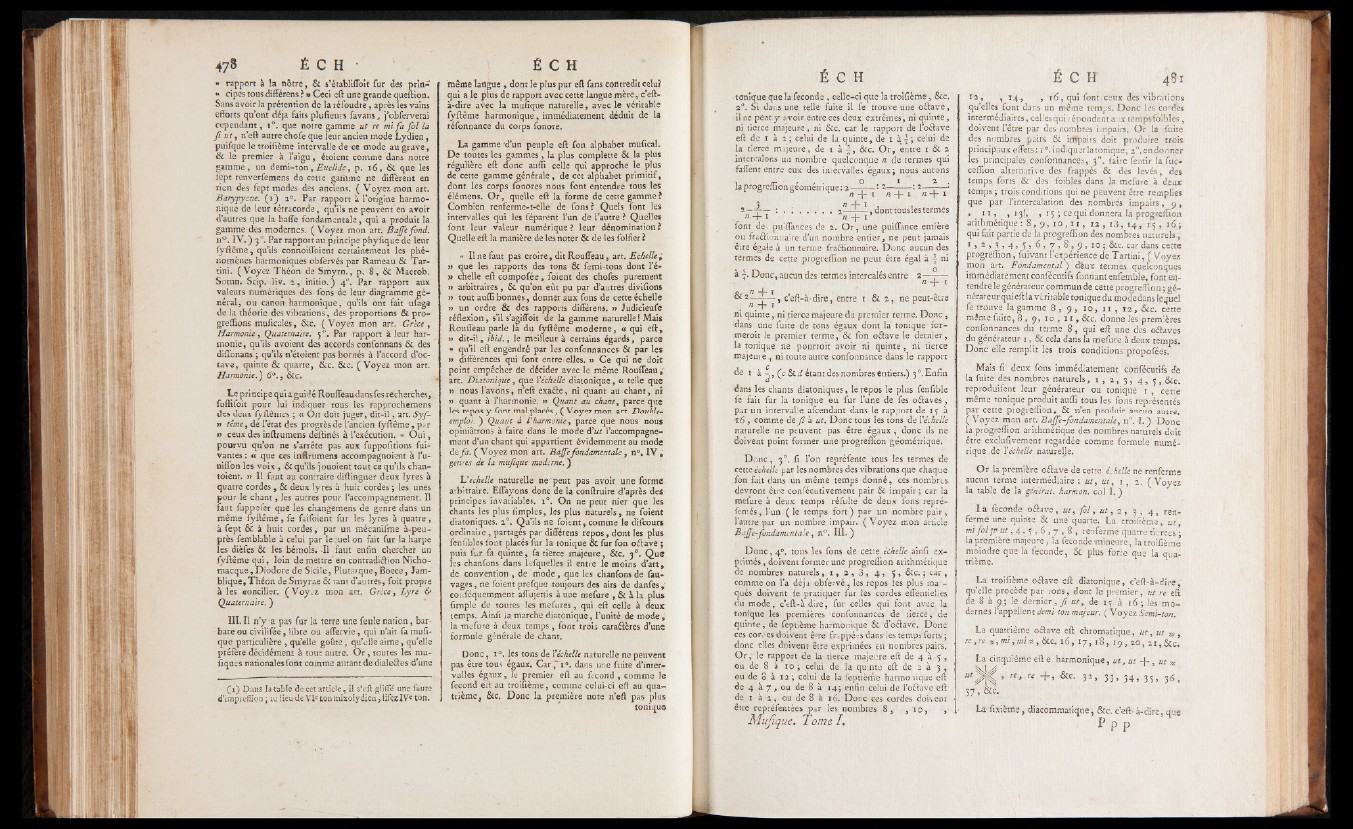
4 7 8 É C H •
» rapport à !a nôtre, & s’établiffoit fur des prîn-
*» cipes tous différens} » Ceci eft une grande queftion.
Sans avoir la prétention de la téfoudre, après les vains
efforts qu’ont déjà faits plufieurs favans , j’obferverai
cependant, i°. que notre gamme ut re mi fa fo l la
f i ut, n’eft autre chofe que leur ancien mode Lydien,
puifque le troifième intervalle de ce mode au grave,
& le premier à l’aigu, étoient comme dans notre
gamme , un demi-ton, Euclide, p. 16 , & que les
lept renverfemens de cette gamme ne different en
Tien des fept modes des anciens. ( Voyez mon art.
Barypycne. ( i ) 2°. Par rapport à l’origine harmonique
de leur tétracorde, qu’ils ne peuvent en avoir
d’autres que la baffe fondamentale, qui a produit la
gamme des modernes. ( Voyez mon art Baffe fond.
n°. IV . ) 30. Par rapport au principe phyfique de leur
fyfiême, qu’ils connoiffoient certainement les phénomènes
harmoniques obfervés par Rameau & Tar-
tini. (V oyez Théon de Smyrn., p. 8 , & Macrob.
Somn. Scip. liv. a , initio.) 40. Par rapport aux
valeurs numériques des fons de leur diagramme général,
ou canon harmonique, qu’ils ont fait ulage
de la théorie des vibrations, des proportions & pro-
greflions muficales, &c. (V oy e z mon arr. Grèce ,
Harmonie, Quaternaire. 5 °. Par rapport à leur harmonie,
qu’ils avoient des accords confonnans & des
diffonans ; qu’ils «’étoient pas bornés à l’accord d’octave,
quinte & quarte, &c. &c. (V oy e z mon art.
Harmonie. ) 6°., &c.
Le principe quia guidé Rouffeaudansfes récherches,
fuffifoit pour lui indiquer tous les rapprochemens
des deux fyftêmes ; « On doit juger, dit-il, art. Syf-
» terne, de l’état des progrès de l’ancien fyftême, par
j> ceux des inftrumens deftinés à l’exécution. » O u i,
pourvu qu’on ne s’arrête pas aux fuppofitions fui-
vantes ; « que ces inftrumens accompagnoient à l’u-
niffon les v o ix , & qu’ils jouoient tout ce qu’ils chan-
toient, » Il faut au contraire diftinguer deux lyres à
quatre cordes , & deux lyres à huit cordes ; les unes
pour le chant, les autres pour l’accompagnement. Il
faut fuppofer que les changemens de genre dans un
même fyftême, fe faifoient fur les lyres a quatre,
à fept & à huit cordes, par un mécanifme à-peu-
près femblable à celui par lequel on fait fur la harpe
les dièfes & les bémols. -Il faut enfin chercher un
fyftême qui, loin de mettre en contradi&ion Nicho-
macque, Diodore de Sicile, Plutarque, Boece, Jam-
blique, Théon de Smyrne & tant d’autres, foit propre
à les concilier. (V o y e z mon art, Grèce, Lyre &
Quaternaire. )
III. Il n’y a pas fur la terre une feule nation, barbare
ou civilifée, libre ou affervie, qui n’ait fa mufi-
que particulière, qit’elle goûte, qu’elle aime, qu’elle
préfère décidément à tout autre. O r , toutes les mu-
fiques nationales font comme autant de dialeéles d’une
(1) Dans la table de cet article, il s’eft glifle une faute
d’impreffion ; au lieu de VIe ton mixoly dien, iifça J Ve ton.
É c H
même langue , dont le plus pur eft fans contredit celuï
qui a le plus de rapport avec cette langue mère, c’eft-
à-dire aveqja mufique naturelle, avec le véritable
fyftême harmonique, immédiatement déduit de la
réfonnançe du corps fonore.
La gamme 'd’un peuple eft fon alphabet mufical.
De toutes les gammes, la plus complette & la plus
régulière eft donc aufli celle qui approche le plus
de cette gamme générale, de cet alphabet primitif,
dont les corps fonores nous font entendre tous les
élémens. O r , quelle eft la forme de cette gamme ?
Combien renferme-t-elle de fons? Quels font les
intervalles qui les féparent l’un de l’autre ? Quelles
font leur valeur numérique ? leur dénomination i
Quelle eft la manière de les noter & de les folfier ?
« Il ne faut pas croire, dit Rouffeau, art. Echelleî
» que les rapports des tons & femi-tons dont l’é-
» chelle eft compofée, foient des chofes purement
» arbitraires, & qu’on eût pu par d’autres divifions
j> tout aufli bonnes, donner aux fons de cette échelle
v un ordre & des rapports différens. » Judicieufe
réflexion, s’il s’agiffoit de la gamme naturelle ! Mais
Rouffeau parle là du fyftême moderne, « qui eft,
» dit-il, ibid., le meilleur à certains égards, parce
| qu’il eft engendré par les confonnances & par les
» différences qui font entre elles, n Ce qui ne doit
point empêcher de décider avec le même Rouffeau
art. Diatonique, que Y échelle diatonique, « telle que
» nous l’avons, n’eft exâéte, ni quant au chant, ni
» quant à l’harmonie. » Quant au chant, parce que
les repos y font mal placés, (Voyez mon art. Double-
emploi. ) Quant à l ’harmonie, parce que nous nous
opiniâtrons à faire dans le mode d'ut l’accompagnement
d’un chant qui appartient évidemment au mode
de fa. ( Voyez mon art. Baffe fondamentale, n°. IV ;
genres de la mufique moderne. )
U échelle naturelle ne^peut pas avoir une forme
arbitraire. Effayons donc de la conftruire d’après des
principes invariables. i°. On ne peut nier que les
chants les plus fimpies, les plus naturels, ne foient
diatoniques. 20. Qu’ils ne foient, comme le difeours
ordinaire, partagés par différens repos, dont les plus
fenfibles font placés fur la tonique & fur fon oétave ;
puis fur fa quinte, fa tierce majeure, &c. 30. Que
les chanfons dans lefquelles il entre le moins d’art,
de convention , de mode, que les chanfons de fau-
vages, ne foient prefque toujours des airs de danfes ,
conféquemment affujettis à une mefure , & à la plus
fimple de toutes les mefures, qui eft celle à deux
temps. Ainfi ja marche diatonique, l’unité de mode,'
la mefure à deux temps, font trois caractères d’une
formule générale de chant.
Donc , i ° . les tons de Y échelle naturelle ne peuvent
pas être tous égaux. Car f i ° . dans une fuite d’intervalles
égaux, le premier eft au fécond , comme le
fécond eft au troifième, comme celui-ci eft au quatrième,
&c. Donc la première note n’eft pas plus
tonique
tonique que la féconds , celle-ci que la troifième, &c.
20. Si dans une telle fuite il fe trouve une o&ave,
il ne peut y avoir entre ces deux extrêmes, ni quinte,
ni tierce majeure, ni &c. car le rapport de l’o&ave
eft de 1 à 2 ; celui de la quinte, de 1 à | ; celui de
la tierce majeure, de 1 à &c. O r , entre 1 & 2
intercalons un nombre quelconque n de termes qui
faffent entre eux des intervalles égaux; nous aurons
la progreflion 0 géométrique : 2-—?— ‘ 2— : 2— - ° n /1 + 1/z-t-irc-fi
M m m 1 1 H l - i , dont tous les termçs
n -{- î * *n -|- 1 ’
font des puiffances de 2. O r , une puiffance entière
ou fractionnaire d’un nombre entier, ne peut jamais
être égale à un terme fractionnaire. Donc aucun des
termes de cette progreflion ne peut être égal à \ ni
à Donc, aucun des termes intercalés entre 2/—z —t}—— i
—— , c’eft-à-dire, entre 1 & 2 , ne peut-être
n -j- 1 1 7 r
ni quinte, ni,tierce majeure du premier terme. D onc,
’dans une fuite de tons égaux dont la tonique for-
meroit le premier terme, & fon oCtave le dernier,
la tonique ne pourroit avoir ni quinte, ni tierce
majeure , ni toute autre confonnance dans- le rapport
de 1 à ( c é t a n t des nombres entiers.) 30. Enfin
dans les chants diatoniques, le repos le plus fenfible
fe fait fur la tonique ©u fur l’une de fes oCtaves,
par un intervalle afeendant dans le rapport de 15 à
*6', comme de f i à ùt. Donc tous les tons de Y échelle
naturelle ne peuvent pas être égaux, donc ils ne
doivent point former une progreflion géométrique.
Donc, 30. fi l’on repréfente tous les termes de
cette échelle par les nombres des vibrations que chaque
fon fait dans un même temps donné, ces nombres
devront être confécutivement pair & impair; car la
mefure à deux temps réfulte de deux fons repré-
fentés, l'un ( le temps fort) par un nombre pair,
l’autre par un nombre impair. (V o y e z mon article
Baffe-fondamentale, n°. III. )
Donc, 4°. tous les fons de cette échelle ainfi exprimés
, doivent former une progreflion arithmétique
de nombres naturels ,, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , &c. ; car ,
comme on l’a déjà obfervé, les repos les plus ma -
qués doivent fe pratiquer fur les cordes effentielies
du mode, c*eft-à dire, fur celles qui font avec la
tonique les premières confonnances de tiercé, de
quinte, de feptième harmonique & d’oCtâvè. Donc
ces conJes doivent être frappées dàns les temps forts ;
donc elles doivent être exprimées en nombres pairs.
O r , le rapport de la tierce majeure eft de 4 à 5 ,
ou de 8 à 10 ; celui de la quinte eft de 2 à 3 ,
©u de 8 à 12 ; celui de la feptième harmonique eft
de 4 à 7 , ou de 8 à 14; enfin celui de l’oCtave ëft
de 1 à 2 , ou de 8 à 16. Donc ces cordes doivent
être repréfentées par les nombres 8 , , 1 0 , »
Mufique. Tome I.
12 » , 14 , , 16, qui font ceux des vibrations
qu’elles font dans un même temps. Donc les cordes
intermédiaires, celles qui répondent aux tempsfoiblës,
doivent l’être par des nombfes impairs. Or la fuite
des nombres pairs & irîfpairs doit produire trois
principaux effets : 1 °. indiquer la tonique, 20. en donner
les principales confonnances, 30. faire fentir la fuc-
cefllon alternative des frappés & des levés, des
temps forts & des foibles dans la mefure à deux
temps ; trois conditions qui ne peuvent être remplies
que par l’intercalation des nombres impairs, 9 ,
> 1 1 , ,13!, , 15 ; ce qui donnera la progreflion
arithmétique : 8 , 9, 1 0 , 1 1 , 12 , i3, 14, 15 , 1 6 ,
qui fait partie de la progreflion des nombres naturels ,
1 > 2 , 8 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ; & c. car dans cette
progreflion, fuivant l’expérience de Tartini, ( Voyez
mon art. Fondamental ) deux termes, quelconques
immédiatement confécutifs Tonnant enfemble, font entendre
le générateur commun de cette progreflion ; générateur
qui eft la vé ritable tonique du mode dans lequel
fe trouve Ta gamme 8 , 9 , 10 , n , 12 , &c. cette
même fuite, 8 , 9, 10 , 1 1 , &c. donne les premières
confonnances du terme 8 , qui eft une des oéfaves
du générateur 1 , & cela dans la mefure à deux temps.
Donc elle remplit les trois conditions propofées.
Mais fi deux fons immédiatement confécutifs de
la fuite des nombres naturels, 1 , 2, 3, 4 , 5 9 & c.
reproduifent leur générateur ou tonique 1 , cette
même tonique produit aufli tous les fons représentés
par cette progreflion, & n’en produit aucun autre.
(V o y e z mon art. B ajfe-fondamentale y n°. I .) Donc
la progreflion arithmétique des nombres naturels doit
être exclu fi vement regardée comme formule numérique
de Yéchelle naturelle.
Or la première oâave de cette échelle ne renferme
aucun terme intermédiaire : ut, ut, 1 , 2, (V o y e z
la table de la générât, karmon. col I. )
l a fécondé oéhve, ut^ fo l, u t , 2 , 3 , 4 , renferme
une quinte & une quarte. La troifième, ut
mi fol fv u t, 4 , . 5 , 6 , 7 , 8 , renferme quatre tierces ;
la première majeure, la fécondé mineure, la troifième
moindre que la fécondé, & plus forte que la quatrième.
La troifième o&ave eft diatonique, c’eft-à-dire,’
qu’elle procède par tons, dont le premier, ut re eft
de 8 à 9 ; le dernier , f i ut, de 15 à 16 ; les modernes
l’appellent demi ton majeur. ( Voyez Semi-ton.
La quatrième o&ave eft chromatique, ut, ut %
re3re x ,m i, mi», &c. 16 , 1 7 , 18, 19 , 20, 2 1 ,&c.
La cinquième eft e harmonique, ut, ut -f-, ut «
’ n - re + > &c - f f i 3 3 . 3 4 . 3 3 . 3 « .
37 > & c r
La fixième, diacommatique, &c. c’eft-à-dire, que
P P P