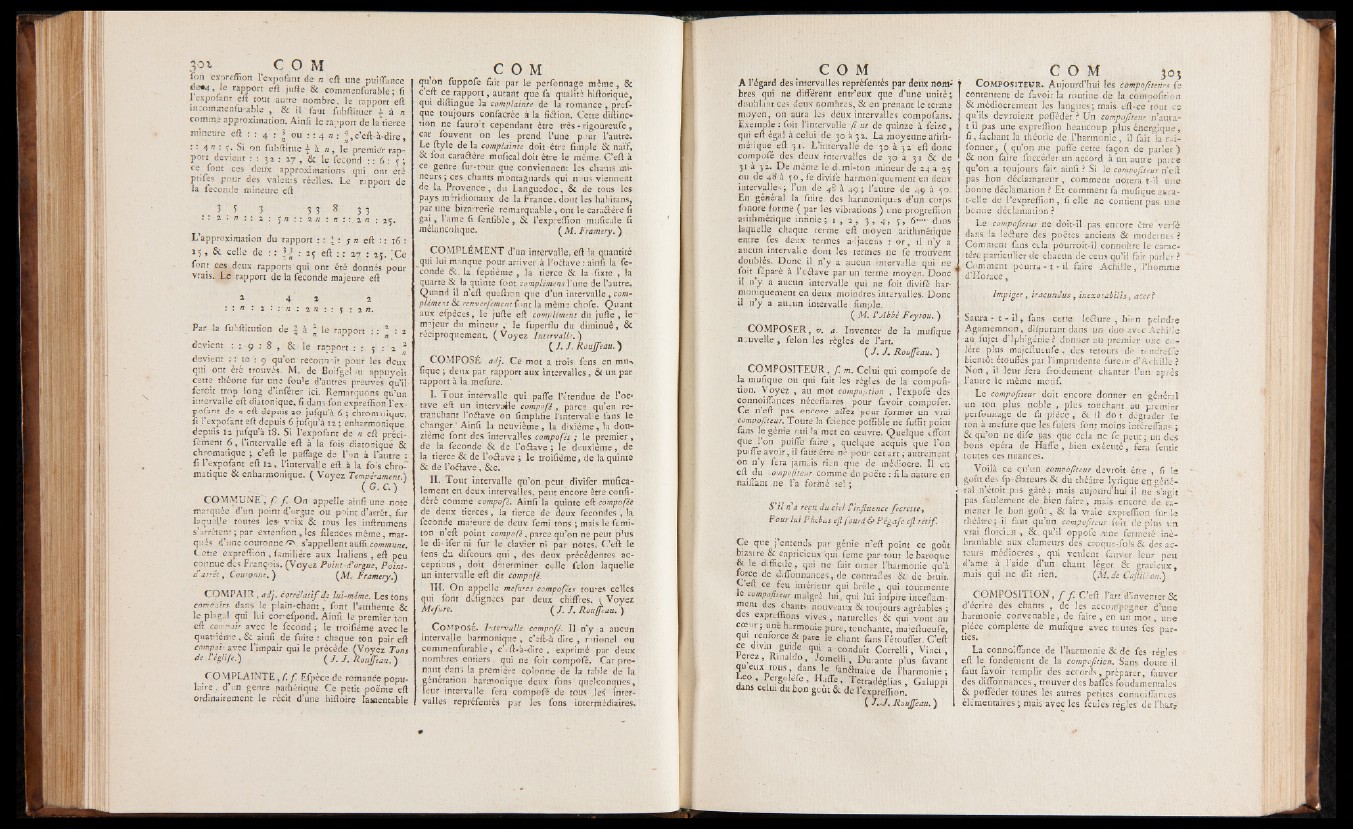
| o i C O M
fori expreftion l’expofant de n eft line puiffance
de«4 le rapport eft jufte & commenfurable; fi
1 expofanr eft tout autre nombre, le rapport eft
mcommenfurable , & il faut fubftimer i à n
comme approximation. Ainfi le rapport de la tierce
mineure eft : : 4 : ’ ou : : 4 n : * , c’eft- à-dire,
: . 4 n : Si on fubftitue 7 à n , le premier rapport
devient : : 32 : 2 7 , & le fécond : : 6 : f ;
ce font ces deux approximations qui ont été
prifes pour des valeurs réelles. Le rapport de
la fécondé mineure eft
. . 3 5 3 3 3 8 3 3
: : 1 • n : : 2 : 5 n : : 2 n : n : :.2 n : 23.
L ’approximation du rapport : : * : ƒ n eft : : 16 :
1 5 , & celle de : : V : 25 eft : : 27 : 25. [Ce
font ces deux rapports qui ont été donnés pour
v.'ais..;l.e rapport de la fécondé majeure eft
* 4 1 2
: : n : 2 : : n : 2 n : : f : 2 n.
Par -la fuhftitution de J à 1 le rapport • • 1 • 2
devient : : 9 : .8 , & le rapport : : 5 : 2 2
devient : : 10 : 9 qu’on reconn ut pour les deux
qui ont été trouvés. M. de Boifgel .u appuyoit
cette théorie fur une fou'e d’autres preuves' qu’il
fercit trop long d’inférer ici. Remarquons qu’un
intervalle eft diatonique, fi dans fon expreffioti l’ex-
pofant de n eft depuis 20 jufqu’à 6 ; chromatique,
fi l’expofant eft depuis 6 julqu’à 12 ; enharmonique,
depuis 12 jufqu’à 18. Si l’expofant de n eft préci-.
fément 6 , l’intervalle eft à la fois diatonique &
chromatique ; c’eft le paflage de Ton à l’autre :
fi l’expofant eft 12, l’intervalje eft à la fois chro~
matique & enharmonique. ( Voyez Tempérament )
( G .C . )
COMMUNE , f. ƒ On appelle ainfi une note
marquée d’un point d’orgue ou point d’arrêt, fur
laquelle toutes le» voix & tous les inftrumens
s’arrêtent ; par extenfion, les filences même, marqués
d’ une couronne ris, s’appellent auffi commune.
Cette expreftion , familière aux Italiens , eft peu
connue des François. (Voyez P oint -<forgue, Point-
dé arrêt , Couronne. ) (M. Framery.)
COM P AIR , ai], corrélatif de lui-même. Les tons
comoatrs dans le plain-chant, font l’authente &
le plagal qui lui conefpond. Ainfi le premier ton
eft compair avec le fécond ; le troifiéme avec le
quatrième, & ainfi de fuite : chaque ton pair eft
compai' avec l’jmpair qui le précède. (Voyez Tons
de réglife.) ( y. y. Rouf,au. )
COMP LAINTE, f. f . Efpèce de romance populaire,
d’ un genre pathétique. Ce petit poème eft
ordinairement le récit d’une hiftoire lamentable
C O M
qu’on fuppofe fait par le perfonnage même, &
c eft ce rapport, autant que fa qualité hiftorique,
qui diftingue la complainte de la romance ,. pref-
que toujours confacrée à la fiiftion. Cette diftinc-
tion ne fauro t cependant être très - rigoureufe,
car fouvent on les prend l’une pour l’autre.
Le ftyle de la complainte doit être (impie & naïf,
& fon caraéfère muficaldoit être le même. C ’eft à
ce genre fur-tout que conviennent les chants mineurs
; ces chants montagnards qui nous viennent
de la Provence, du Languedoc, & de tous les
pays méridionaux de la France, dont les habitans,
par une bizarrerie remarquable , ont le caractère ft
g a i, l’ame ft fenfible, & i’expreflïon muficale fi
mélancolique. ( M. Framery. )
COMPLÉMENT d’ün intervalle, eft la quantité
qui lui manque pour arriver à Poftave : ainfi la fécondé
6c, la feptième , la tierce & la fixte , la
quarte & la quinte font complément Y une de l’autre.
Quand il n’eft queftron que d’un intervalle, complément
8c renversement font la même chofe. Quant
aux efpèces, le jufte eft complément du jufte , le~
mijeur du mineur le fuperflu du diminue, 8c
réciproquement. ( Voyez Intervalle..)
( J. J. Rouleau.)
COMPOSÉ adj. Ce mot a trois fens en mu*
fique ; deux par rapport aux intervalles, & un par
rapport à la-mefure. '
I. Tout intervalle qui paffe Attendue de Toc*
tave eft un intervaèle compofé , parce qu’en retranchant
l’oélave on fimplifie l’intervalle fans le
changer.' Ainfi la neuvième , la dixième, la douzième
font des intervalles compofés ; le premier ,
de la fécondé & de l’oétave ; le deuxième, de
la tierce & de l’oétave ; le troifiéme, de la quinte
& de l ’oétave, &c.
II. Tout intervalle qu’on, peut divifer mufica-
lement en deux intervalles, peut encore être confi-
dére comme compofé. Ainfi la quinte eft compofée
de deux tierces, !a tierce de deux fécondés , la
fécondé majeure de deux femi tons ; mais le femi-
ton n’eft point compofé, parce qu’on ne peut p'us
le di'ifer ni fur le clavier ni par notes. C ’eft le
(ens du difeours qui , des deux précédentes acceptions
, doit déterminer celle félon laquelle
un intervalle eft dit compofé.
IIL On appelle mefures compofées toutes celles
qui font défignées par deux chiffres. ( Voyez
Mefùre. ( J. J. Rouf/eau. )
C ompose. Intervalle- compofé. Il n'y a aucun
intervalle harmonique , c’eft-à dire , ntionel ou
x commenfurable , c\ ft-à-clire , exprimé par deux
nombres entiers . qui ne foit compofé. Car prenant
dans la première colonne de la table de la
génération harmonique deux fons quelconques,
leur intervalle fera compofé de tous ,les inter-
1 valles repréfentés par les fons intermédiaires.
C O M
A l’égard des intervalles repréfentés par deux nombres
qui ne diffèrent entr’eux que d’une unité;
doublant ces deux nombres, & en prenant le ternie
moyen, on aura les deux intervalles compofans.
Exemple : foit l’intervalle fi ut de quinze à feize,
qui eft égal à celui de 30 à 32. La moyenne arithmétique
eft 31. L ’intervalle de 30 à 32 eft donc
compofé des deux intervalles de 30 à 31 8ç de
31 a 32. De même le d-mi-ton mineur de 24 à 25
ou de 48 à çOjfedivife harmoniquement en deux
intervalles; l’un de 48 à 4 9 ; l’autre de 49 à 50.
En général la fuite des harmoniques d’un corps
fonore formé ( par les vibrations ) une progrefîion
arithmétique infinie; 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6*— dans
laquelle chaque terme eft moyen arithmétique
entre fes deux termes aèjacens : o r , il n’y a
aucun intervalle dont les termes ne fe trouvent
doublés. Donc il n’y a aucun intervalle qui ne
foit féparé à l’célave par un’ terme moyen. Donc'
il n’y a aucun intervalle qui ne foit divifé harmoniquement
en deux moindres intervalles. Donc
il n’y a au.un intervalle, fimple.
( M. l'Abbé Feytou. )
COMPOSER, v. a. Inventer de la mufique
nouvelle, félon les règles de l’art.
( / . /• Roujfeau. )
COMPOSITEUR, f . m. Celui qui compofé de
la mufique ou qui fait les règles de la compofi-
tion. V oyez , au mot composition , l’expofé des
connoiffances néceffaires pour favoir compofer.'
Ce n eft pas encore affez pour former un vrai.
compofkeur. Toute la fcieiice poflible ne fuffit point
fans le génie qui la met en oeuvre. Quelque effort
que l’on puiffe faire , quelque acquis que l’on
puiffe avoir, il faut être né pour cet art ; autrement
on n’y fera jamais rien que de médiocre. Il en
eft du -ompofiteur comme du poète : fila nature en
naiffant ne l’a forhié te! ;
S il n a reçu du ciel f influence fecrette9
Pour lui Phébus ejl fouid & Pégafe ejl rétif.
Ce que j entends par génie n’eft point ce goût
. bizaire & capricieux qui feme par-tout le baroque
& le difficile, qui ne fait orner l’harmonie qu’à
rorce de diffonnances, de contraires & de bruit.
C eft ce feu intérieur qui brûle , qui tourmente
le compofiuur malgré lui, qui lui inlpire incefiam-
ment des chants nouveaux & toujours agréables ;
des exprdîions vives , naturelles & qui vont au
coeur; une harmonie pure, touchante, majeftueufe,
qui renforce & pare le chant fons l’étouffer. C ’eft
ce dtvin guide qui a conduit Correlli, Vin ci,
erez , Rinaldo, Jomelli, Durante plus favant
queux tous dans le fanauaire de l’harmonie;
dan«’ er § ° ^ e » n p lT ’ Terradéglias , Galuppi
dans celui du bon gout & de l’expreffion.
( J R o u j f e a u . )
C O M 3 0 5
1 Compositeur. Aujourd’hui les ôompojïteür.c fe
contentent de favoir la routine de la comnofition
.& médiocrement les langues; mais eft-ce tout ce
qu.ils devroient poffeder ? Un c ompofiteur n’aiira-
t il pas une expreftion beaucoup plus énergique,
f i , tachant la théorie de l’harmonie , il fait la r.fi-
fonner, ( qu’on me paffe cette façon de parler )
8c non faire fuccéder un accord à un autre parce
qu’on a toujours fait ainfi ? Si le compofiteur n'eft
pas bon déclamateur , comment notera t-il fine
bonne déclamation ? Et comment fa muficue aura-
t-elle de l’expreflion, fi elle ne contient'pas une
bonne déclamation ?
Le compofiteur ne doit-il -pas encore être verfé
dans la le dure des. poètes anciens & modernes ?
Comment fans eda pourroit-il connoître le caractè
re particulier de chacun de ceux qu’il fait parler ?
l Comment pourra - t - il faire Achiile , l’homme
d’K orace,
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer}
Saura - t - i l , fans cetre leélure , bien peindre
Agamemncn , difputant dans un duo avec Achiile
au fujet d Iphigénie ? donner au premier une colère
plus majeftueufe , des retours de tendrefie
bientôt étouffés par l'imprudente fureur d’Achille ?
No n , il leur fera froidement chanter l’un après
l’autre le même motif.
Le compofiteur doit encore donner en général
un ton plus noble , plus touchant au premier
perfonnage de fa p ièce, 8c il. d o t dégrader le
ton à mefure que les fujets font moins intéreflans ;
8c qu’on ne due pas que cela ne fe peut ; un des
bons opéra de Ha fie., bien exécuté, fera fentir
toutes ces nuances. ;
Voilà ce qu’un compofiteur devroit être , fi le
goût des fp- êlateurs 8c du théâtre lyrique en général
n’étoit pas gâté; mais aujourd’hui il ne s’agit
pas feulement de bien faire ., mais encore de ramener
le bon goûr, & la vraie expreftion furie
théâtre ; ii faut qu’un compofiteur foit de pins fin.
vrai ftoïcian , & . qu’il oppofe .une fermeté inébranlable
aux clameurs des croque-fols 8c des acteurs
médiocres , qui veulent fauver leur peu
d’ame à l’aide d’un chant léger & gracieux,
mais qui ne dit rien. {M.de Caflilhon.)
COM POS IT IO N , f f . C ’eft l ’art d’inventer &
d’écrire des chants , de les accompagner d’une
harmonie convenable, de faire , en un mot une
pièce complette de mufique avec toutes fes parties.
La connoiffance de l’harmonie & de fes -règles
eft le fondement de la compofiticn. Sans doute il
faut favoir remplir des accords, préparer, fauver
des diflonnances, trouver des baffes fondamentales
& pofféder toutes les autres petites connoiffances
élémentaires ; mais avec les feules règles de l'har?