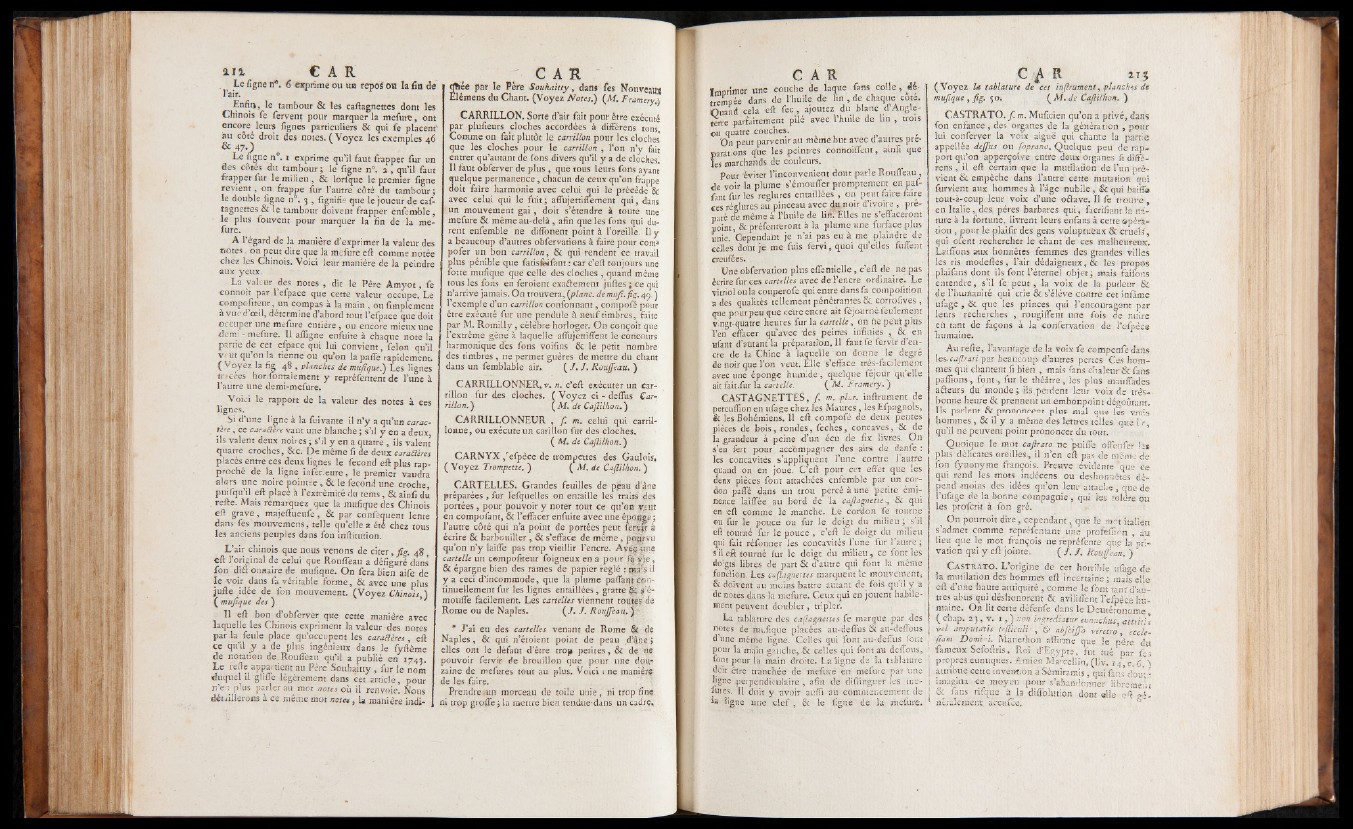
a n C A R
I Le figne n*. 6 exprime ou ua repo£ ou la fin de
l ’air.
Enfir>, le tambour & les caftagnettes dont les
Chinois fe fervent pour marquer la mefure, ont
encore leurs fignes particuliers & qui fe placent'
au cote droit des notes. (V o y e z les exemples 46
& 4 7 . )
Le fi^ne n°. 1 exprime qu’il faut frapper fur un
des cotés du tambour ; le ligne n°. a , qu’il faut
frapper fur le milieu , & lorfijue le premier ligne
revient, on frappe fur l’autre côté du tambour ;
le double ligne n°. 3 , lignifie que le joueur de caf-
tagnettes & le tambour doivent frapper ènfemble,
le plus fouvent pour marquer la fin de la mefure.
A 1 egard de la maniéré d’exprimer la valeur des
notes. on peut dire que la mefure eft comme notée
chez les Chinois. Voici leur manière de la peindre
aux yeux.
La valeur des notes , dit le Père Am y o t, fe
•connoit par 1 efpace que cette valeur occupe. Le
compofiteur, un compas à la main , ou limplement
a vue d oeil, détermine d’abord tout l’efpace que doit
occuper une mefure entière, ou encore mieux une
demi - mefure. Il afligne enfuite à chaque note la i
partie de cet efpace qui lui convient, félon qu’il
Vfut qu on la tienne ou qu’on la palfe rapidement.
( Voyez la fig 48 , planches de mufique.) Les lignes
tracées horizontalement y repréfentent de l’une à
l ’autre une demi-mefure.
Voici le rapport de la valeur des notes à ces
lignes.
. Si d’une ligne à la fui vante il n’y a qu’un carac-
tère , ce caraâère vaut une blanche ; s’il y en a deux
ils valent deux noires ; s’ il y en a quatre , ils valent
quatre croches, & c .D e même fi de deux caraRères
placés entre ces deux lignes le fécond eft plus rapproché
de la ligne inférieure, le premier vaudra
alors une noire pointée , & le fécond une croche
puifqu’il eft placé à l’extrémité du tems-, & ainfi du
refte. Mais remarquez que la mufique des Chinois
eft grave, majeftueufe, & par conféquent lente
dans fes mouvemens, telle qu’elle a été chez tous
les anciens peuples dans fon inftitution.
L ’air chinois que nous venons de citer, fig. 48 ,
eft l’original de celui que Rouffeau a défiguré dans
fon d'fâ onnaire de mufique. On fera bien aife de
le voir dans fa véritable forme, & avec une plus
jufte idée de fon mouvement. (V oyez Chinois
( mufique des )
II eft bon d’obferver que cette manière avec
laquelle les Chinois expriment la valeur des notes
par la feule place qu’occupent les caraa'eres , eft
ce qu’il y a de plus ingénieux dans le fyftême
de notation de. Rouffeau qu’il a publié en 1743.
Le refte appartient au Père Souhaitty , fur le nom
duquel il. g lifte légèrement dans cet article, pour
n’en plus parler au mot notes ou il renvoie. Nous
détaillerons à ce même mot note*, la manière indi- |
CARRILLON. Sorte d’air fait pour être exécuté
par plufieurs cloches accordées à difterens tons
Comme on fait plutôt le carrillon pour les cloches
que les cloches pour le carrillon , l’ on n’y fait
entrer qu’amant de fons divers qu’il y a de cloches!
Il faut obferver de plus , que tous leurs fons ayant
quelque permanence, chacun de ceux qu’on frappe
doit faire harmonie avec celui qui le précède &
avec celui qui le fuit ; affujettiflement qui, dans
un mouvement g a i , doit s’étendre à toute une
mefure & même au-delà, afin que les fons qui durent
enfemble ne diflonent point à l’oreille. Il y
a beaucoup d’autres obfervations à faire pour corn*
pofer un bon carrillon, & qui rendent ce travail
plus pénible que fatisfeifant : car c’eft toujours une
fotte mufique que celle des cloches , quand même
tous les fons en feroient exa&ement juftes ; ce qui
n’arrive jamais.On trouvera, {plane, demufi.fig.4y,}
l’exemple d’un carrillon conformant, compofé pour
être exécuté fur une pendule à neuf timbres, faite
par M. Romilly, célèbre horloger. On conçoit que
l ’extrême gêne à laquelle affujettiffeat le concours
harmonique dès fons voifins & le petit - nombre
des timbres , ne permet guères de mettre du chant
dans un femblable air. ( J. J. RouJJeau. )
CARRILLONNER, v. n. c’eft exécuter un carrillon
fur des cloches. ( Voyez ci - deffus Carrillon.')
{M . de Cafiilhon.)
CARRILLONNEUR , f . m. celui qui carrii-
loane, ou exécute un carillon fur des cloches.
( M. de Cafiilhon.)
CARN YX ,refpèce de trompettes des Gaulois.
( Voyez Trempette. ) ( M. de Cafiilhon. )
CARTELLES. Grandes feuilles de péau d’âne
préparées , fur lefquelles on entaille les traits des
portées , pour pouvoir y noter tout ce qu’on ygut
en compofant, & l’effacer enfuite avec une éponge ;
l’autre côté qui n’a point de portées peut fgrvjt à
écrire & barbouiller, & s’efface de même, p i^ vu
qu’on n’y laiffe pas trop vieillir l’encre. Aveg-yne
cartelle un compofiteur foigneux en a pour ftfyle,
& épargne bien des rames de papier réglé : il
y a ceci d’incommode, que la plume paffaitt éon-
tinuellement fur les lignes entaillées, gratte §c s’é-
mouffe facilement. Les cartelles viennent toqtes de
Rome ou de Naples. {J. J. RouJJeau.} '
* J’ai eu des cartelles venant de Rome & dç
Naples, & qui n’étoient point de peau d’âqç î
elles ont le défaut d’être trop petites, & de 9$
pouvoir fervir de brouillon que pour une doÿ*'
zaine de mefures tout au plus. Voici 1 ne manière
de les faire..
Prendre*un morceau de toile unie, ni trop fine
ni trop greffe ; la mettre bien tendue*dans un cadrç.
C A R
Imprimer line couche de laque Tans co lle , ^détrempée
dans de l'huile, de lin , de chaque côté.
Ôuand cela eft XL. ajoutez du blanc d Angleterre
parfaitement prié avec l’huile de lin , trois
ou quatre couches.
'On peut parvenir au meme but avec d autres préparations
que les peintres conhoiïïent, ainji que
les marchands dé couleurs.
Pour éviter l'inconvenient dont parle Rondeau ,
de voir la plume s’émouffer promptement en paf-
fant fur les reglures entaillées , on peut faire-faire
ces réglures au pinceau avec ^jj-noir. d’ivoire , préparé
de même à l’ huile de lin. Elles ne s’effaceront
point, & préfenteront à la .plume une furfaceplus
unie. Cependant je n’ai pas eu à mê plaindre de
celles dont je me fuis fervi, quoi qu’elles fuffent
creufées. ,
Une obfervation plus effentielle, c’eft de ne pas
écrire fur ces cartelles avec de Fencre ordinaire. Le
vitriol ou la couperofe qui entre dans fa compolition
a des qualités tellement pénétrantes & corrofives ,
qae pour peu que cette encre ait féjourné.feulement
Vingt-quatre heures fur la cartelle, on ne peut plus
l ’en effacer qu’avec des peines infinies , & -en
ufant d’atitant la préparation. 11 fautfe fervir d’encre
de la Chine à laquelle on donne le degré
de ftoir que l’on veut. Elle 's’efface très-facilement
avec une éponge humide , quelque féjoûr qu’elle,
ait fait .fur la cartelle. ( M. Framery.)
CASTAGNETTES, f . m. p'Lr. infiniment de
perculïîon en ufage chez les Maures, les Efpagnols,
& les Bohémiens. Il eft compofé de deux petites
pièces de bois, rondes, feches, concaves, & de
la grandeur à peine d’un écu de fix livres. On
s’en fort pour, accompagner des airs de danfe :
les concavités s’appliquent l’une contre l ’autre
quand on en joue. C’eft pour cet effet que les
deux pièces font attachées enfemble par un cordon
paffé dans un trou percé à une petite éminence
laiffée au bord de -la cafiag/ïette-, 8c qui
en eft comme le manche. Le cordon fe tourne
©u fur le pouce ou fur Je doigt du milieu; s’il
eft tourné fur le pouce , c’eft le doigt du milieu
qui fait réfonner les concavités l’une fur l’autre ;
s’il eft tourné fur le doigt du milieu , ce font les
doigts libres de part & d’autre qui font la même
fond ion. Les cafiagnettes marquent le mouvement,
& doivent au moins battre autant de fois qu’il y a
de notes dans la mefure. Ceux qui en jouent habile-
ment peuvent doubler, tripler.
La tablature des caflagnettes fe marque par des
notes de mufique placées au-deffus 8i au-deffous
dune même ligne. Celles qui font au-deffus font !
pour la main gauche, 8c celles qui font au deffous, 1
font pour la main droite. La ligne cîe la tablature !
doit être tranchée de mefure en mefure par une j_
ligne perpendiculaire, afin de diflinguer les Ine- i
fûtes. Il doit y avoir ai:ffi au commencement de j
la ligne une c le f , 6c le ligne de la mefure. ^
C R 21?
(V o y e z la tablature de cet infirument, planches de
mufique , fig. 50; ( M. 4e Cafiilhon. )
C ASTRATO. f . m. Muficien qu’on a privé, dans
fon enfance, des organes de la génération , pour
lui conferver la voix aiguë qui chante la partie
appellée dejjiis ou foprano. Quelque peu de rapport
qu’on apperçoiye entre deux organes fi différées
, il eft certain que la mutilation de l’un prévient
8c empêche dans l’autre cette mutation qui
forvient aux hommes à l’âge nubile , & qui baiffo
tout-à-coup leur voix d’une oétave. Il fe trouve,
en Italie, des, pères barbares qui, facrifiantla nature
à la fortune, livrent leurs enfans à cette opération
, pour le plaifir des gens voluptueux & cruels,
qui ofent rechercher le chant de ces malheureux.
Laiffons aux honnêtes femmes des grandes villes
les ris modeftes, l ’air dédaigneux, & les propos
plaifans dont ils font l’éternel objet; mais faifons
entendre, s’il fe p eut, la voix de la pudeur &
de l’humanité qui crie 8c s’élève contre c et infâme
ufage , 8c que les princes qui l ’encouragent par
leurs recherches , rougiffent une fois de nuire
efi tant de façons à la coilfervation de l’efpèce
humaine.
Au refte, lavanfagê de la Voix fecompenfe dans
\es*caflrati par beaucoup d’autres pertes Ces hommes
qui chantent fi bien , mais fans ch a leu r & fans
paillons-, font-, fur le théâtre, les pins mauffades
aâeurs du" monde ; ils .perdent leur voix de très--
bonne heure 8c prennent un embonpoint dégoûtant.
Us parlent & prononcent plus mal que les vrais
hommes , & il y a même des lettres telles que 1 >,
qu’il ne peuvent point prononcer du tout.
Quoique le mot caftrato ne puiffe oftenfer les
plus délicates oreilles-, il n’en eft pas de même de
fon fynonyme françois. Preuve évidente 'que ce
qui rend les mots indécens ou deshonnêtes dépend
-moins des idées qu’on leur attache , que de
î’ufage de la bonne compagnie , qui les tolère ou
les proferit à fon gré.
On pourroit dire, cependant, que'le met italien
s’admet comme repréfentant une profbflicn , au
lieu que le mot françois ne répréfente que la privation
qui y eft jointe. ( ƒ. f . Rokfieaa. )
C a st r a to . L’origine de cet horrible ufa^e de
la mutilation des hommes eft incertaine; mais elle
eft d’une haute antiquité , comme le font tant d’autres
abus qui déshonorent & aviliffent l ’efpèce humaine.
On lit cette défenfe dans le Deutéronome
( cf^laP* 23 riV. 1 , ) r.on ingrediatur eunuchus, attrhù
vd amp ut axis ufiicuU- , & abfcijfio v érétro , eede-
fiam Domi'i. Manerhon affirme que le père du
fameux Sefoftris, Roi d’ Egypte, fut tué par fes
propres eunuques. Amien Marcellin, (liv. 14, c. 6 ,)
attribue cette invention à Sémiramis, qui fans cîouVï
imagina ce moyen .pour s’abandonner librement
& fans rifque à la diAblution dont elle eft <4-
néralement. accufée, ow