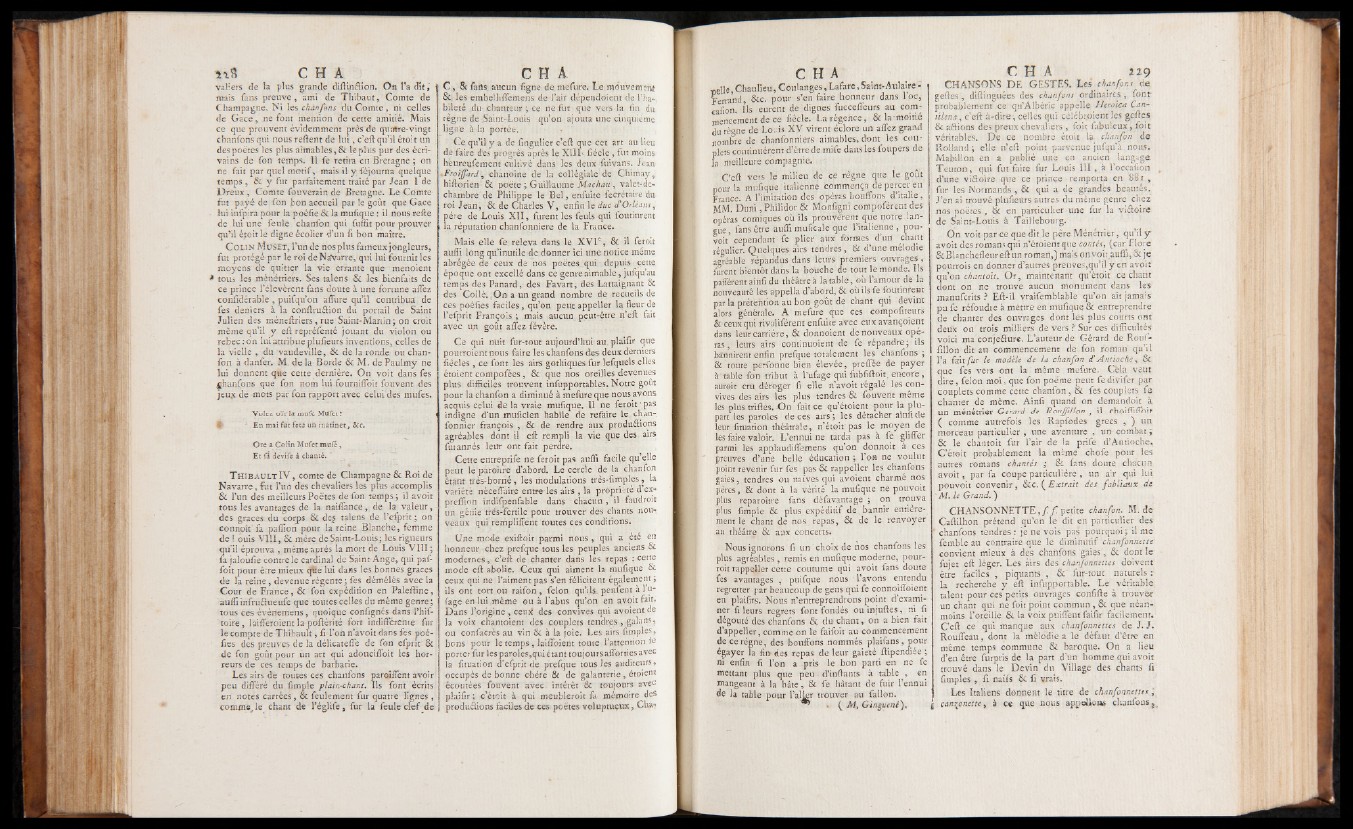
* » i C H A
valiers de la plus grande diftinérion. Ou l’a dît,' i
mais fans preuve, ami de Thibaut, Comte de
Champagne, Ni les chànfons du Comte, ni celles
de G a ce , aie font mention de cette amitié. Mais
ce que prouvent évidemment près de quatre-vingt
chànfons qui nous reftem de lui , c’eft qu’il étoit un
des poètes les plus aimables, & le plus pur des écrivains
de fon temps. 11 fe retira en Bretagne ; on
ne fait par quel motif, mais il y; féjourna quelque
temps , & y fut parfaitement traité par Jean I de
D reux, Comte fouverain de Bretagne. LeComte
fut payé de fon fion accueil par !e goût que Gace
lui infpira pour la poéfie 8c la mufique : il nous refte
de lui une feule chanfon qui fuffit pour prouver
qu’il étoit le digne écolier d’un îi bon maître.
C olin Muset, l’un de nosplus fameux jongleurs,
fut protégé-par le roi de NaVarre, qui lui fournit les
moyens de quitter la vie errante que menoient
tous les ménétriers. Ses talens & les bienfaits de
ce prince l’élevèrent fans doute à une fortune affez
confidérable , puifqu’on affure qu’il contribua de
fes deniers à la conftruéfion du portail de Saint
Julien des méneftriers , rue Saint-Martin; on croit
même qu’il y eft repréfenté jouant du violon ou
rebec : on lui attribue plulieurs inventions, celles de
la vielle , du vaudeville, & de la ronde, ou chan-
fon à danfer. M. de la Borde & M. de Paulmy ne
lui donnent que cette dernière. On voit dans fes
^hanfons que fon nom lui fourniffoit fouvent des
jeux de mots par fon rapport avec celui des mufes.
Volez oïrla mufe MuTet?
1 En mai fut fcts un mâtinet, &c.
Ore a Colin Mufet raufé,
Et fa devife à chanté.
T h ib a u l t IV , comte de Champagne & Roi de
Navarre, fut l’un des chevaliers les plus accomplis
& l’un des meilleurs Poètes de fon temps ; il avoit
tous les avantages de la naiflànee,. de la valeur,
dés grâces, du corps & des talens de l’efprit ; on
connaît fa paillon.pour la reine Blanche, femme
de î ouis V I I I , 8c mère de Saint-Louis ; les rigueurs
qu'il éprouva , même après la mort de Louis VIII ;
fa jalouiie contre le cardinal de Saint-Ange, qui paf-
foit pour être mieux qfie lui dans les bonnes grâces
de la reine, devenue régente ; fes démêlés avec la
Cour de France, & fon expédition en Paleftine,
auffi infruéhieufe que toutes celles du même genre ;
tous ces événemens, quoique confignés dans l’hif-
toire, laifferoient la poftérité fort indifférente fur
le compte de Thibault, fi Ton n’avoit dans fes poé-
fies des preuves de la délicateffe de fon efprit 8c
de fon goût pour un art qui adouciffoit les horreurs
de ces temps de barbarie.
Les airs de toutes ces chànfons pafoiffent avoir
peu différé du fimple plain-chant. Ils font écrits
en notes carrées, oc feulement fur quatre lignes ,
comme, le chant de l’églife, fur la feule clef de
c H A
C , 8c fatîs aucun ligne de mefure. Le mouvement
&i les embelliffemens de l’air dépendoient de fïfoas
bileté du- chanteur ; ce ne fut que vers la fin du
règne de Saint-Louis qu’on ajouta une cinquième
ligne à la portée.
Ce qu’il y a de fingulier c’eft que cet art au lieu
de faire des progrès après le X1IL fiècle , fut moins
hëureijfement cultivé dans les deux fuivans. Jean
.-Froïffard-, chanoine de la collégiale de Chimay,
hiftorien & poète ; Guillaume Machau , valet-de-
chambre de Philippe le B e l, enfuite fecrétaire du.
roi Jean, & de Charles V , enfin le duc d'Orléans
père de Louis X I I , furent les feuls qui foutinrent
la réputation chanfonniere de la France.
Mais elle fe releva dans le X V I e, & il feroit
auffi long qu’inutile de donner ici une notice même
abrégée de ceux de nos poètes qui depuis. ■ cette
époque ont excellé dans ce genre aimable, jufqu’au
temps des Panard, des Favart, des Lattaignant &
des Collé. cOn a un grand nombre de recueils de
ces poéfies faciles, qu’on peut appeller la fleur de
l’efprit François ; mais aucun peut-être n’ eft fait
avec un goût affez févère.
Ce qui nuit fur-tout aujourd’hui au. plaifir que
pourroient nous faire les chànfons des deux derniers
fiècles , ce font les airs gothiques fur lefquéls elles
étoient compofées, & que nos oreilles devenues
plus difficiles trouvent infupportables. Notre goût
pour la chanfon a diminué à mefure que nous avons
acquis celui de la vraie mufique. Il ne feroit’ pas
indigne d’un muficien habile de refaire le chan-i
fonnier françois , 8c de rendre aux produérions
agréables dont il eft rempli la vie que des airs
furannés leur ont fait perdre.
Cette entreprife ne feroit pas auffi facile qu’ elle
peut le paraître d’abord. Le cercle de la chanfon
étant très-borné, les modulations très-fimples, la
variété néce flaire entre-les airs , la propriété d’ex-*
preffion indifpenfable dans chacun , il faudroit
un génie trés-fertile pour trouver des chants nouveaux
qui rempliffent toutes ces conditions.
Une mode exiftoit. parmi nous , qui a été en
honneur chez prefque tous les peuples anciens &
modernes , c’eft de chanter dans les repas : cette
mode eft abolie. Ceux qui aiment la mufique 8c
ceux qui ne l’aiment pas s’en félicitent-également ;
ils ont tort ou raifon , félon qu’ils, penfent à 1 u-
fage en lui .même ou à l’abus qu’on en avoit fait.
Dans l’origine , ceux des convives qui avoient de
la voix chantoient des couplets tendres,. gala ns,
ou confacrés au vin & à la joie. Les airs firnples,
bons pour le temps, laiffoient toute l’attention le
porter fur les paroles,qui étant toujours afforties avec
la fituation d’efprit de prefque tous les auditeurs,
occupés de bonne chère & de galanterie, étoiene
écoutées fouvent avec intérêt & toujours avec
plaifir ; ç’éteit à qui meubleroit fa mémoire des
produélions faciles de ces poètes voluptueux, Ch»?
C H A
«elle, Chaulieu, Coulanges, Lafare, Saint- Aulaîre -
Ferrand, 8cc. pour s’en faire honneur dans l ’oc,
cafion, ils eurent de dignes fucceffeurs au commencement
de ce fiècle. La régence, & la moitié
du règne de Lo:.is X V virent éclore un affez grand
nombre de chanfonniers aimables, dont les couplets
continuèrent d’être de mife dans les foupers de
la meilleure compagnie.
C ’eft vers le milieu de ce règne que le goût
pour la mufique italienne commença de percer en
France. A Limitation des opéras bouffons d’italie,
MM. Duni, Philidor & Monfigni compofèrent des
opéras comiques où ils prouvèrent que notre langue
, fans être auffi muficale que l’italienne , pou-
voit5 .cependant fe plier aux formes d’un chant
régulier. Quelques airs tendres, & d’une mélodie
agréable répandus dans leurs premiers ouvrages,
furent bientôt dans la bouche de tout le monde. Ils
pafférent ainfi du théâtre à la table, où l’amour de la
nouveauté les appella d’abord, 8c où ilsfe foutinrent
par la prétehtion au bon goût de chant qui devint
alors générale. A mefure que ces compofiteurs
& ceux qui rivalifèrent enfuite avec eux avançoient
dans leur carrière, 8c donnoient de nouveaux opéras
, leurs airs coritinuoient de fe répandre; ils
bannirent enfin prefque totalement les chànfons ;
& toute perfonne bien élevée, preffée de payer
à table fon tribut à l ’ufage qui fubfiftoit. encore,
auroit cru. déroger fi elle n’avoit régalé les convives
des airs les plus tendres 8c fouvent même
les plus triftes. -On fait ce qu’étoient ^poiir la plupart
les paroles de ces airs ; les détacher ainfi de
leur fituation théâtrale, n’étoit pas le moyen de
les faire valoir. L’ennui ne tarda pas à fe gliffer
parmi les applaudiffemens qu’on donnoit à ces
preuves d’une belle éducation; l’on ne voulut ■
point revenir fur fes pas & rappeller les chànfons
gaies, tendres ou naïves qui avoient charme nos
pères, & dont à la vérité la mufique ne pouvoit
plus reparoître fans défavantage ; on trouva
plus fimple & plus expéditif de, bannir entièrement
le chant de nos repas, 8c de le renvoyer
au théâtre 8c aux concerts.
Nous ignorons fi un choix de nos chànfons les
plus agréables , remis en mufique moderne, pour-
roit rappeller cette coutume qui avoit fans doute
fes avantages , puifque nous l’avons entendu
regretter par beaucoup de gens qui fe connoiffoient
en plaifirs. Nous n’entreprendrons point d’examiner
fi leurs regrets font fondés ou injuftes, ni fi
dégoûté des chànfons 8c du chant, on a bien fait
d’appeller, comme on le faifoit au commencement
de ce règne, des bouffons nommés plaifans, pour
égayer la fin- des repas de leur gaieté ftipendiée ;
ni enfin fi l’on a pris le bon parti en ne fe
mettant plus que peu d’inftants à table , en
mangeant à la hâte, 8c fe hâtant de fuir l’ennui
de la table pour l’aller trouver au fallon.
** c ( M, Gingueni), g
C H A 229
CHANSONS D E GESTES. Les chanfon., de
geftes , diftinguées des chànfons ordinaires , font
probablement ce qu’Albéric appelle Heroica Can-
tilena, c’eft à-dire ; celles qui céiébr.oient les geftes
8c aérions des preux chevaliers , foit fabuleux, foit
véritables. Dé ce nombrè étoit là chanfon de
Rolland ; elle n’cft point parvenue jufqu’à nous.
Mabilion en a publié une en ancien langage
Teuton, qui fut faite fur Louis III , à l’occafion .
d’une viâoire que ce prince remporta en 881 ,
; fur les Normands , 8c qui a de grandes beautés.
J’en ai trouvé plufieurs autres du même genre chez
.nos poètes , 8c en particulier une fur la viâoire
de Saint-Louis à Taillebourg.
On voit par ce que dit le père Ménétrier, qu’il y
avoit des romans qui n’ètoientque contés, (car flo re
8cBlanchefleur eft un roman,) mais on voit aufti, 8c je
pourrois en donner d’autres preuves,qu’il y en avoit
qu’on chant oit. O r , maintenant qu’étoit ce chant
dont on ne trouve aucun monument dans les
manuferits ? Eft-il vraifemblable qu’on ait jamais
pu fe réfoudie à mettre en mufique 8c entreprendre
de chantçr des ouvrages dont les plus courts ont
deux ou trois milliers de vers ? Sur ces difficultés
voici ma conjedure. L’auteur de Gérard de Rouf-
fillon dit au commencement de fon roman qu’il
l’a fait fur le modèle de la chanfon £ Antioche, &
que fes vers ont la même mefure. Cela veut
dire, félon moi, que fon poème peut fedivifer par
couplets comme cette chanfon, 8c fes couplets fe
chanter de même. Ainfi quand on demandoit à
un ménétrier Gérard de Roujfillon , il choiffifloit
( comme autrefois les Rapfodes grecs , ) un
morceau particulier , une aventure , un- combat;
8c le cbantoit fur l’air de la prife d’Antioche.
C ’éroit probablement la même chofe pour les
autres romans chantés ; 8c fans doute chacun
avoit, par fa coupe particulière , un air qui lui
pouvoit convenir, 8cc. ( Extrait des fabliaux de
' Al. le Grand. )
CH AN SO N N E T T E ,/ /p e tite chanfon. M. de
Caftilhon prétend qu’on le dit en particulier des
chànfons tendres : je ne vois pas pourquoi; il me
femble au contraire que le diminutif chanfonnette
convient mieux à des chànfons gaies, 8c dont le
fujet eft léger. Les airs des chanfonnettes doivent
être faciles , piquants , 8c fur-tout naturels :
la recherche y eft infupportable. Le véritable
talent pour ces petits ouvrages confifte à trouver
un chant qui ne foit point commun , 8c que néanmoins
l ’oreille 8c la voix puiffent faifir facilement.
C’eft ce qui manque aux chanfonnettes de J. J.
Rouffeau, dont la mélodie a le défaut d’être en
même temps commune 8c baroque. On a lieu
d’en être furpris de la part d’un homme qui avoit
trouvé dans le Devin du Village des chants fi
fitnples , fi naïfs 8c fi vrais.
Les Italiens donnent le titre de chanfonnettes ~
çan^oneite, à ce que nous appelions chànfons ?