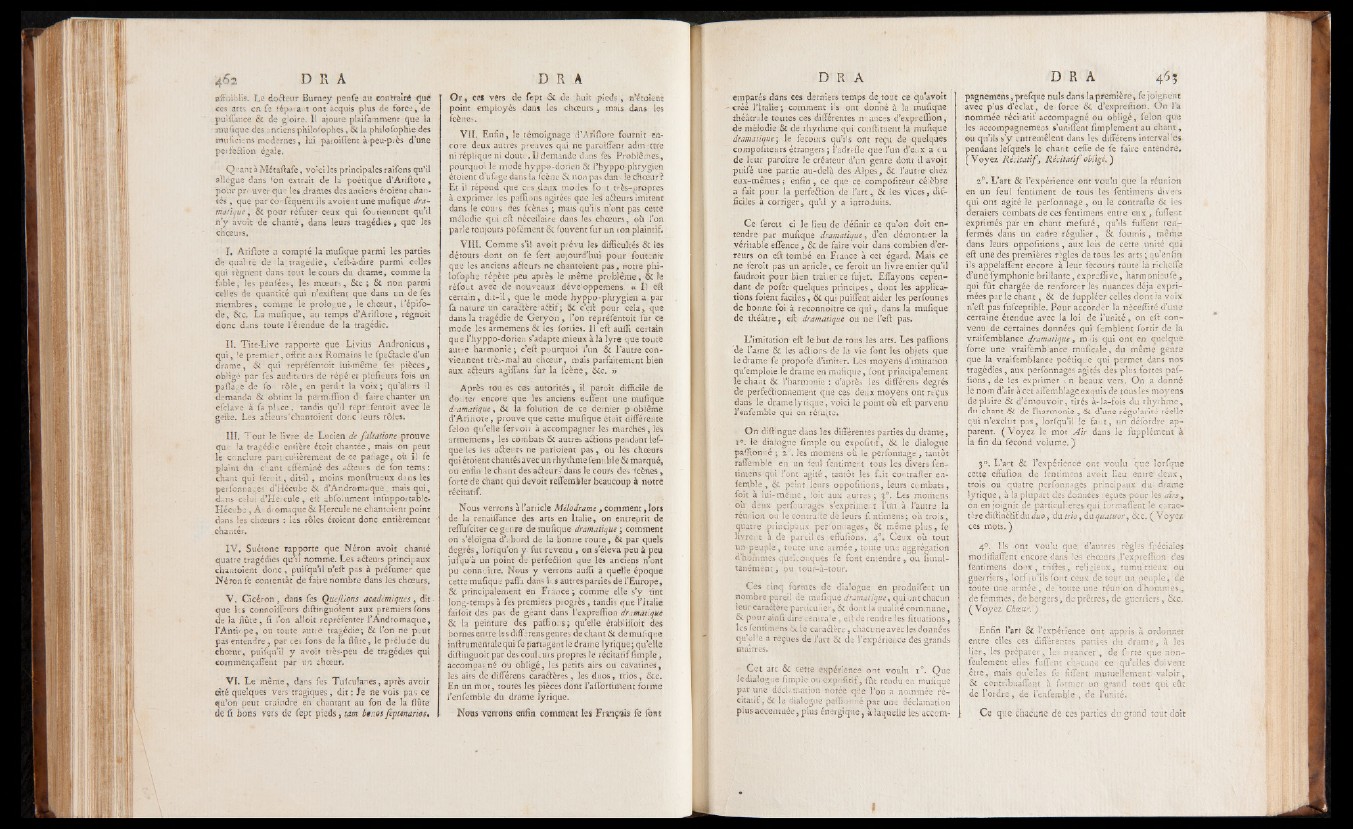
affoiblis. Le doéleur Burney penfe au contfaïrè què
ces arts en fs féparaut ont acquis plus de force, de
puiffance & de gloire. Il ajoure plaifamment que la
mufique des anciens phiîofophes, & la philofophie des
ïrm fi ci e ns modernes, lui paroiffent à-peu-près d’une
perfe&ion égale.
Quant à Métaftafe, voici les principales raifons qu’il
allègue dans fion extrait de la poétique d’Ariftote,
pour prr uver que les drames des anciens éroiénr chantés
, que par conséquent ils avoient une mufique dramatique
, & pour réfuter ceux qui fou tiennent qu’il
n’y avoit de chanté, dans leurs tragédies, que les
choeurs.
I. Ariflote a compté la mufique parmi les parties
de qualité de la tragédie, t ’eft-à-dire parmi celles
qui régnent dans tout le cours du drame, comme la
fable, les penfiées , les moeurs, &c ; & non parmi
celles de quantité qui n’exiftent que dans un de fes
membres, comme le prologue, le choeur, l’épifo-
de, &c. La mufique, au temps d’Ariftote, régnoit
donc dans toute l'étendue de la tragédie.
II. Tite-Live rapporte que Livius Andronicus,
qui, !e premier, offrit aux Romains le fpeéiacle d’un
drame, & qui repréfentoit lui-même fes pièces,
obligé par fes auditeurs de répé er plufieurs fois un
pâfegp de fo' rôle, en perd t la voix; qu’alors il
demanda & obtint la perm.ffion d- faire chanter un
éfclave à fa place, tandis qu’il reprsfentoit avec le
gefte. Les aéleurs'chantoient donc leurs rôles.
III. Tout le livre de Lucien de faltatione prouve
que la tragédie entière étoit chantée, mais on peut
le conclure particulièrement de ce pahage, où il fe
plaint du chant efféminé des aéleurs de fon tems:
chant qui feroit, dit-il , moins monftrueux dans les
perfonnages d’Hécube & d’Andromaque, mais qui,
dans celui d’Hercule, eft abfoiument infupportable-
Hécirbè , A dromaque & Hercule ne chantoient point
dans les choeurs : les rôles étoient donc entièrement
chantés.
IV . Suétone rapporte que Néron avoit chanté
quatre tragédies qu’il nomme. Les a fleur s principaux
chantoient donc , puifqu’il n’eft pas à préfumer que
Néron fe contentât de faire nombre dans les choeurs.
V . Cicéron, dans fes Que fions académiques, dit
que les connoiffieurs diftinguoîent aux premiers fons
de la flûte, fi l’on alloit repréfenter l’Andromaque,
l’Anti/ p e, ou toute autre tragédie; & l’on ne peut
pas entendre, par ces Tons- de la flûte, le prélude du
choeur, puifqu’il y avoit très-peu de tragédies qui
eommençaffent par un choeur.
VI. Le même, dans fes Tùfculanes, après avoir
cité quelques vers tragiques , dit : Je ne vois pas ce
qu’on peut craindre en chantant au fon de la flûte
de fi bons vers de fept pieds, tant ber.os feptmams.
O r , ces vers de fept & de huit pieds, n’étoient
point employés dans les choeurs , mais dans les
fcèires.
VII. Enfin, le témoignage d’Ariftote fournit encore
deux autres preuves qui ne paroiffent adm ittre
ni réplique ni dout:. Il demande dans fes Problèmes,
pourquoi le mode hyppo-dorien & l’hyppo-phrygieft
étoient d’ufage dans la fcène St non pas dans le choeur ?
Et il répond que ces deux modes fo ;t très-propres
à exprimer les pallions agitées que les aâeurs imitent
dans le cours des fcènes ; mais qu’ils n’ont pas cette
mélodie qui eft néceffaire dans les choeurs, où l’on
parle toujours pofément & fouvent fur un ton plaintif.
VIII. Comme s’il avoit prévu les difficultés & les
détours dont on fe fert aujourd’hui pour foutentr
que les anciens aéteurs ne chantoient pas, notre philo
fophe répète peu après le même problème, & fe
réfout avec de nouveaux déveioppemens. « Il eft
certain, dit-il, que le mode hyppo-phrygien a par
fa nature un caraélèreaéÜf ; & c’eft: pour cela, que
dans la tragédie de Geryon , l’on repréfentoit fur ce
mode les armemens & les foriies. Il eft auffi certain
que l’hyppo-dorien s’adapte mieux à la lyre que toute
autre harmonie ; c’eft pourquoi i’un 6c l’autre conviennent
très-mal au choeur, mais parfaitement bien
aux aéteurs agifîans fur la fcène, 6cc. »
Après tou es cés autorités , il paroît difficile de
douter encore que les anciens euffient une mufique
dramatique, & la folution de ce dernier p obiêmé
d’Ariùote, prouve que cette mufique étoit différente
félon qu’elle fer voit à accompagner les marches, les
armemens, les combats 6t autres aéfions pendant lef-
que les les aéteurs ne parloierit pas, ou lès choeurs
qui étoient chantés avec un rhythme fenfible & marqué,
ou enfin le chant des aéleur?dans le cours des "fcènes ,
forte de chant qui devoit reffembler beaucoup à notre
récitatif.
Nous verrons à l’article Mélodrame , comment, lors
de la renaiffance des arts en Italie, on entreprit de
reflùfciter ce genre de mufique dramatique ; comment
on s’éloigna d’abord de la bonne route, & par quels
degrés, lorfqu’on y. fut revenu , on s’éleva peu à peu
jufqu a un point de perfeéfion que les anciens n’ont
pu conncùre. Nous y verrons auffi à quelle époque
cette mufique paffa dans fi s autres parties de l’Europe,
& principalement en France ; comme elle s’y tint
long-temps à fes premiers progrès , tandis que l’Italie
faifoit des pas de géant dans l’expreffion dramatique
& la peinture des pallions; qu’elle établiflbit des
bornes entre les différens genres de chant & de mufique
inftrumentalequi fe partagent le drame lyrique; qu’elle
dîftinguoit par des couLurs propres le récitatif fimple,
accompagné ou obligé, les petits airs ou cavatines,
les airs de différens caraétères , les duos, trios, & c .
En un mot, toutes les pièces dont l’afTortiineiat foi me
i’enfeiftble du drame lyrique.
Nous verrons enfin comment les Français fe font
emparés dans ces derniers temps de tout ce qu’avoit
créé l’Italie; comment ils ont donné à la mufique
théâtrale toutes ces différentes nuances d’expreffion,
de mélodie & de rhythme qui conftituent là mufique
dramatique ; le feçours qu’ils ont reçu de quelques
compoliteurs étrangers; l’adrefïe que l’un d’eux a eu
de leur paroître le créateur d’un genre dont il avojt
puifé une partie au-delà des Alpes, & l’autre chez
eux-mêmes ; enfin , ce que ce com.pofi.teur célèbre
a fait pour la perfeéfion de l’art, & les vices, difficiles
à corriger, qu’il y a introduits.
Ce feroit ci le lieu de définir ce qu’on doit entendre
par mufique dramatique, d’en démontrer la
véritable effence, & de faire voir dans combien d’erreurs
on eft tombé en Fi ance à cet égard. Mais ce
ne feroit pas un article, ce feroit un livre entier qu’il
faudroit pour bien traiter ce fujet. Effayons cependant
de pofer quelques principes, dont les applications
foient faciles , & qui puiffent aider les perfonnes
de bonne foi à reconnoître ce qui, dans la mufique
de théâtre, eft: dramatique ou ne l’eft pas.
L’imitation eft le but de tous les arts. Les pallions
de famé & les aérions de la vie font les objets que
le drame fe propofe d’imiter. Les moyens d’imitarion
qu’emploie le drame en mufique, font principalement
le chant & l’harmonie : d’après les différens degrés
de perfeéfionnement que ces deux moyens ont reçus
dans le drame lyrique, voici le point où eft parvenu
l’enfemble qui en réüiite.
On diftingue dans les différentes parties du drame,
i°. le dialogue fimple ou expofitif, & le dialogue
paffionné ; 2”. les momens où le perfonnage , tantôt
raffemble en un feul fentiment tous les divers fentimens
qui l’ont agité, tantôt les fait contrafier en-
iemble , & peint leurs oppofttions, leurs combats,
foit à lui-meme, foit aux autres; 30. Les momens
où deux perfonrag.es s’exprimer t l’u'n à l’autre la
réunion ou le contracte dé leurs ftntimens; où trois,
quatre principaux personnages, & même plus, fe
livrent à de pareilles effùfions. 40. Ceux où tout
lin peuple, toute une armée, toute une aggrégation
d’hommes quelconques fe font entendre , ou fimul-
tanément, ou tour-à-tour.
Ces cinq formes de dialogue en produifient un
nombre pareil de mufique dramatique, qui ont chacun
leur caraétère particulier, & dont la qualité commune,
& pour ainfi dire centrale, eft de rendreies fituations,
les fentimens 6c le caraétère, chacune avec les données
qu’olfe a reçues de l’art & de l’expérience des grands
maîtres.
Cet art & cette expérience ont voulu i°. Que
le dialogue fimple ou expofitif, fût rendu en mufique
par une déclamation notée que l’on a nommée récitatif,
& le dialogue pallier né par une déclamation
plus accentuée, plus énergique, à laquelle les accompagnemens,
prefque nuis dans la première, fe joignent
avec p-us d’éclat, de force & d’ex pre filon. On la
nommée récitatif accompagné ou obligé, félon que
les accompagnemeos s’unifient Amplement au chant,
ou qu’ils s’y entremêlent dans les différens intervalles
pendant lefqueîs le chant celle de fe faire entendre.
(Voyez Récitatif, Récitatif obligé. )
2,0. L’art & l’expérience ont voulu que la réunion
en un feul fentiment de tous les fentimens divers
qui ont agité le perfionnage, ou le contrafte & les
derniers combats de ces fentimens entre eux , fuffent
exprimés par un chant mefuré, qu’ils fuffent renfermés
dans un cadre régulier , & fournis , même
dans leurs oppofitions, aux lois de cette unité qui
eft une des premières règles de tous les arts ; qu’enfin
ils appelaffent encore à leur fecours toute la ri chef! e
d’une fymphonie brillante, expreffive, harmonieufe ,
qui fût chargée de renforcer les nuances déjà exprimées
par le chant, & de fuppléer celles dont la voix
n’eft pas fufceptible. Pour accorder la néceffité d’une
certaine étendue avec la loi de l’unité, on eft convenu
de certaines données qui fiem bien t fortir de la
vraifemblance dramatique, m us qui ont en quelque
forte une vraifemblance muficale, du même genre
que la vraifemblance poétique qui permet dans nos
tragédies, aux perfonnages agités des plus fortes paf-
fions, de les exprimer < n beaux vers. On a donné
le nom d’air à cet aflemblage exquis de tous les moyens
de pbire & d’émouvoir, tirés à-la-fois du rhythme,
du chant & de l’harmonie , 6t. d’une régularité réelle
qui n’exclut pas, lorfiqu’il le faut, un défordre apparent.
(Voyez le mot Air dans le fupplément à
la fin du fécond volume.}
30. L’art & l’expérience ont voulu que îorfque
cette effufion de fentimens avoit lieu entre deux,
trois ou quatre perfonnages principaux du- drame
lyrique, à la plupart des données : eçues pour les airs,
on en joignît de particulières qui formaffënt le caractère
difti.néfif du duo, du trio, du quatuor, &c. ( Voyez
ces mots. )
4°. Tls ont voulu que d’autres règles fpéciales
modifiaffent encore dans les choeurs .l’expreffion des
fentimens doux, trilles, religieux, tumu'tueux ou
guerriers, lorf .u’ils font ce.ux de tout un peuple, de
toute une armée , de toute une réun’on d’hommes ,
de femmes, de bergers. de prêtres, de guerriers, & c.
( Voyez Choeur. )
Enfin l’art & l’expérience ont appris à ordonner
entre elles ces différentes parties du drame, à les
lier, les préparer, les nuancer , de fi rte que non-
fieulement elles fuffent chacune ce quelles doivent
.être, mais qu’elles fe fiffent mutuellement valoir,
& contribuaffent à former un grand tout qui eû:
de l’ordre, de Kènfemble , de l’unité.
C e que chacune de ces parties du grand tout doit