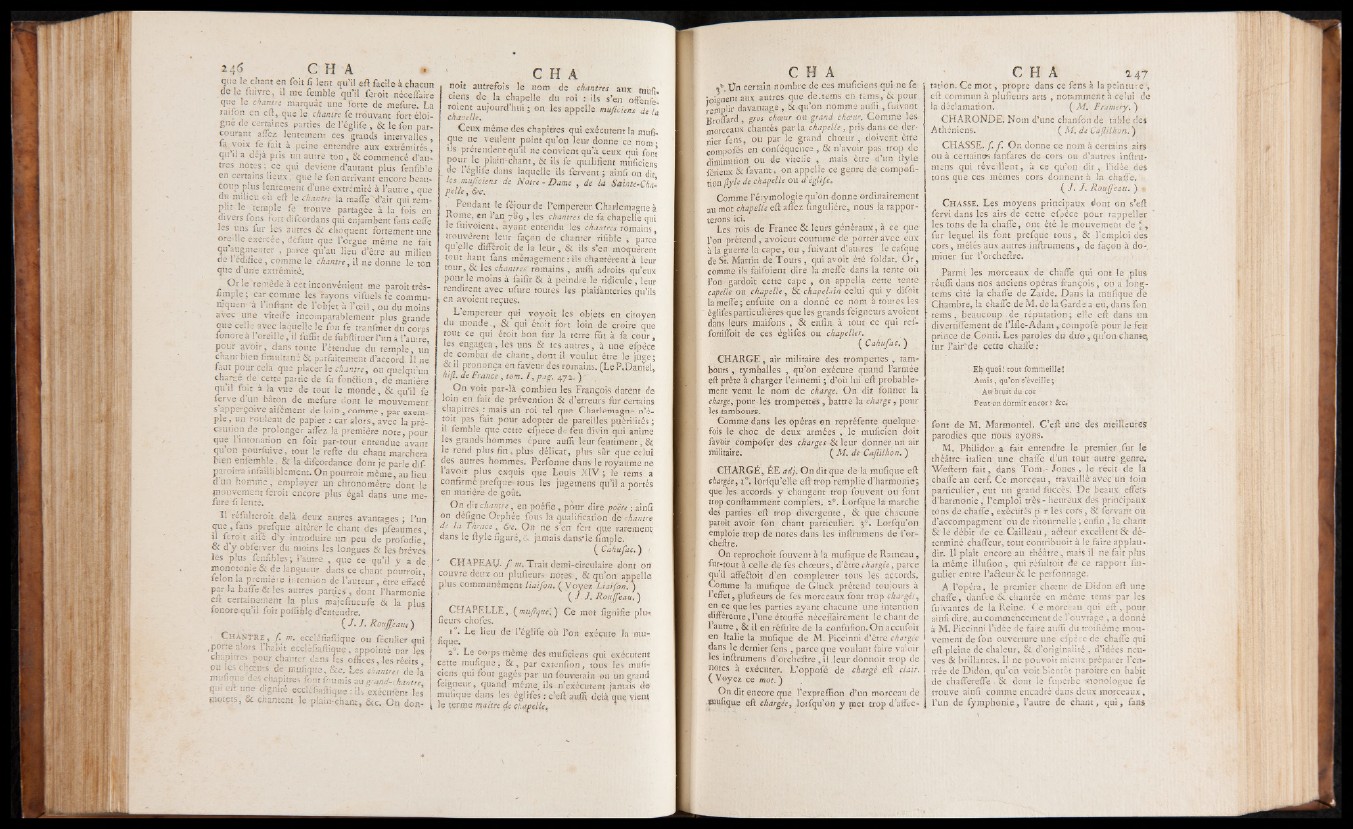
245 C H A
<ju$ le chant en loit fi lent qu’il eft facile à chacun
de le fiûvre, il me femble qu’il {croit nécefiaire
que le chantre marquât une forte de mefure. La
raifon en eft, que le chantre fe trouvant fort éloigné
de certaines parties d e l’églife, & le fon parcourant
a fiez lentement ces grands intervalles ,
te voix fe fait à peine entendre aux extrémités -,
qu il a déjà piis un autre to n , & commencé d’autres
notes ; ce qui devient d’autant plus fenfibîe
en certains lieux, que le fon arrivant encore beaucoup
plus lentement d’une extrémité à l’autre , que
du milieu ou eft le chantre la raaffe 'd’air qui remplit
le temple fe trouve partagée à la fois en
divers fons fort difcordans qui enjambent fans celle
les uns fur les autres & -choquent fortement une
oreille exercée, défaut que l’orgue même ne fait
qu’augmenter , parce qu’au lieu d’être au milieu
de 1 édifice, comme le chantre, il ne donne le ton
que d’une extrémité.
Or le remède à cet inconvénient me paroît très-
fimple ; car comme les rayons vifuels fe comrau-
nîqnem a 1 inftant de l’objet à l’oe il, ou du moins
avec une vîreffe incomparablement plus grande
oue celle avec laquelle le fon fe tranfmet du corps
foncre à l’oreille, il fuffit de fubftituer l ’un à l’auire,
pour avoir, dans toute l’étendue du temple, un
chanr bien firaultané & parfaitement d’accord II ne
faut pour cela que placer le chantre, ou quelqu'un
chargé de cette partie de fa fon&ion, de manière
quil foit à la vue de tout le monde, & qu’il fe
ferve d un bâton de mefure dont le mouvement
5 apperçoive aifément de loin a comme , par exemple
, un rouleau de papier : car alors, avec la précaution
de prolonger allez la première note, pour
que l'intonation en foit par-tour entendue avant
qu’on pourfuive, tout le refte du chant marchera
bien enfemble, & la difçordance dont je parle dif-
paroîtra infailliblement. On pourroit même, au lieu
d’un homme , employer un chronomètre dont le
mouvement fêroit encore plus égal dans une mefure
fi lente.
11 réfulteroit delà deux autres avantages ; l’un
que , fans prefque altérer le chant des pfeaurnes,
il fero:t aife d 'y introduire un peu de profodie *
6 d’y obferver du moins les longues & les brèvei
lës plus fennbles ; l’autre , que ce qu’il ÿ a de
monotonie & de langueur dans ce chant pourroit,
félon la première intention de l’auteur, être effacé
par la baffe & les autres parties , dont l’harmonie
eft certainement la plus majeftueufe & la plus
fonore qu il foit poffiblç d’entendre.
( / . /. Roujfeau* )
• C hantre , f m. eccléfiaftique ou féeulier qui
.porte alors l’habit eccléfiaftique , appointé par les.
chapitres pour chanter dans les offices, les récits
ou les choeurs de mufique, & c . Les chantres de la j
mufique des chapitres font fournis au g'cmd-chantre
qm eft une dignité eccléfiaftique : i l , ‘exécutent les’
îîiotfts, & chantent le plain-chant, &c. On don-
C H A
«oit autrefois le nom de chantres aux mufi.
cieiîs de la chapelle du roi : ils s’en offen fe-
roient aujourd’hui ; on les appelle muficiens de ù
chapelle. V . , a
Ceux même des chapitres qui exécutent la mufi-
que ne veulent point qu’on leur donne ce nom •
ils prétendent qu’il ne convient qu’à ceux qui font
pour le plain-chant, 6c ils fe qualifient muficiens
de léglife dans laquelle ils fervent ; ainfî on dit,
les muficiens de Notre - Dame , de la Sainte-Chapelle,
&c,
1 Pendant le fêjour de.l’empereur Charlemagne à
Rome, en l’an 789 , les chantres de fa chapelle qui
lefuivoient, ayant entendu les chantres romains,
trouvèrent leur façon de chanter rifible 5 parce
qu elle difteroit de la leur, & ils s’en moquèrent
tout haut fans ménagement r iis chantèrent à leur
tour, & les chantres romains , auffi adroits qu’eux
pour le moins à faifir & à peindre le ridicule , leur
rendirent avec ufure toutes les plailanteries qu’ils
, en avoient reçues.
L’empereur qui voyojt lès objets en citoyen
du monde., 8c qui étoit fort loin de çroire que
tout ce qui étoit bon fur la terre fut à fa cour,
les engagea, les uns & les autres, à une efpèce
de combat de chant, dont il voulut être le juge;
& il prononça en faveur des romains. (Le P.Daniel,
: hiß. de France , tom. Ip a g . 472. )
On voit par-là combien les François datent de
loin en fait de prévention & d’erreurs fur certains,
chapitres : mais un roi tel que Charlemagne n’é-
toit pas fait pour adopter de pareilles puérilités ;
il femble que cette efpèce de feu divin qui anime
les grands hommes épure auffi leur fentiment, &
le rend plus fin, plus délicat, plus sûr que celui
des autres hommes. Perfonne dans le royaume ne
lavoit? plus exquis que Louis XIV ; le tems a
confirmé prefque* tous les jugemens qu’il a portés
en matière de goût.
On dit chantre , en poéfie, pour dire poète : ainfi
on defigne Orphée fous la qualification de chantre-
de la Thrace , Sfe.. On ne s’èn fèrt que rarement;
dans le ftyle figuré, <k jamais daps'le fimple.
( Cahüfac. ) -
CH APEAV- f m. Trait demi-cireulaire dont 012
couvre deux ou plufieurs notes , 8c qu’on appelle
plus communément liaifon, ( Voyez Liaifon. )
. ( J . J. Roujfeau. )
CH A PE L L E ,. ( mufique',') Ce mot lignifie plui
fieurs chofes.
• i°. Le lieu deT’églifi? où l’on exécute la mufique.
20. Le corps même des mufiçiens qui exécutent
cette mufique ; & , par extenfion, tous les nmfi-j
çieris qui font gagés par un fouverain ou un grand
feigneur, quand même, ils n’exécutent jamais de
mufique dans les églifes : c’:eft aiiflî, delà que, yient
le terme maître de chapelle^
C H A
Un certain nombre de ces muficiens qui ne fe
joignent aiix autres que de.tems en tems, & pour
remplir- davantage, & qu’on nomme au flî, fuivant
Rroffard, gros choeur ou grand choeur. Comme les
morceaux chantés par la chapelle, pris dans ce dernier
feus j ou par le grand choeur, doivent être
conipofés en conféquence, & n’ayoir pas trop de
diminution ou de vîtelîe , mais être d’un ftyle
férieux Si favant, on appelle ce genre de compofi-
tion (lyle de chapelle ou d’églife.
Comme l’étymologie qu’omdonne ordinairement
au mot chapelle eft allez finguliérè, nous la rapporterons
ici. '
Les rois de France & leurs généraux, à ce que
l’on prétend, avoient coutume de porter avec eux
à la guerre la cape, ou , fuivant d’auires le cafque
de St. Martin de Tours, . qui avoir été foldat. O r ,
comme ils faifoient dire la meffe dans la tente où
Ton gardoit cette cape , on appella cette tente
capelle ou chapelle, & chapelain celui qui y difoit
la meffe; enfuite on a donné ce nom à toutes les
églifes particulières que les grands feigneurs avoient
dans leurs maifons , & enfin* à tout ce qui ref-
fortiffoit de ces églifes ou chapelles.
( Cahufac. )
CHARGE, air militaire des trompettes , tambours
, tymballes , qu’on exécute quand l’armée
eft prête à .charger l’ennemi ; d’où lui eft probablement
venu le nomv de charge. On dit foiîner la
charge,.pour dés trompettes , battre la charge, pour
les tambours.
Comme dans les opéras on repréfente quelquefois
le choc de deux armées , ,le muficien doit
favbir compofer des charges & leur donner un air
militaire. ( M. de Cajlilhon. )
CHARGÉ, ÉE adj. On dit que de la mufique eft
chargée, i°. lorfqu’elle eft trop remplie d’harmonie;
que; les accords y changent trop fouvent qu font
trop conftamment complets. 20. Lorfque la marche
des parties eft trop divergente, & que chacune
paroît avoir fon chant particulier. 3". Lorfqu’on
emploie trop de notes dans les inftrumens de l’or-
olieftre.
On reprochoit fouvent à la mufique de Rameau,
fur-tout à celle de fes choeurs, d’être chargée, parce
qu’il affeâoit d’en completter tous les accords.
Comme la mufique de Gluck prétend toujours à
l’effet, plufieurs de fes morceaux font trop chargés,
en ce que les parties ayant chacune une intention
différente, Tune étouffe néceffairement le chant de
l’autre, 8c il en réfulte de la confufion. On accufoit
en Italie la mufique de M. Piccinni d’être chargée
dans le dernier fens , parce que voulant faire valoir
les inftrumens d’ôrcheftre , il .leur donnoit trop de
notes à exécuter. L ’oppofé de chargé eft clair.
( Voyez ce mot. )
On dit encore que l’expreffion d’ un morceau de
. mufique eft chargée, lorfqu’on y met trop d’affec-
C H A a4?
tation. Ce m o t, propre dans ce fens à la peinture ,
eft commun à plufieurs arts , notamment à celui de
la déclamation. ( M. Framery. )
CHARONDE. Nom d’une chanfon de table des
Athéniens. ( M. de Cajlilhon. )
CHASSE, f. f . On donne ce nom à certains airs
ou à certaines fanfares de cors ou d’autres inftrumens
qui réveillent, à ce qu’on dit , l’idée des
tons que ces mêmes cors donnent à la chafle. .
( /. /. RoujJ'eau. ) «
Chasse. Les moyens principaux donj on s’eft
fervi dans les airs de cette efpèce pour rappeller
les tons de la chaffe, ont été le mouvement de g ,
fur lequel ils font prefque to u s , & l’emploi des
cors, mêlés aux autres inftrumens, de façon à dominer
fur l’orcheftre.
Parmi les morceaux de chaffe qui ont le ,plus
réuffi dans nos anciens opéras françois, on a long-
tems cité la chaffe de Zaïde. Dans la mufique de
Chambre, la chaffe de M. de la Garde a eu, dans fon
tems , beaucoup de réputation; elle eft dans ira
divertiffement de rifle-Adam ,:compofé pour le feu
prince de Coliti. Les paroles du du’o , qu’on chanîç
lur Pair'de cette chaffe ;
Eh quoi! tout fommeille!
Amis, qu’on s’éveille j
Atvbruit du coï
Peur-on dormir encor ? Scc.
font de M. Marmontel. C ’eft une des meilleures
parodies que nous ayons.
M. Philidor a fait entendre le premier .fur le
théâtre italien une chaffe d’un tout autre genre.
Weftern fait, dans T om - Jones, le récit de la
chaffe au cerf. Ce morceau , travaillé'avec un loin
particulier, eut un grand fuccès. De beaux effets
d’harmonie, l’ emploi très - heureux des principaux
tons de chaffe , exécutés p r les cors, & fervant ou
d’accompagment ou .de ritournelle ; enfin , le chant
Sc le débit de ce. Cailleau, aéleur excellent & déterminé
chaffeur, tout contribuoit à le faire applaudir.
Il plaît encore au théâtre, mais il ne fait plus
la même illufion, qui réfultoit de ce rapport fin-
gulier entre l’aéleur & le perfonnage.
A l’opéra, le premier choeur de Didon eft une
chaffe , danfee & chantée en même tems par les
fuivantes de la Reine. Ce morceau qui eft , pour
ainfi dire, au commencement de l’ouvrage , a donné
à M. Piccinni l’idée de faire auffi du troifième mouvement
de fon ouverture une efpèce de chaffe qui
eft pleine de chaleur, & d’originalité , d’idées neuves
& brillantes. Il ne pouvoit mieux préparer l’entrée
de Didon, qu’on voit bientôt paroitre en habit
de chaffereffe . & dont le fuperbe sionoiogne fe
trouve ainfi compte encadré dans deux morceaux,
l’un de fymphonie, l’autre de chant , q u i, fans