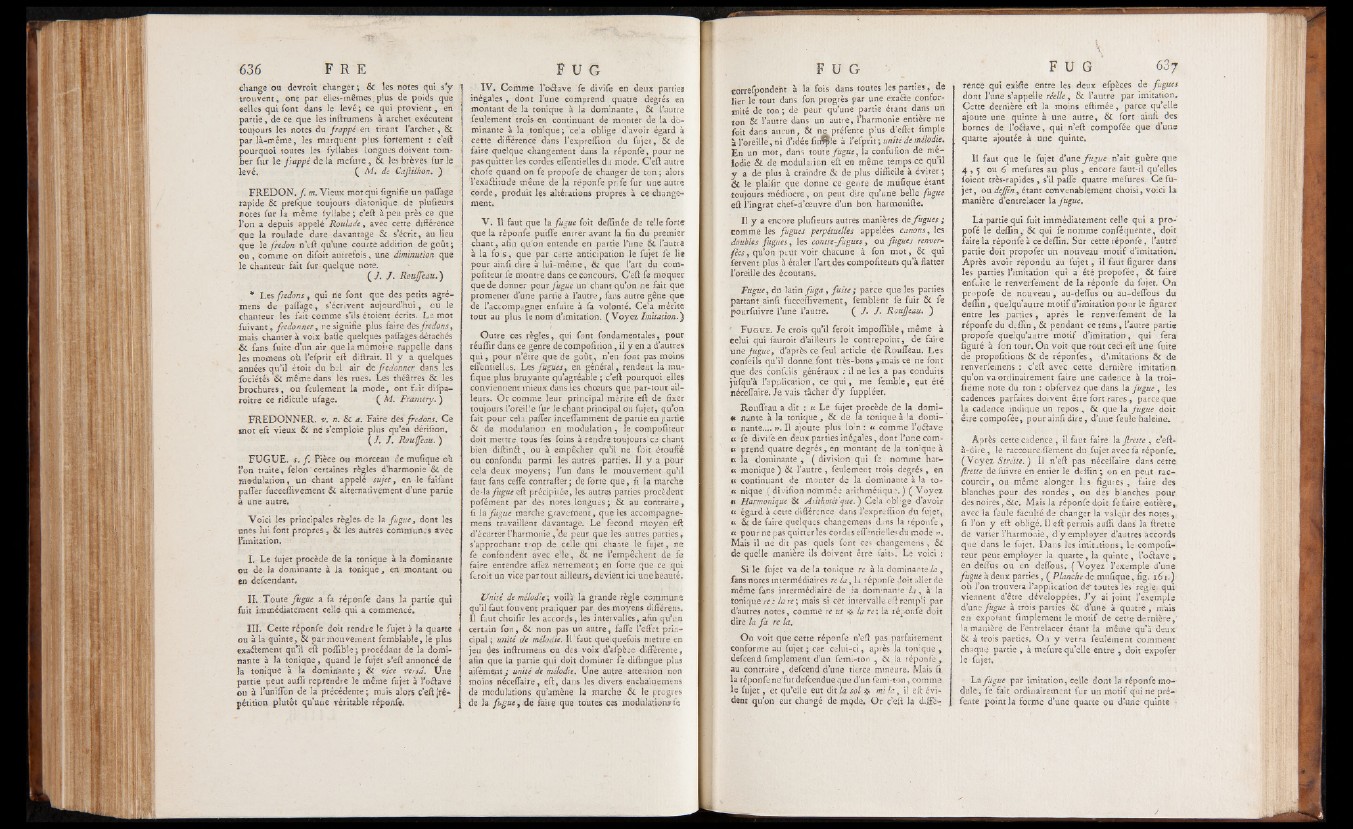
change ou devroit changer; .& les notes qui s’y
trouvent, ont par elles-mêmes. plus de poids que
celles qui font dans le levé; çe qui provient, en
partie, de ce que les inftrumens à archet exécutent
toujours les notes du frappé en tirant l’archet, &
par là-même, les marquent plus fortement : c’eft
pourquoi toutes les fyllabes longues doivent tomber
fur le frappé de la mefure, & les brèves fur le
levé. ( AJ. de Cajlilhon. )
FREDON. f m . Vieux mot qui lignifie un paffage
rapide & prefque toujours diatonique de plufieurs
rotes fur la même fyliabe ; c’eft à peu près ce que
l’on a depuis appelé Roulade, avec cette différence
que la roulade dure davantage & s’écrit, au lieu
que 1 e fredon n'cfl qu'une courte addition de goût;
o u , comme on difoit autrefois, une diminution que
le chanteur fait fur quelque note.
( J. J . Roujfeau. )
* Les fredons, qui rie font que des petits agré-
mens de paffage, s’écrivent aujourd'hui, ou le
chanteur les fait comme s’ils étoient écrits. Le mot
fuivant, fredonner, ne signifie plus faire des fredons,
mais chanter à voix baffe quelques partages détachés
& fans fuite d’un air que la mémoire- rappelle dans
lesmomens oii l’efprit eft diftrait. Il y a quelques
années qu’il étoit du bel air de fredonner dans les
fociétés & même dans les rues. Les théâtres & les
brochures, ou feulement la mode, ont fait difpa-
roître ce ridicule ufage. ( M. Framery. )
FREDONNER, v. n. & a . Faire des fredons. Ce
mot eft vieux & né s’emploie plus qu’en dérifion.
( J. J . R o u f eau. )
FUGUE, s. f Pièce ou morceau de mufique oh
î’on traite r félon * certaines règles d’harmonie & de
modulation, un chant appelé sujet, en le faifant
pafler fuceefîivement & alternativement d’une partie
à une autre.
Voici les principales règles- de la fugue, dont les
unes lui font propres, & les autres communes avec
l’imitation. •
I. Le fujet procède de la tonique à la dominante
ou de la dominante à la tonique, en montant ou
en descendant,
II. Toute fugue a fa réponfe dans la partie qui
fuit immédiatement celle qui a commencé.
III. Cette féponfe doit rendre le fujet à la quarte
ou à la quinte, & par mouvement femblable, le plus
exactement qu’il eft poflible ; procédant de la dominante
à là tonique, quand le fujét s’eft annoncé de
la tonique à la dominante ; & vice versa. Une
partie peut aufîi reprendre le même fujet à l’o&avé
ou à l’uniflbn de la précédente; mais alors c’eft (ré*
pétition plutôt qu’une véritable réponfe.
IV. Comme loétave fe divife en deux parties
inégales , dont l’une comprend quatre degrés en
montant de la tonique à la dominante, & l’autre
feulement trois en continuant de monter de la dominante
à la tonique; 'ce’a oblige d’avoir égard à
cette différence dans l’expreflion du fujet, & de
faire quelque changement dans la réponfe, pour ne
pas quitter les cordes effentielles du mode. C ’eft autre
chofe quand on fe propofe de changer de ton ; alors
l ’exaâitude même de la réponfe pr.fe fur une autre
corde, produit les altérations propres à ce changement.
V . Il faut que la fugue foit deflinée de telle forte
que la réponfe puiffe entrer avant la fin du premier
chant , afin qu'on entende en partie l’une &L l’autre
à la fois, que par cette anticipation le fujet fe lie
pour ainfi dire à lui-même, & que l’art du com-
pofiteur fe montre dans ce concours. C ’eft fe moquer
que de donner pour fugue un chant qu’on ne fait que
promener d’une partie à l’autre, fans autre gêne que
de l’accompagner enfuite à fa volonté. Cela mérite
tout au plus le nom d’imitation. (Voyez Imitation.)
Outre ces règles, qui font fondamentales, pour
réuflir dans ce genre de compofition, il y en a d’autres
qui, pour n’être que de goût, n’en font pas moins
effentielles. Les fugues, en général, rendent la mufique
plus bruyante qu’agréable ; c’eft pourquoi elles
conviennent mieux dans les choeurs que par-tout ailleurs.
Or comme leur principal mérite eft de fixer
toujours l’oreille fur le chant principal ou fujet, qu’on
fait pour cela palier inceflamment de partie en partie
& de modulation en modulation, le compofiteur
doit mettre tous fes foins à rendre toujours ce chant
bien diftinâ, ou à empêcher qu’il ne foit étouffé
ou confondu parmi les autres parties. Il y a pour
cela deux moyens ; l’un dans le mouvement qu’iL
faut fans ceffe contrafter ; de forte que, fi la marche
de-la fugue eft précipitée, les autres parties procèdent
pofément par des notes, longues ; & au contraire,
fi la fugue marche gravement, que les accompagne-
mens travaillent davantage. Le fécond moyen eft
d’écarter l’harmonie, *de peur que les autres parties ,
s’approchant trop de celle qui chante le fujet, ne
fe confondent avec elle, & ne l’empêchent de fe
faire entendre affez nettement; en forte que ce qui
ftroit un vice partout ailleurs, devient ici une beauté.
Unité de mélodie', voilà la grande règle commune
qu’il faut fouvent pratiquer par des moyens différens.
Il faut choifir les accords, les intervalles, afin qu’un
certain fon, & non pas un autre, farte l’effet principal
; unité de mélodie. Il faut quelquefois mettre en
jeu cj-es inftrumens ou des voix defpèce différente,
afin que la partie qui doit dominer fe diftingue plus
aifément ; unité de mélodie. Une autre attention non
moins néceflaire, eft, dans les divers enchaînemens
de modulations qu’amène la marche & le progrès
de la fugue , de faite que toutes ces modulations le
correfponderit à la fois dans toutes les parties, de
lier le tout dans fon progrès par une exaéle conformité
de ton ; de peur qu’une partie étant dans un
ton & l’autre dans un autre, l’harmonie entière ne
foit dans aucun, & ne préfente plus d'effet fimple
à l’oreille , ni d’idée firilple à l’efprit ; unité de mélodie.
En un mot, dans toute fugue, la confufion de mélodie
& de modulaiion eft en même temps ce qu il
y a de plus à craindre & de plus difficile à éviter ;
& le plaifir que donne ce-genre de müfique étant
toujours médiocre, on peut dire qu’une belle fugue
eft l’ingrat chef-d’oeuvre d’un bon harmonifte.
Il y a encore plufieurs autres manières Ae fugues ;
comme les fugues perpétuelles appelées canons, les
doubles fugues, les contre-fugues, ou fugues renver-
fées, qu’on peut voir chacune à fon mot, & qui
fervent plus à étaler l’art..des compofiteurs qu’à flatter
l’oreille des ècoutans.
Fugue, du latin fuga, fuite; parce que les parties
partant ainfi fucceffivement, femblenr fe fuir & fe
pourfuivre l’une l’autre. ( J. J. RouJJeau. )
f Fugue. Je crois qu’il feroit impoflible, même à
telui qui fauroit d’ailleurs le contrepoint, de faire
unq fugue, d’après ce feul article de Roufleau. Les
confeils qu’il donne, font très-bons , mais ce ne font
que des confeils généraux : il ne les a pas conduits
jufqu’à l’application, ce qui, me femble, eut été
néceflaire. Je vais tâcher d’y fuppléer.
Roufleau a dit : « Le fujet procède de la domi-
« nante à la tonique , & de la tonique à la domi-
« nante.... ». Il ajoute plus lo'n : « comme l’o&ave
tt fe divife en deux parties inégales, dont l’une com-
« prend quatre degrés, en montant de la tomque à
« la dominante , ( division qui fs nomme har-
« monique ) & l’autre, feulement trois degrés , en
« continuant de monter de la dominante à la toit
nique’ ( divifion nommée arithmétique.) (V o y e z
«i Harmonique & Arithmét que. ) Cela oblige d’avoir
<t égard à cette différence dans l’exprcffion du fujet,
« & de faire quelques changemens d..ns la réponfe,
« pour ne pas quitter les cordes eflentielle« du mode ».
Mais il ne dit pas quels font ces changemens, &
de quelle manière ils doivent être faits. Le voici :
Si le fujet va de la tonique re à la dominante la ,
fans notes intermédiaires re la, la réponfe doit aller de
même fans intermédiaire de fa donvnanfe la, à la
tonique re; lare', mais si cet intervalle eft rempli par
d’autres notes, comme re ut & la re : la réponfe doit
dire la fa re la.
On voit que cette réponfe n’eft pas parfaitement
conforme au fujet ; car celui-ci, après la tonique ,
defçend Amplement d’un femi-ton , & la réponfe;,
au contraire, defeend d’une tierce mineure. Mais fi
la réponfe ne'fut descendue que d’un femi-ton, comme
le fujet, et qu’elle eut dit la sol # mi la, il eft évident
qu’on eut changé de mqde. Or c’eft la diffëren
c e qu i e x tfte entre les d eux efpèces de fugues
d on t l ’une s’ ap p e lle réelle, & l’au tre par imita tion.
C e t t e dernière eft la moins e f tim é e , pa rc e qu ’e lle
ajou te une q u in te à une a u t r e , ÔC fo r t ainfi des
b o rnes de l’o é la v e , q u i n’eft c om p o fé e q ue d’une
qua rte ajou tée à un e quinte.
I l faut q ue le fuje t d’une fugue n’ait g u è r e q u e
4 , 5 ou 6 mefures au p lu s , encore faut-il q u ’elles
foient très-rapides , s’il p a ffe qua tre m e fu re s . C e fuj
e t , ou dejjin, étant co n v en a b lem en t ch o is i, v o ic i la
man ière d’entrelacer la fugue.
L a partie qu i fuit immédiatement c e lle q u i a p ro -
p o fé le d e f lin , & qu i fe n omme co n fé q u e n te , do it
faire la r ép o n fe à ce de flin . S u r cette r é p o n fe , l’autre
partie do it pro p o fe r un n o u v e au m o t if d’im ita tion .
A p r è s a v o ir rép o n d u au l u j e t , il fa u t figure r dans
les parties l’imita tion qui a été p r o p o fé e , & faire
enfuite le renv erfement de la rép o n fe du fujet. O n
p ro p o fe de n o u v e a u , au-deffus o u au -d effou s du
d e flin , quelqu’autre m o t if d’ imitation p o u r le figu re r
entre les p a r t ie s , ap rè s le r en v e r fem e n t de la
r ép on fe du d e f lin , & p en dant ce t em s , l ’autre partie
p ro p o fe q ue lqu ’au tre m o t if d ’im ita tio n , qu i fera
figuré à fo n tour. O n v o it que tou t cè ci e ft un e fu ite
de propofitions & d e r é p o n fe s , d’ imitations & de
renverfemens : c’eft a v e c ce tte dernière im ita tio n
q u ’on v a ordinairement fa ire une caden ce à la t ro i -
f ièm e note du ton : o b fe rv e z que dans la fugue , les
cadences parfaites d o iven t être fo r t r a r e s , pa rc e que
la cadence ind iqu e un r e p o s , & que la fugue d o it
ê tre c om p o fé e , p o u r ainfi d i r e , d ’une feu le ha le in e.
A p r è s cette cadence , il faut faire la flrette , c’eft-
à -d i r e , le raccourci {Tentent du fuje t a v e c fa rép o n fe .
( V o y e z Streite. ) I l n’eft pas nécefla ire dans ce tte
flrette de fu iv re en entier le deflin ; on e n peu t ra c c
o u r c i r , o u m êm e alonger k s f ig u r e s , faire des
blanches p ou r des rondes , o u des blanches p ou r
des n o ire s , & c . M a is la rép o n fe d o it fe faire en t iè r e ,
a v e c la feu le fa cu lté de changer la v a le u r des n o te s ,,
fi l’on y eft o b lig é . Il e ft permis au fîi dans la flre tte
de va r ie r l’h a rm o n ie , d 'y em p lo y e r d’autres a ccord s
q u e dans le fujet. D a n s les im ita tio n s , le com p o ft-5
teur peu t em p lo y e r la q u a r te , la q u in t e , l’o â a v e ,
en deflus o u en de ffous. ( V o y e z l’ e x emple d’une
fugue à deu x p a rt ie s , ( Planche de m u fiq u e , fig. 161.)
o h l’on trou v e ra l ’ap plication dé ' tou te s les réglés q u i
viennent d’être d é v e lo p p é e s . J’y ai jo in t l’e x em p le
d’une fugue à trois parties & d un e à q u a t r e , mais
en expofaot fimplemen t le m o t if d e cette d e rn iè r e ,'
la man ière de l’entrelacer étant la m êm e qu ’à d eux
& à trois parties. O n y v e r ra fen lëm en t com m en t
ch aque partie , à mefure qu ’e lle en tre , do it e x p o fe r
le fuje t.
L a fugue par im ita tio n , c e lle d o n t la' rép on fe m o d
u le , fe fait o rdinairement fu r un m o t if qù i ne préfente
p o in t la fo rm e d’une qua rte o u d’une qu in te •