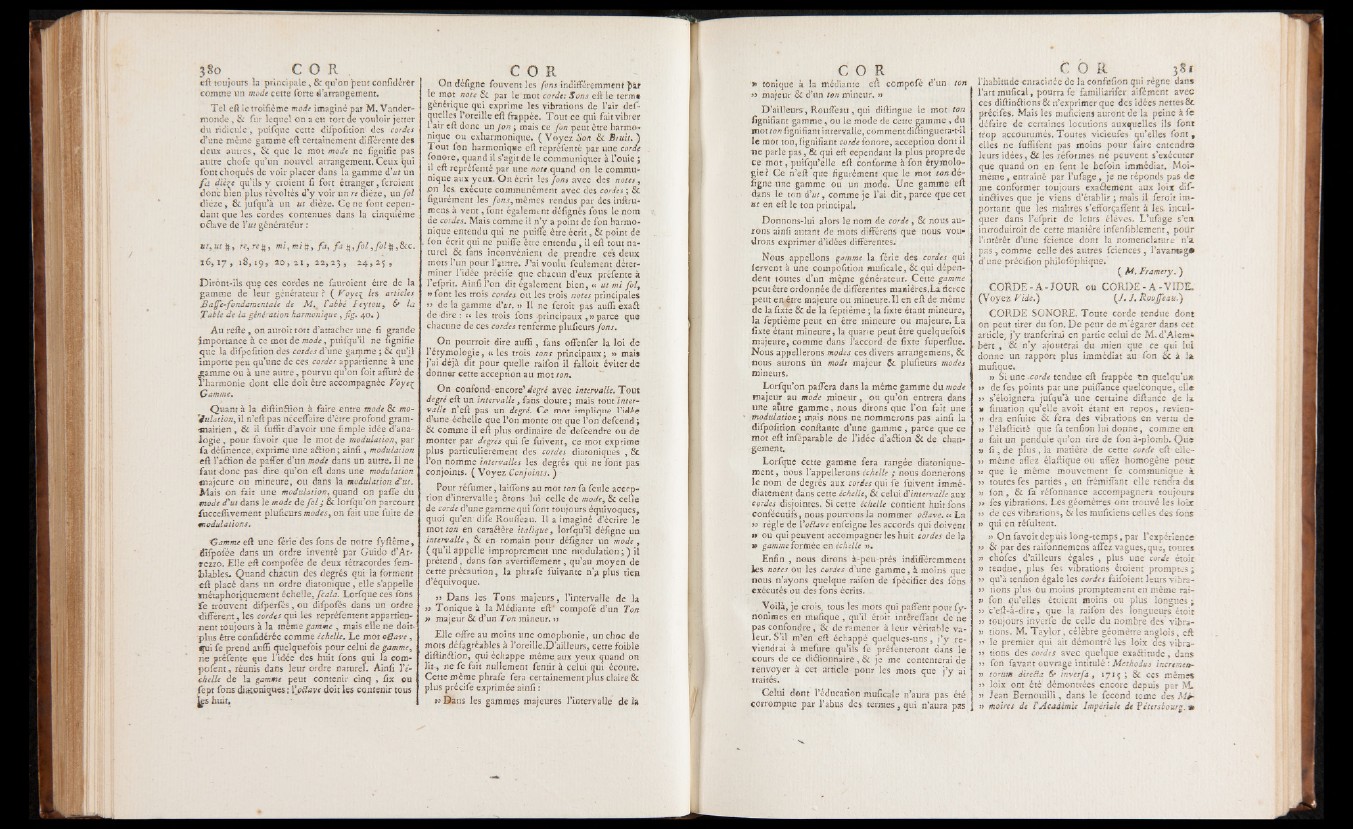
3 § o C O R .
eft toujours la principale, & qu’on peut confidérêr
comme un mode cette forte d’arrangement.
T e l eft le troifième mode imaginé par M. Vander-
monde, 8c fur lequel on a eu tort de vouloir jetter
du ridicule, puifque cette difpofition1 des cordes
d’une même gamme eft certainement différente des
deux autres, & que le mot mode ne fignifie pas
autre chofe qu’un nouvel arrangement. Ceux qui
font choqués de voir placer dans Ta gamme d’#r un
f a dièçe qu’ils y croient fi fort étranger, feroiem
donc bien plus révoltés d’y voir un re dièze, un fol
diè ze, & jufqu’à un ut dièze. Ce ne font cependant
que les cordes contenues dans la cinquième
oélave de 1’«/ générateur :
Vt,ut #, rr,rejj, rai, mi#, fa , fa fol,folH,Scc.
16,17, 18 ,1 9 , 20>2»> 22>23> 24> 25 »
Dirônt-ils que ces cordes ne fauroient être de la
gamme de leur générateur ? ( Voye£ les articles
Jdajfc-fondamentale de A/., l'abbé leytou, & la
fable de la génération harmonique ,fig. 40, )
Au refte, on auroit tort d’attacher une fi grande
importance à ce mot de mode , puifqu’il ne lignifie
que la difpofition des cordes d’une gamme ; & qu’il
importe peu qu’une de ces cordes appartienne à une
-gamme ou à une autre, pourvu qu’on foit affuré de
l ’harmonie dont elle doit être accompagnée Voye%
Qamme.
Quant à la diftinâîon à faire entre mode & modulation,
il n’eft pas néceffaire d’être profond gram-
«îairien , & il fuffit d’avoir une fimple idée d’analogie
, pour favoir que le mot de modulation, par
fa définence, exprime une aôion ; ainfi, modulation
eft l’aâion de paffer d’un mode dans un autre. Il ne
faut-donc pas dire qu’on eft dans une modulation
majeure ou mineure, ou dans la modulation d'ut.
Mais on fait une modulation, quand on pafïe du
mode d'ut dans le mode de fo l; & lorfqu’on parcourt
lucceflivement plufieurs modes, on fait une fuite de
modulations,
'Gamme eft une férié des fons de notre fyftcme,
dîfpofée dans un ordre inventé par Guido d’Ar-
Tezzo. Elle eft compofée de deux tétracordes fem-
Sftables. Quand chacun des degrés qui la forment
•eft placé dans un ordre diatonique, elle s’appelle
métaphoriquement échelle, fcala. Lorfque ce s fons
ïe trouvent difperfés, ou difpofés dans un ordre
•différent, les cordes qui les repréfentent appartiennent
toujours à la même gamme , mais elle ne doit-
plus être confidérée comme échelle. Le mot oQave, ;
qui fe prend auffi quelquefois pour celui de gamme,
ne préfente que l’idée des huit fons qui là com- j
pofent, réunis dans leur ordre naturel. Ainfi IV-
chelle de la gamme peut contenir cinq , fix oui
fept fons diatoniques ; Yottave doit les contenir tous
Jp huit,
C O R
On défigne fouvent les fons indifféremment
le mot note & par le mot corde: Sons eft le tenu®
générique qui exprime les vibrations de l’air def-
cjuelles l’oreille eft frappée. Tout ce qui fait vibrer
1 air eft donc un jon j mais ce fon peut être harmonique
ou exharmonique. (V o y e z Son & Bruit.)
Tout fon harmonique eft reprefenté par une corde
fonore, quand il s’agit de le communiquer à l’ouie ;
il eft repréfenté par une note quand on le communique
aux yeux. On écrit les fons avec des notes,
On les exécute communément avec des cordes ; &
figurément les fons, mêmes rendus par des inftru-
mens à v en t, font également défignès fous le nom
de cordes. Mais comme il nV a point de fon harmonique
entendu qui ne puifle être écrit, & point de
. fon écrit qui ne puiffe être entendu , il eft tout naturel
& fans inconvénient d e . prendre ces deux
mots l’un pour l’autre. J’ai voulu feulement déterminer
l ’idée précife que chacun d’eux préfente à
l’efprit. Ainfi l’on dit également bien, « ut mi fol,
»»font les trois cordes ou les trois notes principales
” de la gamme dV/, » Il ne feroit pas aufîî exaâ
de dire: ci les trois fons -principaux ,» parce que
chacuné de ces cordes renferme plufieurs fons.
On pourroit dire aufîî, farts offenfer la loi de
l’étymologie, <c les trois tons principaux ; » mais
j’ai déjà dit pour quelle raifon il falloit éviter de
donner cette acception au mot ton•
On confond-encore’ degré avec intervalle. Tout
degré eft un intervalle, fans doute ; mais tout intervalle
n’eft pas un degré. Ce mot implique l’idée
d’*une échelle que l’on monte ou que l’on defcend ;
& comme il eft plus ordinaire de defcendre ou de
monter par degrés qui fe fuivent, ce mot exprime
plus particulièrement des cordes diatoniques , &
l’on nomme intervalles les degrés qui ne font pas
conjoints. ( Voyez Conjoints. ) -
Pour réfumer, laiffons au mot ton fa feule acception
d’intervalle.; ôtons lui celle de mode, & celle
de corde d’une gamme qui font toujours équivoques,
quoi qu’en dite Roufteau. Il a imaginé d’écrire le
mot ton en caractère italique, lorfqu’il défigne un
intervalle, & en romain pour défigner un mode ,
(qu’il appelle improprement une modulation;) il
prétend, dans fon avertiffemem, qu’au moyen de
cette précaution, la phrafe fuivante n’a plus rien
d’équivoque.
« Dans les Tons majeurs, l’intervalle de la
» Tonique à la Médiante eft‘ compofé d’un Ton
» majeur & d’un Ton mineur. »»
Elle offre au moins une omophonie, un choc de
mots défagréables à l’oreille.Dailleurs, cette foible
diftinéiion, qui échappe même aux yeux quand on
lit-, ne fe fait nullement femir à celui qui écoute.
Cette même phrafe fera certainement plus claire &
plus précife exprimée ainfi :
» Dans les gammes majeures l’intervalle de la
C O R
» tonique à la médiante eu compofé d’un ton
>» majeur 8c d’un ton mineur. »
D ’ailleursr, Roufteau , qui diftingue le mot ton
lignifiant gamme, ou le mode de cette gamme , du
mot ton fignifiant intervalle, comment diuinguera-t-il
le mot ton, fignifiant corde fonore, acception dont il
ne parle pas, & qui eft cependant la plus propre de
ce m o t, puifqu’elle eft conforme à fon étymologie
? Ce n’eft que figurément que le mot ton dé-
ligne une gamme ou un mode. Une gamme eft
dans le ton d'ut, comme je Fai dit, parce que cet
ut en eft le ton principal.
Donnons-lui alors le nom de corde , & nous aurons
ainfi autant de mots différeris que nous v o u - ,
virons exprimer d’idées différentes.
Nous appelions gamme la férié des cordes qui
fervent à une compofition muficale, & qui dépendent
toutes d’un même générateur. Cette gamme
peut être ordonnée de différentes manières.La tierce
peut en être majeure ou mineure.il en eft de même
de la fixte & de la feptième ; la fixte étant mineure,
la feptième peut en être mineure ou majeure. La
fixte étant mineure, la quarte peut être quelquefois
majeure, comme dans l’accord de fixte fuperflue.
Nous appellerons modes ces divers arrangemens, &
nous aurons ùn mode majeur 8c plufieurs modes
mineurs,
Lorfqu’on paffera dans la même gamme du mode
majeur au mode mineur, ou qu’on entrera dans
une autre gamme, nous dirons que Fon fait une
modulation; mais nous ne nommerons pas ainfi la
difpofition confiante d’une gamme , parce que ce
mot eft inféparable de l’idée d’aélion 8c de changement.
Lorfque cette gamme fera rangée diatoniquement
, nous l’appellerons échelle ; nous donnerons
le nom de degrés aux cordes qui fe fuivent immédiatement
dans cette échelle, & celui d’intervalle aux
cordes disjointes. Si cette échelle contient huit fons
confécutifs, nous pourrons la nommer o&ave. a La
>5 règle de Yodave enfeigne les accords qui doivent
» ou qui peuvent accompagner les huit cordes de la
a» gamme formée en échelle ».
Enfin , nous dirons à-peu-près indifféremment
les notes ou les cordes d’une gamme, à moins que
nous n’ayons quelque raifon de fpécifier des fons
exécutés ou des fons écrits.
, Voilà, je crois, tous les mots qui paffent pour fy-
nonimes en mufique , qu’il étoit intêreffânt de ne
pas confondre , & de ramener à leur véritable valeur.
S’il m’en eft échappé quelques-uns, j’y reviendrai
à mefure qu’ils fe présenteront dans le
cours de ce diélionnaire , & je me contenterai de
renvoyer à cet article pour les mots que j’y ai
traités.
Celui dont l’éducation muficale n’aura pas été
corrompue par l’ahus des termes, qui n’aura pas
C o r 3 § ï
l'habitude enracinée de la confufion qui règne dans
l ’art mufical, pourra fe familiarifer aifément avec
ces diftin&ions & n’exprimer que des idées nettes &
précifes. Mais les muficiens auront de la peine à fe
défaire de certaines locutions auxquelles ils font
ttop accoutumés.Toutes vicieufes qu’elles fo n t ,
elles ne fuffifent pas moins pour faire entendre
leurs idées, & les réformes ne peuvent s’exécuter
que quand on en fent le befoin immédiat. Moi-
même , entraîné par l’ufage, je ne réponds pas de
me conformer toujours exactement aux loix dif-
tinâives que je viens d’établir ; mais il feroit important
que les maîtres s’efforçaffent à les. inculquer
dans l’éfprit de leurs élèves. L ’ufage s’en
imroduiroit de cette manière infenfiblemenr, potir
l’intérêt d’une fcience dont la nomenclature n’a
pas , comme celle des autres fciences , l’a vanta gd
d’une précifion philofôphique.
( M. Framery. )
CORDE - A - JOUR oit CORDE - A - V IDE.
(Voyez Vide.) (/ . J. Roujfeau.)
CORDE SONORE. Toute corde tendue dont
on peut tirer du fon. De peur de m’égarer dans cet
article, j’y tranferirai en partie celui de M. d’Alem*
bert , & n’y ajouterai du mien que ce qui lui
donne un rapport plus immédiat au fon 8c à la
mufique.
»» Si une .corde tendue eft frappée en quelqu’un
» de fes points par une puiffance quelconque, elle
>» s’éloignera jufqurà une certaine diftance de la
» fituation qu’elle avoit étant en repos, revien-
» dra enfuite & fera des vibrations en vertu de
7» Félafticité que fa tenfion lui donne, comme eu
» fait un pendule qu’on tire de fon à-pîomb. Que
» f i , de plus, la matière de cette corde eft eile-
77 même affez élaftique ou affez homogène pour
33 que le même mouvement fe communique à
33 toutes fes parties , en frémiffant elle rendra du
77 fo n , 8c fa réfonnance accompagnera toujours
>» fes vibrations. Les géomètres ont trouvé les loix
33 de ces vibrations, & les muficiens celles des fons
» qui en réfultent.
j» On favoit depuis long-temps, par l’expérience
}> 81 par des raifonnemens affez vagues, que, toutes
» chofes d’ailleurs égales , plus une corde étoit
» tendue, plus fes vibrations étoient promptes ;
33 qu’à tenfion égale les cordes faifoient leurs vibra-
>3 lions plus Ou moins promptement en même rai-
» fon qu’elles étoient moins ou plus longues ;
33 c’eft-à-dire, que la raifon des longueurs étoit
33 toujours inverfe de celle du nombre des vibra-
» tions. M, T a y lo r c é lè b r e géomètre anglois, eft
33 le premier qui ait démontré les loix des vibra-
33 tions des cordes avec quelque exaôitude, dans
»3 fon favant ouvrage intitulé : Metkodus incremcn-
77 torum direSa & inverfa, 1715 ; & ces mêmes
s? loix ont été démontrées encore depuis par M.
t? Jean Bernouilli, dans le fécond tome des A/A-
» moires de Y Académie Impériale de Fétersbourg. »