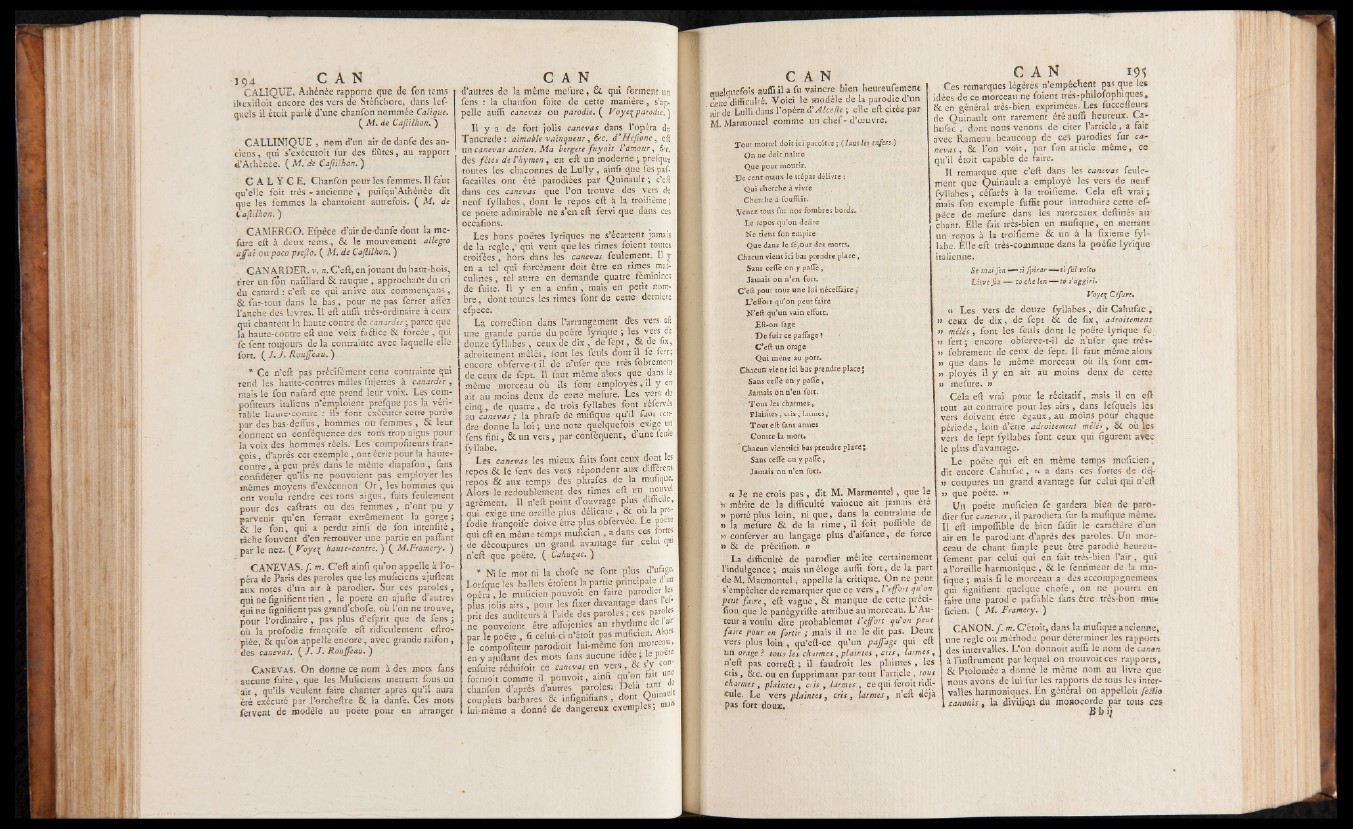
194 C À N
CALIQUE. Athénée rapporte que de fon tems
ihexiftoit encore des vers de Stéfichore, dans lesquels
il étoit parlé d’une chanfon nommée Colique.
( M. de Caßilhon. )
CALLINIQUE , nom d’un air de danfe des anciens,
qui s’exécutoit fur des flûtes, au rapport
«TAthénée. ( M. de Caßilhon. )
C A L Y C E. Chanfon pour les femmes. Il faut
qu’elle foit très - ancienne1, puifqu’Athénée dit
que les femmes la chantoient autrefois. ( M. de
Caßilhon. )
CAMERGO. Efpèce d’air de danfe dont la me-
fure eft à deux tems, & le mouvement allegro
affai ou poco preßo. ( M. de Caßilhon. )
CANARDER. v. n. C ’eft, en jouant du haut-bois,
tirer un fon nafillard & rauque , approchant du cri
du canard : c’ eft ce qui arrive aux commençâtes,
& fur-tout dans le bas, pour ne pas ferrer aflez
Tanche des levres. 11 eft aùfli très-ordinaire à ceux
qui chantent la haute contre de canarder-, parce que
la haute-contre eft une voix faôice & forcée , qui
fe fern toujours de la contrainte avec laquelle elle
fort. ( J» J. Roujfeau. )
* Ce n’eft pas précifément cette contrainte qui
rend les haute-contres mâles Sujettes à canarder ,
mais le fon nafard que prend leur voix. Les com-
pofiteurs italiens Remploient prefque pas la véritable
haute-contre : ils font exécuter cette partie
par des bas deflus, hommes ou femmes , & leur
donnent en conféquence des torts trop aigus pour
la voix des hommes' réels. Les compofiteurs François
, d’après cet exemple , ont écrit pour la haute-
contre , à peu près dans le même diapafon , fans
confidérer qu’ils ne pouvoient pas employer les
mêmes moyens d’exécution O r , les hommes qui
ont voulu rendre ces tons aigus, faits feulement
pour des caftrats ou des femmes-', n’ont -pu y
parvenir qu’en ferrant extrêrpement la gorge;
& le fon, qui a perdu ainff de fon intenfité ,
tâche fouvent d’en retrouver une partie en paflant
par le nez. ( Voye{ haute-contre. ) ( M.Framery. )
CANEVAS./, m. C ’eft ainfi qu’on appelle à l’opéra
de Paris des paroles que les mufreiens ajuftent
aux notes d’un air à parodier. Sur ces paroles ,
qui ne fignifient rien , le poète en ajufte d’autres
qui ne lignifient pas grand’chofe, où Ton ne trouve,
pour l’ordinaire , pas plus cPefpnt que de fensj
où la profodie françoife eft ridiculement eftro-
piée, & qu’on appelle encore, avec grande raifon,
des canevas. ( J . J. Rouffeau. )
C anevas. On donne ce nom à des mots fans
aucune fuite, que les Mufieiens mettent fous un
air, qu’ils veulent faire chanter après qu’il aura
été exécuté par l ’orcheftre & la danfe. Ces mots
fervent de modèle au poète pour en arranger
d’autres de la même mefure, 8c qui forment un
fens : la chanfon faite de cette manière, s’ap-
pelle aufli canevas ou parodie. ( Voyeç parodie, \
Il y a de fort jolis canevas dans l’opéra de
Tancrede : aimable vainqueur, &c. d’Héfione, eft
un canevas ancien. Ma bergere fuyoit Vamour, 6*c,
des fêtés de l'hymen, en eft un moderne ; prefque
toutes les chaconnes de L u lly , ainfi que fes paf*
facailles ont été parodiées par Quinault ; c’eft
dans ces canevas que Ton trouve des vers de
neuf fyllabes, dont Le repos eft à la troifième ;
ce poète admirable ne s’en eft fervi que dans ces
occafions.
Les bons poètes lyriques ne s’écartent jamais
de la réglé," qui vent que les rimes foient toutes
croifées , hors dans les canevas feulement. 11 y
en a tel qui forcément doit être en rimes mai-
culines, tel autre en demande quatre féminines
de fuite. 11 y en a enfin , mais en petit nom*
bre, dont toutes les rimes font de cette- derniere
efpece.
La correction dans l’arrangement des vers eft
une grande partie du poète lyrique ; les vers de
douze ‘fyllabes , ceux de dix , de fept, & de fix,
adroitement mêlés, font les feuls doqt il fe ferr;.
encore obferve-t-îl de n’iifer que tresfobrement
de ceux de fept. Il faut même alors que dans le
même morceau où ils font - employés , il y en
ait au moins deux de Cette mefure. Les vers de
cinq, de quatre, de trois fyllabes font fefervés
au canevas ; la phrafe de mufique qu’il faut rendre
donne la lo i; une note quelquefois^exige un
fens fini, & un vers,' par confisquent, d’une feule
fyllabe.
Les canevas les mieux faits font ceux dont les
repos ,8c le fens des vers répondent aux dlfierens
l repos & aux temps des phrafes de la mufique.
Alors le redoublement des rimes eft un j p j el
agrément. Il n’eft point d’ouvrage plus difficile,
qui exige une oreille plus délicàte , & où la profodie
françoife doive être plus obfervée. Le poete
qui eft en même temps muficien , a dans ces f ortes
de découpures. un grand avantage fur celui q«
n’eft que poète. ( Cahuçac. )
* Ni le mot ni la chofe ne font plus (Tufage.
Lorfque les ballets étoient la partie principale d un
opéra , le muficien pouvoir en faire parodier les
plus jolis airs , pour les fixer davantage dans lei'
prit des auditeurs à l’aide des paroles ; ees paro
ne pouvoient être afiiijettîes au rhythme de a
par le poète , fi celui-ci n’étoit pas muficien.
fe composteur parodioit lui-même fon îuoiceau»
en y ajuftant des mots fans aucune idée ; le p°
enfuite réduifoit ce canevas en v e r s , « s y c™
formoit comme il ponvoit, ainfi qn on tait
chanfon d’après d’autres paroless Delà tani•
couplets barbares & infignifians , dont Qui
lui-même a donné de dangereux exemples; m
C A N
mieltruefois aufli il a fu vaincre bien heureufement
cette difficulté. Voici le modèle de la parodie d’un
air de Lulli dans l’opéra i'Alcejle ; elle eft citée par
M. Marmontel comme un chef- d’oeuvre.
Tout mortel doit ici paroîcre j ( dans* les enfers.)
On ne doit naître
Que pour mourir.
De cent maux le trépas délivre :
Qui cherche à vivre
Cherche à fouffrîr.
yenez tous fur nos fombres bords..
Le repos qu’on defixe.
Ne tient fon empire
Que dans le féjour des morts.
Chacun vient ici bas prendre place
Sans ceflè on y paffe,
Jamais on n’en fort.
C’eft pour tous une loi néceflàire ;
L’cfFort qu'on peut faire
N’eft qu’un vain effort.
Eft-on fage
De fuir ce pafTage î
C’eft un orage
Qui mène au porc.
Chacun vient ici bas prendre place J
Sans cefte on y pafle,
Jamais on n’en fort.
Tous les charmes,
Plaintes, cris, larmes,-
Tout eft fans armes
Contre la mort»
Chacun viéntûci bas prendre place;
Sans cefle on y pafle,
Jamais on n’en fott.
« Je ne crois pas, dit M. Marmontel, que le
V mérite de la difficulté vaincue ait jamais été
« porté plus loin, n iq u e , dans la contrainte de
» la mefure & de la rime, il foit poflible de
» conferver au langage plus d’aifance, de force
» 6c de précifion. »
La difficulté de parodier mérite certainement
l’indulgence; mais un éloge aufli fort, d elà part
de M. Marmontel * appelle la critique. On ne peut
s’empêcher de remarquer que ce vers, l'effort qu on
peut faire, eft vague, 8c manque de cette précifion
que le panégyrifte attribue au morceau. L’Auteur
a voulu dire probablemnt l ’ effort qu'on peut
faire pour en fortir ; mais il ne le dit pas. Deux
vers plus loin , qu’eft-ce qu’ un pajffage qui eft
un orage ? tous les charmes , plaintes , cris, larmes ,
n’eft pas correél ; il faudroit les plaintes , les
tris, 8cc. ou en fupprimant par-tout l’article , tous
charmes, plaintes, cris , Larmes , ce qui feroit ridicule.
Le vers plaintes, cris, larmes, n’eft déjà
pas fort doux.
Ces remarques légères n’empêchent pas que les
idées de-ce morceau ne foient très-phiiofophiques ,
8c en général très-bien exprimées. Les fuccefleurs
de Quinault ont rarement été aufli heureux. Ca-
hufae , dont nous venons de citer l’article, a fait
avec Rameau beaucoup de cRs parodie* fur canevas
, 8c Ton v o it, par fon article même, ce
qu’il étoit capable de faire.
Il remarque .que c’eft dans les canevas feulement
que Quinault a employé les vers de neuf
fyllabes, céfurés à la troifieme. Cela eft vrai ;
mais -fon exemple fuffit pour introduire cette e s pèce
de mefure dans les morceaux deftinés au-
chant. Elle fait très-bien en mufique, en mettant
un repos à la trpifieme 8c un à la fixieme fy llabe.
Elle eft très-commune dans la poéfie lyrique
italienne.
Se mai fen-~ti fpirar— ti fui volto
Lievefia — toche leu — to s'aggiri.
Voye[ Céfure•
« Les vers de douze fyllabes , ' dit Cahufac ;
n ceux de d ix , de fept oc de fix , adroitement
n mêlés, font les feuls dont le poète lyrique fe
m fert; encore obferve-t-il de n’ufer que très-
» fobrement de ceux de fept. Il faut même alors
n que dans le même morceau où ils. font em-
» ployés il y en ait au moins deux de cette
» mefure. »
Cela eft vrai pour le récitatif, mais il en eft
tout au contraire pour les airs , dans lefquels les
vers doivent être égaux, au moins pour chaque
période, loin d’être adroitement mêlés , 8c où Ips
vers de fept fyllabes font ceux qui figurent avec
lè plus d’avantage.
Le poète qui eft en même temps muficien,
dit encore Cahufac, « a dans ces fortes de déf-
n coupures un grand avantage fur celui qui n’eft
» que poète. »»
Un poète muficien fe gardera bien de parodier
fur canevas, il parodiera fur la mufique même.
Il eft impofîible de bien faifir le cara&ère d’un
air en le parodiant d’après des paroles. Un morceau
de chant fimple peut être parodié heureufement
par celui qui en fait trè«»-bien l’a ir , qui
a l’oreille harmonique, 8c le fentiment de !a mufique
; mais fi le morceau a des accompagnemens
qui fignifient quelque chofe, on ne pourra en
faire une parod e pafiable fans être très-bon muficien.
( M. Framery. )
CANON, f m. C ’ étoit, dans la mufique ancienne,
une réglé ou méthode pour déterminer les rapports
des intervalles. L’on donnoit aufli le nom de canon
à l’inftrument par lequel on trouvoitees rapports,
8c Ptoloraée a donné le même nom au livre que
nous avons de lui fur les rapports de tous les intervalles
harmoniques. En général on àppelloit feftio
eanonis 9 la divifiop du monocorde par tous ces