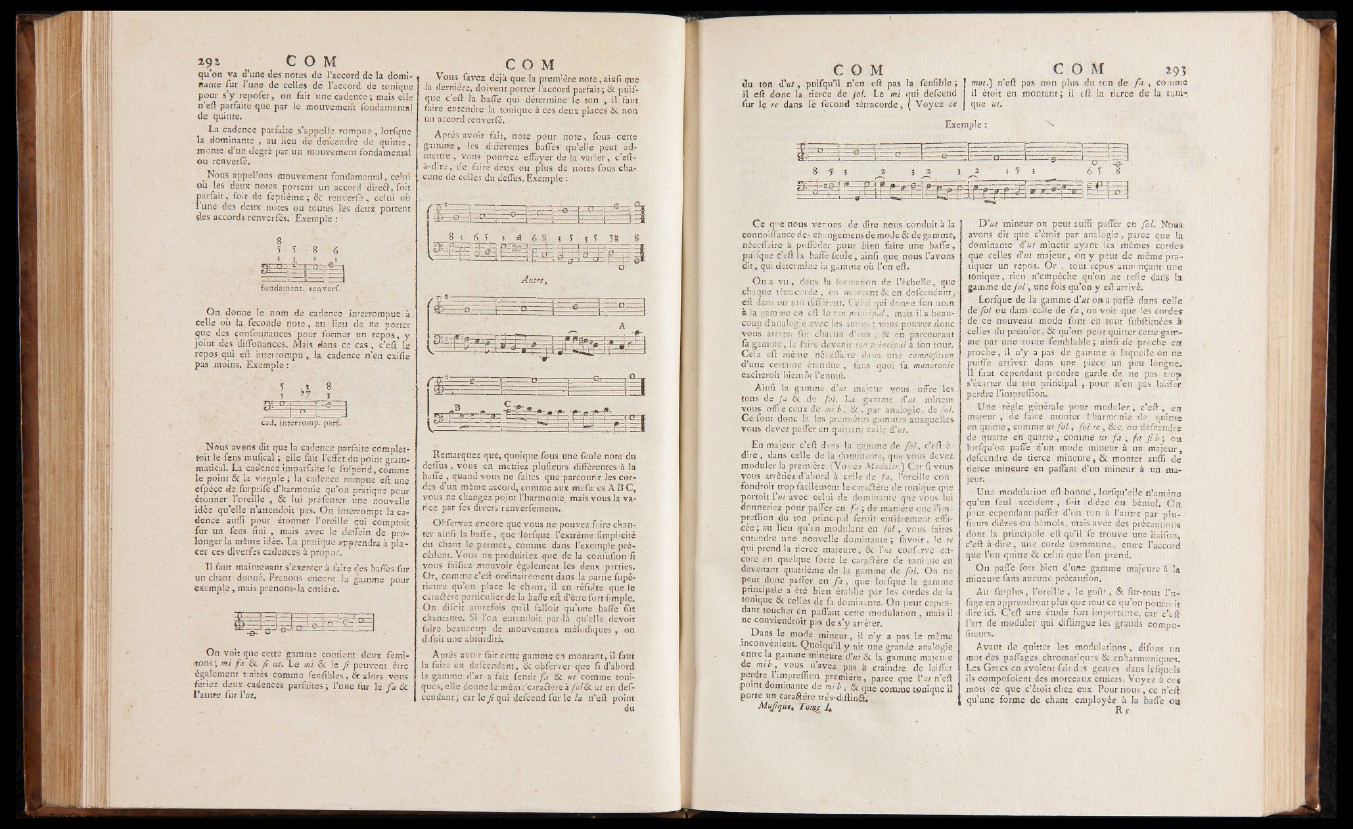
292 G O M
qu’on va d’une des notes de l’accord de la dominante
fur l’une de celles de l ’accord de tonique
pour s’y repofer, on fait ‘une cadence ; mais elle
n’eft parfaite que par le mouvement fondamental
de quinte.
La cadence parfaite s’appelle rompue , lorfque
la dominante , au lieu de defcendre de quinte ,
monte d’un degré par un mouvement fondamental
©u renverfé.
Nous appelions mouvement fondamental, celui
où les deux notes portent un accord âirédj foit
parfait, foit de feptième ; & renverfé, celui où
lu ne des deux notes ou toutes les deux portent
d,cs accords renverfés. Exemple : *
85 5 8 6 .
- 3 1 ? 1 5 —ilStl foijdamcnt. renverf.
On donne le nom de cadence interrompue à
celle où la fécondé note, au lieu de ne porter
que des confonnances pour former un repos,, y
joint des diffonances. Mais dans ce cas , c’eft: le
repos qui eft interrompu, la cadence n’en exifte
pas moins. Exemple :
cad. interromp. parf.
C O M
I Vous^ favez déjà que la première note, ainfv que
| la dernière, doivent porter l ’accord parfait; 8c puif-
que c eft la baffe qui détermine le ton , il faut
faire entendre la tonique à ces deux places 8c non
un accord renverfé.
Après avoir fait, note pour note, fous cette
gamme , les différentes baffes qu’elle peut admettre
, vous pourrez effayer de la varier, c’eft-
à-dire, de faire deux ou plus de notes fous chacune
de celles du deffus. Exemple :
Nous avons dit que la cadence parfaite complet-
toit le fens mufical ; elle fait l’effet du point grammatical.
La cadence imparfaite le fufpend, comme
le point 8c la virgule ; la cadence rompue eft une
efpèce de furprife d’harmonie qu’on pratique pour
étonner l’oreille , & lui préfenter une nouvelle
idée qu’elle n’attendoit pas. On interrompt la cadence
aufli pour étonner l’oreille qui comptoit
fur un fens fini , mais avec le deffein de prolonger
la même idée. La pratique apprendra à placer
ces diverfes cadences à propos.
Il faut maintenant s’exercer à faire des baffes fur
un chant donné. Prenons encore la gamme pour
exemple, mais prenons-la entière.
•-fJ7II
On voit que cette gamme contient deux femi-
ton s; mi fa & f i ut. Le mi Si le f i peuvent être
également traités comme fenfihles, Se alors vous
feriez deux,cadences parfaites ; l’une fur le f a 8c
l ’autre fur \'ut.
Remarquez que, quoique fous une feule note du
deffus, vous en mettiez plufieurs différentes-à la
baffe , quand vous ne faites que parcourir les cordes
d’un même accord, comme aux mefu: es A B C ,
vous ne changez point l’harmonie, mais vous la variez
par fes divers renverfemens..
Ofcfervez encore que vous ne pouvez faire cfean-
ter ainfi la baffe , que 'lorfque l’extrême fimplicité
du chant le permet, comme dans l’exemple précédent.
Vous ne produiriez que de la conf'ufion fi
vous faifiez mouvoir également les- deux parties.
Or, comme c’eft ordinairement dans la partie fupé-
rieure qu’on place le chant, il en réfidte que le
caraôère particulier.de la baffe eft d’être fort fvmple.
On difcit autrefois qu’il failoit qu’une baffe fût
chantante. Si l’on enrendoit par-la qu’elle devoit
faire beaucoup de mouvemens mélodiques , on
d.foit une abfurdité.
Après avoir fait cette gamme en montant, il faut
la faire en defcendant, 8c obferver-que fi d’abord
la gamme à'ut a fait fentir f i & ut comme toni-
quesr elle donne le même'c.iraélèreà fo l Si, ut en defcendant
; car le f i qui defcend fur le la n’eft point
du
C O M C O M 29?
du toft dW , puifqu’il n’en eft pas la fenfible ; | mot.) n’eft pas non plus du ton de fa , comme
i l eft donc la tierce de Jol. Le mi qui defcend J il étoit en montant; il eft la tierce de la font-
fur lç re dans le fécond tétracorde, r Voyez ce J que ut.
Exemple \
8 ■ ? î 2 3 2 ? 2 H î f 3 6 5 »
Ce que nous venons de dire nous conduit à la
connoinànce des changemens de mode & de gamme,
néceffaire à pofféder pour bien faire une baffe,
puifque c’eft la baffe feule, ainfi que nous l’avons
dit, qui détermine la gamme où l’on eft.
On a vu , dans la formation de l’échelle, que
chaque tétracorde , en montant Sc en defcendant,
•eft dans un ton différent. Celui qui donne fon nom
à la gamme en eft le tort principal, mais il a beaucoup
d’analogie avec les autres ; vous pouvez donc
vous arrêter.fur chacun d’eux , 8c en parcourant
fa gamme, le faire devenir ton p-incipal à fon tour.
Cela eft même né ce {faite Haas une compofition
d’une certaine étendue , fans quoi fa monotonie
exciterôît bientôt l’ennui.
Ainfi la gamme dW majeur yoiis offre les
tons de fa &. de fol. La. gamme à'ut mineur
vous offre ceux de mi b, 8c , [fat analogie, de fol.
C e font donc là les premières gammes auxquelles
vous devez paffer en quittant celle dW.
En majeur c’eft dans la gamme de fo l, c’eft-à-
dire , dans celle de la dominante, que vous devez
moduler la première. (Voyez Moduler.) Car fi vous
vous arrêtiez d’abord à celle de fa, l’oreille cou
fondroit trop facilement lecara&êre de tonique que
portoit 1W avec celui de dominante que vous lui
donneriez pour paffer en ƒ> ; de manière que l’im-
preffion du ton principal feroit entièrement effacée;
au lieu qu’en modulant en f o l , vous faites
entendre une nouvelle dominante ; fàvoir, lé re
qui prend la tierce majeure, & Vut confVrve encore
en quelque forte le caraâère de tonique en
devenant quatrième de la gamme de fol. On ne
peut donc paffer en fa , que lorfque la gamme
principale a été bien établie par les cordes de la
tonique 8c celles de fa dominante. On peut cependant
toucher en paffant cette modulation, maïs il
ne conviendrôit pas de s’y arrêter.
. Lfcms le mode mineur, il n’y a pas le même
.inconvénient. Quoiqu’il y ait une grande analogie
entre la gamine mineure dW 8c la gamme majeure
■ VOUS n’avez pas à craindre de laiffer
perdre 1 impremon première, parce que Y ut n’eft
point dominante de mi b , 8c que comme tonique il
porte un caraétere très-diftinâ,
Mufiqu<% Tom /.
DW mineur on peut aufli paffer en fol. Nous,
avons dit que c’étoit par analogie, parce que la
dominante dW mineur ayant les mêmes cordes
que celles dW majeur, on y peut de.même pratiquer
un repos. Or , tout repos annonçant une
tonique, rien n’empêche qu’on ne refie dans la
gamme de f o i , une fois qu’on y eft arrivé.
Lorfque de la gamme dW o n a paffé dans celle
de fol ou dans celle de f a , on voit que les cordes
de ce nouveau mode font en tout fubftiruées £
celles du premier, 8c qu’on peut quitter cette gamme
par une route femblable; ainfi de proche err
proche, il n’y a pas de gamme à laquelle on ne
puiffe arriver dans une pièce un peu longue.
Il faut cependant prendre garde de ne pas trop
s’écarter du ton principal , pour n’en pas laiffer
perdre l’impreflion.
Une règle générale pour moduler, c’eft , en
majeur , de faire monter rharrncnie de quinte
en quinte ; comme ut f o l , fo l re , 8cc. ou defcendre
de.quarte eri quarte, comme ut fa , fa f i b ; ou
lorfqu’on paffe. d’un mode mineur à un majeur,
defcendre de tierce mineure, 8c monter aufli de
tierce mineure en paffant d’un mineur à un majeur.
Une modulation eft bonne", lorfqu’elle n’amène
qu’un feul accident, foit dïèze ou bémol. On
peut cependant paffer d’un ton à l’autre par plusieurs
dièzes ou bémols, niais avec des précautions
dont la principale eft qu’il fe trouve une liaifon,
c’ eft à-dire; une corde commune., entre l’accord
que l’on quitte 8c celui que l’on prend.
On paffe fort bien d’une gamme majeure à la
mineure fans aucune précaution.
Au furplus, l’o reille, le goût, & fur-tout i’u-
fage en apprendront plus que tout ce qu’on pourre it
dire ici. C ’eft une étude fort importante, car c’eft
l’art de moduler qui diftingue les grands compo-
fiteurs.
Avant de quitter les modulations, difons un
mot des paffages chromatiques 8c enharmoniques.
Les Grecs en avoient fait dés genres^ dans lefquels
ils compofoient des morceaux entiers. Voyez à ces
mots ce que c’étoit chez eux. Pour nous, ce n’eft
qu’une forme de chant employée à la baffe ou