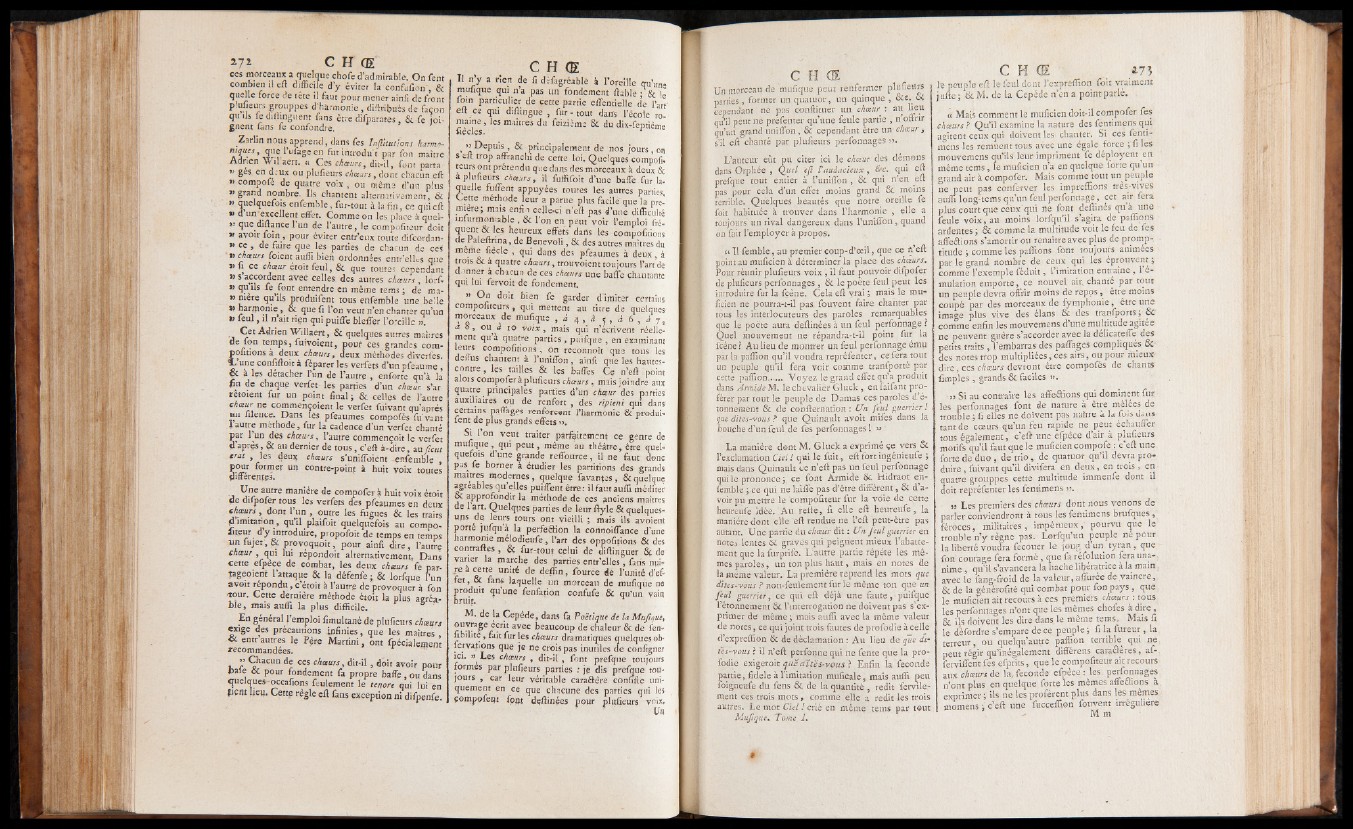
*7* C H CE
ces morceaux a quelque chofe d’admirable. On fent
combien il cil difficile d y éviter la confiifion' &
quelle force de tête il faut pour mener ainfi de front
plufieurs grouppes d’harmonie , diftribués de façon
qu ris fe diftinguent fans être difparates , & fe joignent
fans fe confondre.
Zarlin nous apprend, dans fes Injliiutfons !mrmô~
ntyaer, que l’ufage en fut introdu't par fon maître
Adrien W il’aert. u Ces choeurs, dit-il, font parta
” ê es en drux ou plufieurs choeurs, dont chacun cfl
« compofe de quatre voix , ou même d’un plus
»grand nombre. Ils chantent alternativement, &
' » quelquefois enfemble, fur-tout à la fin, ce qui eft
» d’un-excellent effet. Comme on les place à quel-
13 que diftance 1 un de l’autre, le compofrteur doit
» avoir foin, pour éviter entr’eux toute difcordan-
» c e , de faire que les parties de chacun de ces
» choeurs foient auffi bien ordonnées entr’elles que
3) U ce choeur etoit feul, & que toutes cependant
3> s’accordent avec celles des autres choeurs 3 lorf.
» qu’ils fe font entendre en même tems ; de ma-
» niere qu ils produifent tous enfemble une belle
*» harmonie, & que fi l’on veut n’en chanter qu’un
feu l, il n’ait riçn qui puiffe bleffer l’oreille ».
Cet Adrien Willaert, & quelques autres maîtres
de fon temps, fuivoient, pouf ces grandes cora-
poiitions à deux choeurs, deux méthodes diverfes.
Ci une cônfiftoit a feparer les verfets d’un pfeaume ,
& à les détacher Fun de l’autre, enforte qu’à la
|in de chaque verfet les parties d’un choeur s’ar
rêtoient fur un point final ; & celles de l’autre
choeur ne commençoient le verfet fuivant qu’après
wn filence. Dans les pfeaumes compofés fu.va nt
1 autre méthode, fur la cadence d’un verfet chanté
par 1 un des choeurs, l’autre commençoit le verfet
d aprçs, & au dernier de tous, c’eft à-dire, au ficut
crut , les deujç choeurs s’uniffoient -enfemble ,
P?J?,r ^ori? e^ un contre-point à huit voix toutes
pittereptes.
, a? tre nianière de compofer à huit voix étoit
0e difpofer tous les verfets des pfeaumes en deux
c h oe u r s , dont 1 un , outre les fugues & les traits
0 imitation , qu’il plaifoit quelquefois au compo-
lit,eur d y introduire, propofoit de temps en temps
un fujet, çc provoquoit, pour ainfi dire, l’autre
c h oe u r , qui lui répondoit alternativement, Dans
cette efpèce de combat, les d e u x choe u r s fe par-
tageoient l’attaque & la défenfe ; & lorfque fun
avoit répondu, c etoit à l’autre de provoquer à fon
-tour. Cette dernière méthode étoit la plus agréab
le , mais auffi la plus difficile.
En général l’emploi fîmultané de plufieurs choe u r s
exige des précautions infinies, que les maîtres
Ce entrautres le P£re Martini, ont fpécialement
recommandées.
” Chacun de ces c h oe u r s , dit-il, doit avoir pour
baie & pour fondement fa propre baffe, ou dans
quelques-occafions feulement le tcriore qui lui en
fient hep. Cette règle eft fans exception ni difpenfe.
C H <E
Il n’y a rien de fi dêfagrèablé à l’oreille qu’„ „ .
mufique qui n’a pas un fondement fiable ; & !e
foin particulier de cette partie effentielle.d’e Part’
eft ce qui diftingue , fur - tout dans l’école romaine,
les maîtres du feizième & du dix.fepdème
fie clés.
I ” Depuis , & principalement de nos jours , on
s efi trop affranchi de cette loi. Quelques compofi*
teurs ont prétendu que dans des morceaux à deux &
a plufieurs choeurs, il fuffifoit d’une baffe fur laquelle
fuffent appuyées toutes les autres parties.
Cette méthode leur a parue plus facile que la pre-
miere ; mais enfin celle,ci n’eft pas d’une difficulté I
: înlurmonrable , & l’on en peut voir l’emploi fré-
quent & les heureux effets dafis les compofitions
de Paleftrina, de Benevoli, & des autres maîtres du
mç.mo , 1c^e ’ dans des pfeaumes à deux, à
trois & à quatre choeurs, trouvoient toujours l’art de
d )nner à chacun de ces choeurs une baffe chantante
qui lui fervoit de fondement.
» On doit Bien fe garder d imiter certains I
conjpofiteurs, qui mettent au titre de quelques
morceaux de mufique , à 4 , d 5 , d 6 , d
d 8 , ou d 10 v o ix , mais qui n’écrivent réellement
qu à quatre parties, puifque , en examinant
leurs compofitions , on reeonnoît que tous les
deniis chantent a l ’uniffon, ainfi que les hautes-
contre , les tailles & les baffes C f n’eft point I
alois compofer à plufieurs choeurs . mais joindre aux
quatre principales parties d’un choeur des parties
auxiliaires ou de renfort , des ripieni qui dans
certains paffages renforcent l’harmonie & produifent
de plus grands effets ».
Si 1 on veut traiter parfaitement ce genre de
mufique, qpi peut, même au théâtre, être quelquefois
d une grande reffource, il ne faut donc
PasA fe borner à etudier les partitions des grands
maîtres modernes, quelque favanf es , & quelque
agreableç qu’elles puiffent être: il faut auffi méditer
oc approfondir la méthode de ces anciens maîtres
de l’art. Quelques parties de leur ftyle & quelques-
uns dç leurs tours ont vieilli ; mais ils avoient
porte jufquà la perfeéfion la connoiffance d’une
harmonie mélodieufe, l’art des oppofifions & des
contraires, & fur-tout celui de diftinguer 8ç de
varier la marche des parties entr’elles , fans npia
cette unité de defiin, fource de l’unité d’effet,
& fans laquelle un morceau de mufique ne
produit qu une fenfapon confufe & qu’un vaifl
bruit.
M. de la Cepede, dans fa Poétique de la Mufique,
©uvfage^tit avec beaucoup de chaleur & de fen-
fibilite, fait fur les choeurs dramatiques quelques ob*
fervations que je ne crois pas inutiles de configner
ici. » Les choeurs , dit-il, font prefque toujours
formés par plufieurs parties : je dis prefque toujours
, car leur véritable caraâère cpnfifle uniquement
en ce que chacune des parties qui les
çompQfent font dçfiin^es pour plufieurs voix,
’ Un
C H (S
Un morceau de mufique peut renfermer pî il fleurs
parties , former un quatuor, un quinque , &e. &
cependant ne pas conftituer un choeur^ : au lieu
qu’il peut né préfehter qu’une feule partie , n’offrir
qu’un grand uniffon, & cependant être un- choeur,
s’il efi chanté par plufieurs perfonnages ».
L’auteur eût pu citer ici le choeur des démons
dans Orphée , Quel 'ejl taudacieux, &c. qui efi
prefque tout entier à Funiffon, & qui n’en ëft
pas pour cela d’un effet moins grand & moins
terrible. Quelques beautés que notre oreille fe
foit habituée à trouver dans l’harmonie , elle a
toujours'un rival dangereux dans l’uniffon, quand
on fait l’employer à propos.
et Tl femble, au premier coup-d’oeil, que ce n’eft
point au muficien à déterminer la place des choeurs.
Pour réunir plufieurs voix , il faut pouvoir difpofer
de plufieurs perfonnages , & le poète feul peut les j
introduire fur la fçène. Cela eft yrai ; mais le mu- j
ficien ne pourra-t-il pas, fouvent faire chanter par i
tous les interlocuteurs des paroles remarquables
que le poète aura deftinées à un feul perfonnage ? ■
Quel mouvement ne répandra^t-il point fur la
fçène ? Au lieu de montrer un feul perfonnage ému j
parla paffion qu’il voudra repréfenter, ce'fera tout ;
un peuple qu’il fera voir comme tranfporté par
cette paffion.. ... Vo yez le grand effet qu’a produit
dans Armide M. le chevalier Glu ck, en faifant proférer
par tout le peuple de Damas ces paroles d’étonnement
& de confternation : Un feul guerrier ! 1
que dites-vous ? que Quinault avoit mifes dans la
bouche d’un feul. de fes perfonnages ! »
La manière dont M. Gluck a exprimé çe vers &
l’exclamation Ciel ! qui le fuit, eft fort ingenieufe ;
mais dans Quinault ce n’eft pas un feul perfonnage
qui le prononce;, ce font Armide Sc Hidraot en-,
femble ; ce qui ne laiffe pas d’être different, & d a-
voir pu mettre le compofiteur fur la voie de çette
heureufe idée. Au relie, fi elle eft heureufe, la
manière dont elle eft rendue ne l’eft peut-être pas
autant. Une partie du choeur dit : Un feul guerrier en
notes.lentes & graves qui peignent mieux l’abattement
que la furprife. L'autre partie répète les mêmes
paroles, un ton plus haut, mais en notes de
la meme valeur. La première reprend les mots que
dites-vous ? non-feulement fur le même ton que un
feul guerrier, ce qui eft déjà une Faute, puifque
l’étonnement & l’interrogation ne doivent pas s’exprimer
de même ; mais auffi avec la même valeur
de notes, ce qui joint trois fautes de profodie à celle
d’expreffion & de déclamation : Au lieu de que dites
vous ? il n’eft perfonne qui ne fente que la profodie
exigeroit que dîtes-vous ? Enfin la fécondé
partie, fidele à l’imitation muficale, mais auffi peu
foigneufe dli fens & de la quantité , redit fervile-
raent ces trois mots , comme elle a redit les trois
autres. Le mot Ciel ! crié en même tems par tout
Mufique. Tome 1.
C H ® *73
le peuple eft le feul dont l’expreffion foit vraiment
jufte ; & M. de la Cepéde n’en a point parlé.
« Mais comment le muficien doit-il compofer fes
choeurs ? Qu’il examine la nature des fentimens qui
agitent ceux qui doivent les chanter. Si ces fenti-
mens les remuent tous avec une égale force ; fi les
mouvemens qu’ils leur impriment fe déployent en
même tems, le muficien n’a en quelque forte qu un
grand air à compofer. Mais comme tout un peuple
ne peut pas conferver les impreffions très-vives
auffi long-tems qu’un feul perfonnage, cet air fera
plus court que cëux'qui ne font deftinés qu’à une
feule v o ix , au moins lorfqu il s agira de paffions
ardentes ; & comme la multitude voit le feu de fes
affe&ions s’amortir ou renaître avec plus de promptitude
; comme les paffions font toujours animées
par le grand nombre de ceux qui les éprouvent ;
comme l’exemple féduit, l’imitation, entraîne , 1 e -
mülation emporte, ce nouvel airt chanté par tout
un peuple devra offrir moins de repos, être moins
coupé par des morceaux de fymphonie, être une
image plus vive des élans & des tranfports; &
comme enfin les mouvemens d’une multitude agitée
ne peuvent guère s’accorder avec la delicateffe des
petits traits , l’embarras des paffages compliqués
des notes trop multipliées, ces airs-, ou pour mieux
dire, ces choeurs devront être compofés de chants
fimples , grands & faciles ».
» Si au contraire les affeâions qui dominent fur
les perfonnages font de nature a être melees de
trouble ; fi elles ne doivent pas naître à la fois dans
’ tant de coeurs qu’un feu rapide ne peut échauffer
tous également, c’eft une efpèce d’air à plufieurs
motifs qu’il faut que le muficien compofe c’eft une
forte de duo , de trio, de quatuor qu’il devra produire
, fuivant qu’il divifera en deux, en trois , en
quatre grouppes cette multitude immenfe dont il
doit repréfenter les fentimens ».
» Les premiers des choeurs dont nous venons de
parler conviendront à tous les fentimens brufques ,
féroces, militaires , impétueux, pourvu que le
trouble n’y règne pas. Lorfqu’un peuple né pour
la liberté voudra fecouer le joug; d un tyran , que ~
fon courage fera formé , que fa refolution fera una--
nime, qu’il s’avancera la hache libératrice à la main.
avec le fang-froid de la valeur, affuree de vaincre,
& de la générofité qui combat pour fon pays , que
le muficien ait recours à ces premiers choeurs^ : tous
: les perfonnages n’ont que les memes chofes a dire,
& ils doivent les dire dans le même tems. Mais fi
le defordre s’empare de ce peuple; fila fureur , la
terreur, ou quelqu’aUtre paffion terrible^ qui ne
peut régir qü’inégalement differens caraéieres, af-,
îerviffent fes efprits, que le compofiteur ait recours
aux choeurs de la, fécondé 'efpèce : les perfonnages
n’ont plus en quelque forte les mêmes affeâions à
exprimer ; ils ne les profèrent plus dans les mêmes ,
momens; c’eft une fucçeffion fouvent irrégulière
M m
t