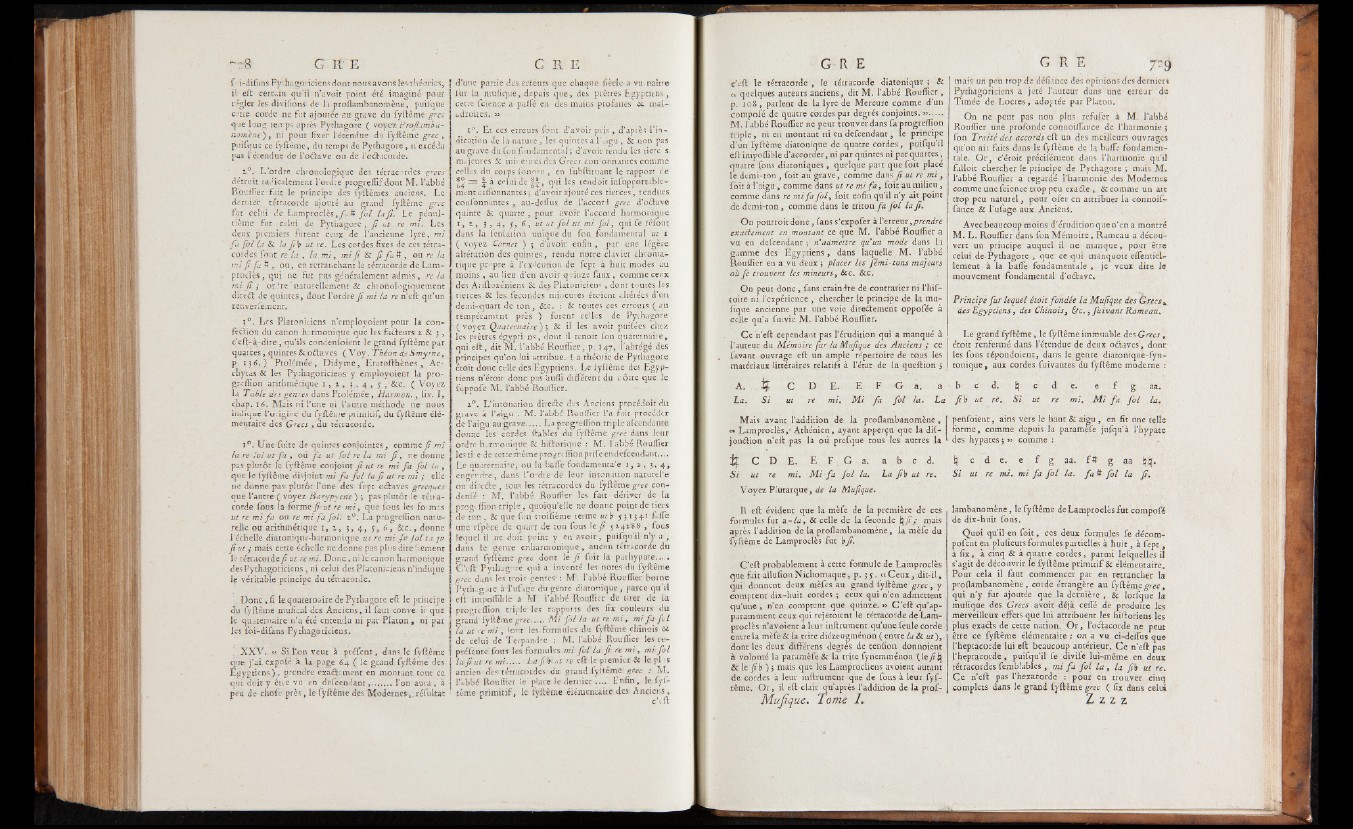
f i-difans Pyrhago: iciens donc nous avons les théories,
il eft certain qu'il a’avoit point été imaginé pour
régler les divifions de la proflambanomène, puifque
cette corde ne fut ajoutée au grave du fyftême grec
que long-temps après Pychagore ( voyez Projl.imba-
norne/ie), ni pour fixer l'étendue du fyftême grec ,
puifque ce lyftème, du temps de P ythagore, n'excéda
pas l’étendue de l'o&ave ou de l’oébacorde.
2.0. L ’ordre chronologique des tétracordes—g^ccr
détruit radicalement l'ordre progreflif dont M. l’abbé
Rouilïer fait le principe des fyftêmes anciens. Le
dernier tétracorde ajouté àu grand fyftême grec
fut celui de Lamproclès,./^ # fo l U fi. Le pénultième
fut celui de P y th a g o r e ,/ ut re mi. Les
deux premiers furent ceux de l’ancienne lyre, mi
fa fo l la & la f b ut re. Les cordes fixes de ces tétra-
cordes font re la , la mi, mi f i & f i fa# , ou re la
mi f i fa %, ou , en retranchant le tétracorde de Lam-
prociès, qui ne fut pas généralement admis, re la
mi f i ; ordre ' naturellement & chronologiquement
direét de quintes, dont l’ordre f i mi la re n’eft qu’un
renver rement.
3°. Les Platoniciens n’employoient pour la confection
du canon harmonique que les facteurs' z & 3,
c’eft-à-dire, qu’ils condenfoient le grand fyftême par
quartes, quintes & oftaves ( V o y . Théon de Smyrne,
p . 136. ) Ptolémée, Didyme, Eratofthènes , Ar-
chytas & les Pythagoriciens y employoient la pro-
grefliôn arithmétique 1 , z , 3., 4 , y , &c. ( V o y ez
la Table de s genres à ans Ptolémée Harmon., \iv. I ,
çhap. 1 6. Mais ni l’une ni l’autre méthode ne nous'
indique l’origine du fyftême primitif, du fyftême élémentaire
des Çrecs , du tétracorde.
r ° . Une fuite de quintes conjointes, comme f i mi
la re [ol ut fa , oû fa ut fol re la mi f i , ne donne
pas plutôt le fyftême conjoint f i ut re mi fa fo l la ,
que le fyftême disjoint mi fa- fo l la f i ut re mi ; elle
ne donne pas plutôt’ l’une des fept oétaves grecques
que l’autre ( voyez Barypycne) J pas plutôt le tétracorde
fous- la- forme f i ut- re mi, que foiis les fo; mes
ut re mi fa ou re mi fa fol. z°. La progreflion naturelle
ou arithmétique 1 , 1 , 3, 4 , 5 , 6, & c . , donne
l’échelle diatonique-harmonique ut re mi fo Jol ta jp
f i ut y mais cette échelle ne donne pas plus direfreinent
le tétracorde fi ut remi. D o n c , ni le canon harmonique
des pythagoriciens, ni celui des Platoniciens n’indique
le véritable principe du tétracorde.
D o n c , i l le quaternaire de Pythagore eft le principe
du Lyftênve mufical des Anciens, il faut conve ir que
le quaternaire-n’a été entendu ni par Platon , ni par
les foi-difans Pythagoriciens.
. X X V . || Si l’on veut à préfent, dans le fyftême
que- j’ai, expofe à la page 64 ( le grand fyftême. des
E g yp tien s), prendre exactement en montant.tout ce
qui doit y être vu en d e f c e n d a i i t l ’on aura , à
peu de chofe près, le fyftême des Modernes,.résultat
d’une partie des erreurs que chaque fiècle a vu naître
fur la mufique, depuis que, des prêtres Egyptiens,
cette fcience a palfé en des mains profanes «St maladroites.
M
i ° . Et ces erreurs font d’avoir p r is , d’après l’ indication
de la nature, les quintes à l’ aigu , Sc non pas
au grave du fon fondamental j d’avoir rendu les tierc s
majeures & mineures des Grecs coivonnantes comme
celles du corps fondre , en fubftituant le rapport ce
= L à celui de § | , qui les rendoit infupportable-
nientcilfonnantesj d'avoir ajouté ces tierces, rendues
confonnantes , au-deffus de l’accord grec d’o&ave
quinte & quarte , pour avoir l’accord harmonique
1 , 1 , 3 , 4 , j , 6, ut ut fo l ut mi fo l, qui fe réfout
dans la fenlàiion unique du fon fondamental ut 1
( voyez Cornet ) j d’avoir enfin , par une légère
altération des quintes, rendu notre clavier chromatique
propre à l’exécution de fept à huit modes au
moins , au lieu d’en avoir quinze faux , comme ceux
des Ariftoxéniens & de,s Platonicien' , dont toutes les
tierces & les fécondés mineures éteient altérées d’un
demi-quart de ton , &c. : & toutes ces erreurs ( au
tempérament près ) furent celles de Pythagore
(v o y e z Quaternaire) 5 & il les avoit puitées chez
les prêtres égypri■ n s , dont il tenoit fon quaternaire,
qui e f t , dit M. l'abbé Rouiller, p. 147, l'abrégé des
principes qu’on lui attribue. ï a théorie de Pythagore
étoit donc celle des Egyptiens. Le lyftême des Egyptiens
n’étoit donc pas aufli différent du rôcre que le
fuppofe M . l'abbé P^oufller.
i ° . L ’intonation directe des Anciens prpcédoit du
grave à l’aigu : M. i’abbé Rouiller l’a fait procéder
de l’aigu au grave.......La progreflion triple afcendante
donne les cordes Stables du fyftême grec- dans leur
ordre harmonique & hiftorique : M. 1 abbé Rouiller
les the de cette même proÿ rc.filon prife en défce'ndant.,,.
Le quaternaire, ou là baffe fondàmenra’ë 1 , 1 , 3, 4 ,
engendre, dans l'ordre de leur intonation naturel'e
ou di’ cd e , tous les tétràcordes du fyftêmegrec con-
denfé : M . l’ àbbé Rouiller les fait dériver de la
progefilon triple, quoiqu’elle ne donne point de tiers
de ton , & que fon troifième terme ut b 531341 f«.iTe
une efpèce de quarr de ton fous le f i 514x88 , fous
lequel il ne doit point y en a voir, puifqu’il n’y a ,
dans le genre enharmonique', aucun tétracorde du
grand fyftême-grec dont le f i foit la parhypate...,*
C ’c-ft Pythagore qui a inventé les notes du fyftême
grec dans les trois genres- : M. l’abbé Rouffier borne
Pythagore à l’ufage du genre diatonique, parce qu'il
eft impoflible à M. l’abbé Rouffier de tirer de la
propreffion triple les rapports des fix couleurs du
grand fyftêmegrec.'.... Mi fo l la ut re mi, mi fa fo l
ta ut renii, <onr les-formules du fyftême chinois &
de celui de Terpandre ; M. l’abbé Rouffier les repréfiente
fous les formulas mi fo l'la f i re mi-, mi fo l
U f i ut re- mi...... La fityuit re eft le premier & le pl s
ancien dW tétràcordes. du. grand fiy.i terne %rec ; M.
l’ abbé Rouffier !e place le dernier .... Enfin, le fyftême
primitif, le fyftême élémentaire des Anciens,
c’eft
tr’eft le tétracorde , le tétracorde diatonique ; 8c
u quelques auteurs anciens, dit M. l’abbé Rouffier.,
p. 10 8 , parlent de La lyre de Mercure comme d’un
compofé de quatre cordes par degrés conjoints. . . . . . .
M . l'abbé Rouffier ne peut trouver dans fa progreflion
triple, ni en montant ni en defeendaat, le principe
d ’un fyftême diatonique de quatre cordes, puifqu’il
eft impofliblè d’accorder, ni par quintes ni par quartes,
quatre fions diatoniques , quelque part que foit placé
le demi-ton, foit au grave, comme dans f i ut re mi ,
foit à l’aigu , comme dans ut re mi fa , foit au milieu,
comme dans re mi fa fo l, foit enfin qu’il n’y ait point
de demi-ton, comme dans le triton fa fo l la fi.
On pourroitdonc, fans s’expofer à l’erreur, prendre
exactement en montant ce que M. l’abbé Rouffier a
vu en defeendant ; n*admettre qu un mode dans 11
gamme dés Égyptiens, dans laquelle M . l’abbé
Rouffier en a vu deux $ placer les fémi-tons majeurs
ou fe trouvent les mineurs, Sec. 6cc.
On peut donc , fans craindre de contrarier ni l’hif-
toïre ni l’expérience , chercher le principe de la mufique
ancienne par une voie directement oppofée à
celle qu’a fuivie M. l’abbé Rouffier.
C e n’eft cependant pas l’érudition qui a manqué à
l’auteur du Mémoire fur la Mufique des Anciens y ce
favant ouvrage eft un ample répertoire de tous les
matériaux littéraires relatifs à l’état de la queftion j
A . J f C D E . E F G a. a
La. Si ut re mi. Mi fa fo l la. La
Mais avant l’addition de la proflambanomène,
« Lamproclès,* Athénien, ayant apperçu que la dif-
jonétion n'eft pas là où prefque tous les autres la
i f C D E . E F G a. a b c d.
S i ut re mi. Mi fa fo l la. La fiifi ut re.
V o y e z Plutarque, de la Mufique.
Il eft évident que la mèfe de la première de ces
formules fut a - la, 8c celle de la fécondé \\fij mais
après l’addition de la proflambanomène , la mèfe du
fyftême de Lamproclès fut bfi.
C ’eft: probablement à cette formule de Lamproclès
que fait allufionNichomaque, p. 35. « C e u x , dit-il,
qui donnent deux méfies au grand fyftême grec, y
comptent' dix-huit cordes ; ceux qui n’en admettent
qu'une, n’en comptent que quinze. » C ’eft qu'ap-
paramment ceux qui rejetoient le tétracorde dç Lamproclès
n’avoient à leur inftrument qu’une feule corde
entre la mèfe & la trite diézeugménon ( entre lu & ut),
dont les deüx différens degrés de tenfion donnoient
à volonté la paramèfe & la trite fynemménon (le_/itj
& le fi b ) 3 mais que les Lamprocliens avoient autant
de cordes à leur inftrument que de fons à leur fyfi-
tême. O r , il eft clair qu’après l’addition <Je la profi-
Mujique. Tome I ,
mais un peu trop de défiance des opinions des derniers
Pythagoriciens a jeté l’auteur dans une erreur de
Timée de L o c res, adoptée par Platon.
On ne peut pas non plus refufer à M. l’abbé
Rouffier une profonde connoiflance de l’harmonie j
fon Traité des accords eft un des meilleurs ouvrages
qu’on ait faits dans le fyftême de la baflV fondamentale.
O r , c’étoit précifément dans l’harmonie qu’il
falloit chercher le principe de Pythagore ; mais M .
l’abbé Rouffier a regardé l’harmonie des Modernes
comme une fcience trop peu exaâ e , & comme un art
trop peu naturel, pour ofer en attribuer la connoif-
fance & l ’ufage aux Anciens.
Avec beaucoup moins d’érudition que n'en a montré
M. L . Rouffier dans fon Mémoire, Rameau a découvert
un principe auquel il ne manque, pour être
celui de-Pythagore , que ce qui manquoic eflentiel-
lement à la baffe fondamentale , je veux dire le
mouvement fondamental d’o&ave.
Principe fur lequel étoit fondée la Mufique des Grecs
des Egyptiens, des Chinois, &c. , fuivant Rameau.
Le grand fyftême, le fyftême immuable des Grecs ,
étoit renfermé dans l’étendue de deux oétaves', donc-
les fons répondoient, dans le genre diatonique-fyn-
tonique, aux cordes fuivantes du fyftême moderne :
b c- d. bj c d e. e f g aa.
fi\> ut re. S i ut re mi. Mi fa fo i la.
| penfoient, ains vers le haut & aigu , en fît une telle
J forme, comme depuis la paramèfe jufqu’à l’hypate
1 des hypates ; « comme ; .
fcj c d e. e f g aa. f # g aa fc|^.
Si ut re mi. mi fa fo l la. fa # fo l la fi.
lambanomène, le fy ftême de Lamproclès fut compofé
de dix-huit fons.
Quoi qu’il en fo i t , ces deux formules fe décom^-
pofent en plufieurs formules partielles à h u it , à fe p t ,
à f ix , à cinq & à quatre cordes, parmi lesquelles il
s’agit de découvrir le fyftême primitif & élémentaire.
Pour cela il faut commencer par en retrancher la
proflambanomène, corde étrangère au fyftême grec ,
qui n’y fut ajoutée que -la dernière , & Iorfque la
mufique des Grecs avoit déjà cefle de produire les
merveilleux effets que lui attribuent les hiftoriens les
plus exaébs de cette nation. O r , l’oétacorde ne peut
être ce fyftême élémentaire : on a vu ci-deflus que
l’heptacorde lui eft beaucoup antérieur. C e n’eft pas
l’heptacorde, puifqu’il fe divife lui-même en deux
tétràcordes femblables , mi fa fo l la , la fib ut re.
C e n’eft pas l’hexaéorde : pour en trouver cinq
complets dans le grand fiyftême ( fix dans celui