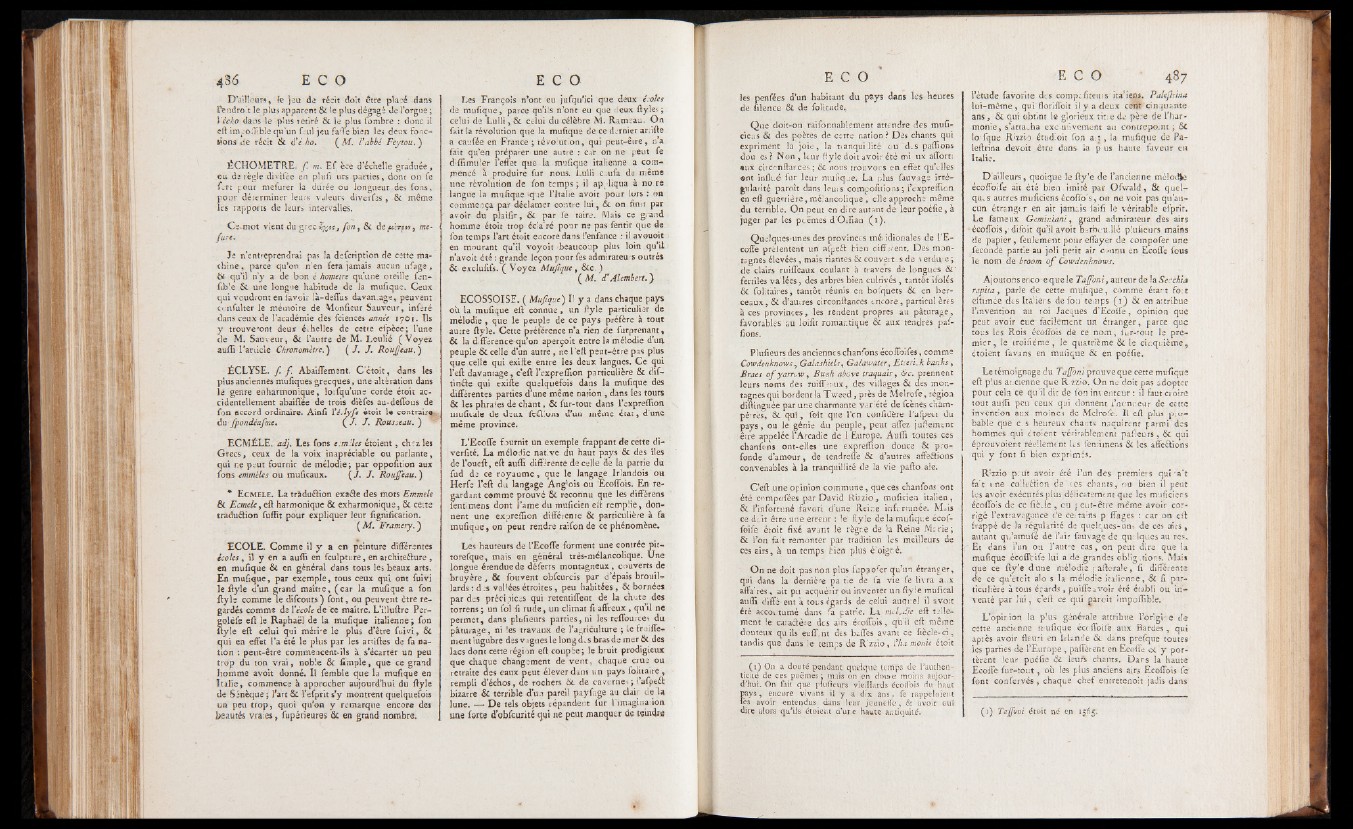
D’ailleurs, le jeu de récit doit être placé dans
Fendrolt le plus apparent 8c le plus dégagé de l’orgue ;
Y écho dans le plus retiré 8c le plus (ombre : donc il
eft impoffible qu'un feul jeu faffe bien les deux fonctions
de récit 8c dV./ro. (M . l’abbé Feytou. )
ÉCHOMETRE, f m. E f èce d’échelle graduée,
.ou de règle divifée en plufi.urs parties, dont on fe
fort pour mefurer la durée ou longueur- des fons,
pour déterminer leurs valeurs diverfes , & même
lès rapports de leurs intervalles.
Ce-mot vient du grec fon, & de fierpov, me-
furc.
Je n’entreprendrai pas la defcription de cette machine,
parce qu’on n’en fera jamais aucun ufage,
& qu’il n’y a de bon é hometre qu’une oreille fon-
fib’.e 8c une longue habitude de la mufique. Ceux
qui voudront en lavoir là-deffus davantage, peuvent
confulter le mémoire de Moniteur Sauveur, inféré
dans ceux de l’académie des fciences année 1701. Ils
y trouveront deux échelles de cette efpèce; l’une
de M. Sauveur, & l’autre de M. Loulié (V o y e z
suffi l’article Chronomètre. ) ( ƒ . ƒ. RouJJeau. )
ÉCLYSE. f. f Abaifferoent. C e to it, dans les
plus anciennes mufiques grecques, une altération dans
le genre enharmonique, loifqu’une corde étoit accidentellement
abaiflée de trois dièfes au-defTous de
fon accord ordinaire. Ainfi Xè.lyfe étoit le contraire*,
d u Jpondéafne, ( J. J. Rousseau. ) ™
ECMÉLE. adj. Les fons e.m'les étoient, chez les I
Grecs, ceux de la voix inapréciable ou parlante,
qui ne peut fournir de mélodie; par oppofition aux
fons emmêles ou muficaux. ( J. J. RouJJeau. )
* Ecmele. La trâduôion exa&e des mots Emmêle
& Ecmele, eft harmonique & exharmonique, 8c cette
traduction fuffit pour expliquer leur lignification.
(Af. F ramer y. )
ECOLE. Comme il y a en peinture différentes
écoles, il y en a aufli en fculpture, en architecture ,
en mufique & en général dans tous les beaux arts.
En mufique, par exemple, tous ceux qui ont fuivi
le ftyle d’un grand maître, ( car la mufique a fon
ftyle comme le difeours) font, ou peuvent être regardés
comme de l'école de ce maître. L’iîluftre Per-
olèfe eft le Raphaël de la mufique italienne ; fon
yle eft celui qui méri'e le plus d’être fuivi, 8t
qui en effet l’a été le plus par les artiftes de fa nation
: peut-être commencent-ils à s’écarter un peu
trop du ton vrai, noble & fimple, que ce grand
homme avoit donné. Il femble que la mufique en
Italie, commence à approcher aujourd’hui du ftyle
de Sénèque ; fart 8c l’efprit s’y montrent quelquefois
un peu trop, quoi qu’on y remarque encore des
beautés vraies, fupérieures & en grand nombre.
Les François n’ont eu jufqu'ici que deux écoles
de mufique, parce qu’ils n’ont eu que deux ftyles ;
celui de Lulli, & celui du célèbre M. Rameau. On
fait la révolution que la mufique de ce dernier ar.ifte
a caufée en France ; révolution, qui peut-être, na
fait qu’en préparer une autre : car on ne peut fe
diffimuler l’effet que la mufique italienne a com-
piencé a produire fur nous. Lulli caufa de même
une révolution de fon temps; il appliqua à no re
langue la mufique->que l’Italie avoit pour lors : on
commença par déclamer contre lui, Ôc on finir par
avoir du plaifir, & par fe taire. Mais ce grand
homme étoit trop écla ré pour ne pas fentir que de
fon temps l’art étoit encore dans l’enfance : il avouoit
en mourant qu’il voyoit beaucoup plus loin qu’il
n’avoit été : grande leçon pourfes admirateurs outrés
& exclufifs. (V o y e z Mufique, 8cc.)
( M. d* Alembert. )
ECOSSOISE. ( Mufique) Il y a dans chaque pays
où la mufique eft connue, un ftyle particulier de
mélodie, que le peuple de ce pays préfère à tout
autre ftyle. Cette préférence n’a rien de furprenanç,
& la différence qu’on aperçoit entre la mélodie d’uiv
peuple & celle d’un autre, ne l ’eft peut-être pas plus
que celle qui exifte entre les deux langues. Ce qui
l’eft davantage, (deft l’expreffion particulière & dif-
tinébe qui exifte quelquefois dans la mufique des
différentes parties d’une même nation , dans les tours
& les phrafes de chant, & fur-tout dans l’expreflion
muficale de deux ferions d’un même état, dun£
même province.
L’Ecoffe fournit un exemple frappant de cette di-
verfité. La mélodie native du haut pays & des îles
de l’oueft, eft auffi différente de celle 3e la partie du
fud de ce royaume, que le langage Irlandois ou
Herfe l’eft du langage An g1 ois ou 'Ecoffois. En regardant
comme prouvé & reconnu que les différens
fentimens dont Lame du muficien eft remplie, donnent
une expreffion différente & particulière à fa
mufique, on peut rendre raifon de ce phénomène.
Les hauteurs de l’Ecoffe forment une contrée pit-
torefque, mais en général très-mélancolique. Une
longue étendue de déferts montagneux , couverts de
bruyère, & fouvent obfcurcis par d’épais brouiU
lards : des vallées étroites, peu habitées , 8c bornées
par des précipices qui retendirent de la chute des
torrens ; un fol fi rude, un climat fi affreux , qu’il ne
permet, dans plufieurs parties, ni les reffources du
pâturage, ni les travaux de l’agriculture ; le froiffe-r
ment lugubre des vagues le longd.s bras de mer & des
lacs dont cette région eft coupée ; le bruit prodigieux
que chaque changement de vent, chaque crue ou
retraite des eaux peut élever dan* un pays folitaire ,
rempli d’échos, de rochers 8c de cavernes; l’afpeél
bizarre & terrible d’un pareil payfage au clair de h
lune. — De tels objets répandent fur l’imaginarion
une forte d’obfcurité qui ne peut manquer de teindre
les penfées d’un habitant du pays dans les heures
de filence & de folitude.
Que doit-on raifonnablement attendre des mufi-
ciens & des poètes de cette nation ? Des chants qui
expriment la joie, la t»anqui lité ou d^s pallions
dou es? Non , leur ftyle doit avoir été mi ux afforti
aux circcnftarces ; & nous trouvons en effet qu’elles
®nt inflt.é fur leur mufique. La plus fauvage irrégularité
paroît dans leuis compofitions ; l’exprefficn
en eft guerrière, mélancolique, elle approche même
du terrible. On peut en dire autant de leur poéfie, à
juger par les pcëmes d'Offian (1 ).
Quelques-unes des provinces méiidionales de l’E-
cofî’e prélentent un alpeâ bien différent. Des montagnes
élevées, mais riantes 8c couvert , s de v e rd ie ;
de clairs ruiffeaux coulant à travers de longues & ’
fertiles valées, des arbres bien cultivés, tantôt ifolés
& folitaires, tantôt réunis en bofquets 8c en berceaux,
8c d’aujres circonftances encore, particul ères
à ces provinces, les rendent propres au pâturage,,
favorables au loifir romantique 6c aux tendres paf-
fions.
Plufieurs des anciennes chanfons écoffoifes, comme
Cowdenknows, Galashiels, Galawater, EtierLk banks,
Braes o f yarrow, Bush above traquair, &c. prennent
leurs noms des ruiffi;-ux, des -villages & des montagnes
qui bordent la Tweed, près de Melrofe, région
diftinguée par une charmante variété de fcènes chàm-
pê-rès, 8c qui, foit que l’cn confidère l ’afpect du
pays, ou le génie du peuple, peut affez juftemtnt
être appelée l’Arcadie de 1 Europe. Aufli toutes ces
chanfons ont-elles une expreffion douce 8c profonde
d’amour, de tendreffe 8c d’autres affections
convenables à la tranquillité de la vie pafto.ale.
C ’eft une opinion commune, que ces chanfons ont
été compofées par David Rirzio, muficien italien,
&.lî|infortuné favori d’une Reine infortunée. Mais
ce dclt être une erreur : le ftyle de la mufique écof-
foife étoit fixé avant le règne de la Reine Mt rie;
& l’on fait remonter par tradition les meilleurs de
ces airs, à un temps bien plus éloigné.
On ne doit pas non plus fup^ofor qu’un étranger,
qui dans la dernière pa tie de fa vie fe livra a,.x
affa:res, ait pu acquérir ou inventer un ftyle mufical
auffi diffé ent à tous égards de celui auquel il avoit
été accoutumé dans fa patrie. La mcLdie eft tellement
le caiacière des airs éeoffois, quil eft même
douteux qu ils euff.nt des baffes avant ce fiècle-ci,
tandis que dans le temns de R'zzio, i’h.i monte étoit
(1) On a douté pendant quelque temps de l'authenticité.
de ces poèmes; mais on en doux e moins aujourd’hui.
On lait que plufieurs vieillards écoifoîs du haut
pays, encore vivans il y a dix âns, fe rappel oient
lès avoir entendus dans leur jeuneiïe, & avoir ouï
dire alors qu’ils étoient d’ur.e haute antiquité.
l’étude favorite des compcfiteuis ita:iens. Palefirina
lui-même, qui floriffoit il y a deux cent cinquante
ans, & qui obtînt le glorieux tit.e de père de l’harmonie,
s’attacha exeufivement au contrepoint; 6c
lo fque R'izlo étudioit fon ai t , la mufique de Pa-
leftrina devoit être dans la p us haute faveur en
Italie.
D'ail leurs, quoique le fty’e de l’ancienne mélodie
écoffoife ait été bien imité par Ofwald, & quelques
autres muficiens écofio's, on ne voit pas qu’aucun
étranger en ait jamais faifi le véritable efprir.
Le fameux Gemïnïanï, grand admirateur des airs
ecoffois ,• dilbit qu’il avoit bambou.Ile plufieurs mains
de papier, feulement pour effayer de compofer une
fécondé partie au joli petit air ou nu en Ecoffe fous
le nom de broorn o f Cowdenknows.
Ajoutons enco- e que le Tajfoni, auteur de la Secchia
rapita, parle de cette mufique, comme étar t fo;t
eftimée des Itâ-iers de fon temps ( 1 ) & en attribue
l’invention au ici Jacques d'Ecolfe, opinion que
peut avoir eue facilement un étranger, parce que
tous les Rois éeoffois de ce nom, fur-tout le premier,
le troiuème, le quatrième & le cinquième,
étoient fa va ns en mufique & en poéfie.
Le témoignage du Tajfoni prouve que cette mufique
eft plus ancienne que R zzio. On ne doit pas adopter
pour cela ce qu'il dit de fon im enteur : il faut croire
tout auffi peu ceux qui donnent i’ncnneur de cette
invention aux moines de Melrofe. Il eft plus probable
que c. s heureux chants naquirent parmi des
hommes qui étoient vérrablement pafteurs , & qui
éprouvoient réellement les fentimens & les affe&ions
qui y font fi bien exprimés.
R ’zzio p;ut avoir été l’un des premiers qui *a'î
fa t une colleébion de'ces chants, ou bien il peut
les avoir exécutés plus délicatement que les muficiens
éeoffois de ce f ièJe, ou peut-être même avoir corrigé
l’extravagance de ce,-tains p fia g es : car on eil
frappé de la régularité de quelques-uns de ces airs,
autant qu’amufé de l’air fauvage de que lques au:res.
Et dans l’un ou l’aut-e cas, on peut dire que la
mufique écoffoife lui a de grandes oblignions. Mais
que ce ftyle dune mélodie paftorale, fi différente
de ce qu’éteit alo s la mélodie italienne, & fi particulière
à tous égards, puiffe avoir été établi ou inventé
par lui, c’eft ce qui parcît impoffibie.
L’ôpir.ion la plus générale attribue l’origine de
cette ancienne n ufique écoffoife aux Bardes , qui
après avoir fleuri en Irlande & dans prefque toutes
les parties de l’Europe , paffèrent en Ecoffe oc y portèrent
leur poéfie & leurs chants. Dars la haute
Ecoffe fur-tout, où les plus anciens airs Ecoffois fe
font conforvés, chaque chef entretenoit jadis dans
(1) T a jfo n i étoit né en 1565.