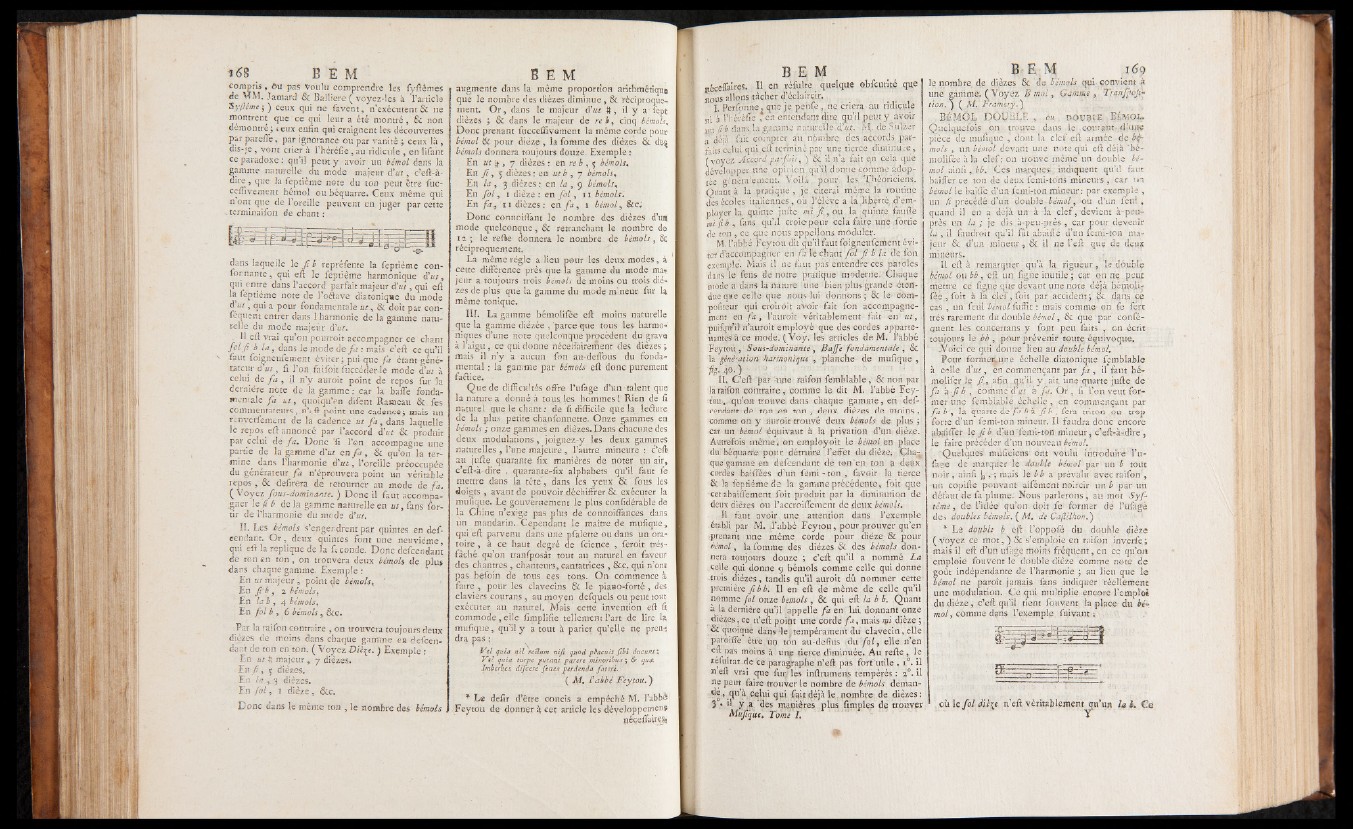
168 B E M
compris, du pas voulu comprendre les fyftèmes
de MM. Jamard & Bailiere ( voyez-les à l’article
"Syfiême ; ) ceux qui ne favent, n’exécutent & ne
montrent que ce qui leur a été montré, & non
démontré; « eux enfin qui craignent les découvertes
par parefte, par ignorancè ou par vanité ; ceux là ,
dis-je, vont crier à l’héréfie , au ridicule , en lifant
ce paradoxe : qu’il peut y avoir un bémol dans la
gamme naturelle du mode majeur d'u t , c?eft-à-
d»re, que la feptieme note du ton peut être ftic-
ceftivement bémol ou béquarre. Ceux même qui
n ont que de l ’oreille peuvent en juger par cette
terminaifon de chant :
- e -
dans laquelle le f i b repréfente la feptieme conformante,
qui eft le feptieme harmonique d'ut y
<îu"1 ëfiîrè dans l’acçord parfait majeur d'u t, qui eft
la féptième note de l’o&ave diatonique du mode
d’«r, qui a pour fondamentale ut^ & doit par con-
féquent entrer dans 1 harmonie de la gamme naturelle
du mode majeur d'ut.
• Il eft vrai qu’on pourroit accompagner ce chant
fo l Ji b la , dans le mode de fa : mais c’eft ce qu’il
faut foigneufement éviter ; pui que fa étant générateur
d 'u t, fi l’on faifoit fuçcéderde mode d "ut à
celui de fa , il n’y auroit point de repos fur la
dernière note de la gamme : car la baffe fondamentale
f i u t , quoiqu’en difent Rameau & .fe s
commentateurs, n’tft point une cadencé; mais un
renversement de la cadence ut f a , dans laquelle
le repos eft annoncé par l’accord d'ut & produit
par celui défia. Donc ’fi l’on accompagne une
partie de la gamme' d'ut en f a , & qu’on la termine
dans l’harmonie d 'ut, l’oreille préoccupée
du générateur fa n’éprouvera point un véritable
repos , & defirera de retourner au mode de fa .
(V o y e z fous-dominante. ) Donc il faut accompagner
l e / b de la gamme naturelle en uty fans for-
tir de l’harmonie du mode d'ut.
IL Les bémols s’engendrent par quintes en defeendant.
O r , deux quintes font une neuvième
qui eft la répliqué de la fiçonde. Donc defeendant
de ton en ton, on trouvera deux bémols de plus
dans chaque'gamme. Exemple :
En at majeur , point de bémols, '
En f 'b , 2 bémols.
En la b , 4 bémols,
En fo l b y 6 bémols, &c.
Par la raifon contraire , on trouvera toujours deux
dièzes de moins dans chaque gamme en defeen-
dar.tde ton en ton. ( V o y e z Diè^e. J Exemple:
En ut $} majeur , 7 dièzes.
En f i y ç dièzes.
En la ,_3 dièzes.
En f o l , 1 dièze, &c.
Donc dans le même ton ? le nombre des bémols
B E M
augmente dans la même proportion arithmétique
que le nombre des dièzes diminue , & réciproquement.
O r , dans le majeur d'ut # , il y a'fept
dièzes ; & dans le majeur de re b, cinq bémols,
Donc prenant fuccefiivement la même corde pour
bémol tk. pour dièze , la fomme des dièzes & dfeç
bémols donnera toujours douze. Exemple :
En ut , 7 dièzes : en re b , bémols„
En f i y ç dièzes: en ut b , 7 bémols,
En la , 3 dièzes : en la , 9 bémols,
En fo l y 1 dièze : en f o l , 11 bémols.
En fa-y 11 dièzes: en fa , 1 bémol y
Donc connoiflànt le nombre des dièzes d’mi
mode quelconque, & retranchant le nombre de
12, ; le refte donnera le nombre de bémols, &
réciproquement.
La même règle a lieu pour les deux modes, à
cette différence près que la gamme du mode ma?
jeur a toujours trois bémols de moins ou trois dièzes
de plus que la gamme du mode mineur, fur 1*
même tonique.
III. La gamme bémolifêe eft moins naturelle
que la gamme dièzée , parce que tous les harmoniques
d’une note quelconque procèdent du grava
à l’aigu , ce qui donne nécefiairement des dièzes ;
mais il n’y a aucun fon au-défions du fondamental
: la gamme par bémols eft donc purement
faétice. --
Que de difficultés offre l’ufage d’un talent que
la nature a donné à tous les hommes ! Rien de fi
naturel que le chant : de fi difficile que la Ieélure
de la plus petite chanfonnette. Onze gammes en
bémols ; onze gammes en dièzes. Dans chacune des
deux modulations, joignez-y les deux gammes
naturelles , l’une majeure , l’autre mineure : c’eft
au jufte quarante fix manières de noter un air,
c’eft-à-dire , quarante-fix alphabets qu’il faut fe
mettre dans la tête, dans les yeux & fous les
doigts, avant de pouvoir déchiffrer & exécuter la
mufique. Le gouvernement le plus confidérable de
la Chine n’exige pas plus de connoiffances dans
un mandarin. Cependant le maître de mufique,
qui eft parvenu dans une pfalette ou dans un oratoire
, à ce haut degré de feiepee , feroit très-'
fâché qu’on tranfposât tout au naturel en faveur
des chantres , chanteurs, cantatrices , &c, qui n’ont
pas befoin de tous ees tous. On commence à
faire , pour les clavecins & le piano-forte, des
claviers courans , au moyen defqyels ou peut tout
exécuter au naturel. Mais cette invention eft fi
commode, elle fimplifie tellement l’art de lire la
mufique, qu’il y a tout à parier qu’elle né pren-i
dra pas ;
Vel quia nil r-eclum nifi quod piacuit fibi ducunt ;
f » l quia turpe putant. parère minortbus ; & qutg,
Jmberb.es difeere fenes perdenda fateri-
( M. l'abbé Feytou.y
* Le defir d?être concis a empêché M. l’abbé
Feytou de donner à cet article les déyeloppemens
néçeffai^
B E M
nèceffaires. Il en réfulte quelque obfcurfii que
nous allons fâcher d’éclairçir.
I. Perfon'ne. que je. pen(e , .ne'criera 'au ridicule
ni à l’hcréfie * eu e n tend an t cfire qu’il peut y avoir
yn fih dans..la; .gamine n a t u r e l l e j v ( , dé Su\ze'r
£ déjà fait compter au nombre cks, accords,,par-
faits celui qui,eft terminé par une tierce diminuée,
(voyez Accord y fi:fin e ). il n’a fait ,qn cela que
développer, une opinion ..qu’il donne comme aftop- .
tée gâiéra'ement. V o ili paur' les, théoriciens.
Quant à la pratique , je citerai même, la routine
des écoles italiennes , où l’élève a la tiPÇrcé, d’employer
la. quinte jufte mi j i . , 6u la quinte, faillie
mi fi b y fans qu’il croie pour cela faire line fortie
de ton , ce que nous appelions, moduler.
M. l’abbé Feytou dit qu’il faut foigneufement éviter
d accompagner en fa le chant fo l 'fl b'là de fon
exemple. Mais il ne faut p'às entendre'èes p'ardlës
dans le feiis de notre pratique moderne: Chaque
mode a dans la nature' une bien pius g-rande -étofl-
due q*e celle que nous lui d ornions;; &. le- côm-
| pofiteur qui croirôit avoir fait fon accompagnement
en fa f l’auroit véritablement fait en ut,
puifqrfi-i1 n’auroit employé que des cordes apparte-
ùanté^-'à ee mode. (V o y . les articles de M. Fâbbé
Feytou , Sous-dominante , Baffe fondamentale \ &
! la géné-ation harmonique , planche de mufique ,
f ? - 43-) • ' V ' ^ !. :
II, C’eft par -une raifort femblable, & non par
la raifort contraire , comme le dit M. l’abbé Fey-
tou, qu’on trouve- dans chaque gamme, en defeendant
de ton .en ton, deux dièzes de moins,
[ comme: on y auroit trouvé deux bémols de plus ;
car un. bémol équivaut à la privation d’un; dièze.
I Autrefois même i cm employoit le bémol en place
! du béqtiarfe pour détruire l’effet du diêzei Çha^
que gamine en defeendant dé ton en ton a-deux.
| cordés baiffées d’un femi -ton, favoir la tierce
1 & la feptieme de la gamme précédente -, foit que
cet abaiffement foit produit par la diminution de
deux dièzes ou l’accroiffement de deux bémols'.
Il faut avoir une. attention dans l’exemple,
[, -établi par M. .l’abbé Feytou, pour prouver qu’en
-prenant une même corde pour dièze & pour
bémol y la fomme des dièzes & des bémols donnera
toujours douze ; c’eft qu’il a nommé La
celle qui donne 9 bémols comme celle qui donne
trois dièzes, tandis qu’il auroit dû nommer cette
première f i b b. Il en eft de même de celle qu’il
nomme fol onze bémols , & qui eft la b b. Quant
a la dernière qu’il ^appelle fa en lui donnant onze
dièses, ce. n’eft point une corde fa , mais mi dièze ;,
. ^ quoique dans deitempérament du clavecin, elle ;
pafoiffe être un ton au-defitis -dui/o/, elle n’en
eft pas moins à iunjp tierce diminuée.-Au refte , le
refultat-de ce paragrq)he n’eft pas forfutile . r°. il
n eft vrai que furç les inftruments tempérés : 20. il
ne peut faire trouver le nombre de bémols déirtan-
^u’à,celui qui f^’uidéjàle.noipbre de dièzes:
3 • “ j a des manières plus fimples de trouver
Mufiqut» Tùme 1.
B E M 1 6 9
le nombre de dièzes & de bémols cuii. çonvient -à
une gammé'. (V o y e z B mol y Gamme y Franfpojf
tïon. ) ( M. Framer y. )
. BÉMOL D O yB L E , ou , d o u ç i? Bémoi.»
Quelquefois q.n,. trouve dans le..cour^nt-_dhipe
pièce de mufique , dont la clef eft armée de bémols
, un bémol devant une note qui eft déjà 'bé-
molifée à l a c le f : on trouve même un double bémol
ahifi bb. Ces marques^, indiquent qu’il faut
baifler ce ton de deux femi-tons mineurs , car
bémol le baji-fe d’un femi-ton mineur : par exemple ,
un (i précédé d’un double - bémol, '011 d’un feul ,
quand il en a déjà un à là c le f , devient à-peu-
près un la j je dis à-peu-près , car pour, devenir
la , il faudroit qu’il fut abaifî’é d’un fenfi-ton majeur
& d’un mineur, & il ne Left quç de depx
mineurs.
Il eft à remarquer qu’à la rigueur, le double
bérnpl ou bb , eft un figne inutile ; car on fie , peut
mettre ce figne que devant une note déjà bértioli,^
fee,, foit à la c le f, foit par accident; dans ce
cas , un feùl bémolfiiffit : mais comme' on fe fért
très rarement du double bémol, & que par confé-
quent les. concertans y font peu faits-r on écrit
toujours le bb , pour prévenir tpute équivoque.
JVorci ce qui donne lieu au double bémol.
Pour fonnétLurte échelle diatonique femblable
à celle d'u t , en commençant par fa , il faut fcé-
molifer Je y?, .afin qu’il y . ait une-quarte jufte de
fa h. fi,b , comme clkr à f i . O r , fi l’on veut former
une fembiabïè. é fhelle, en commençant par
fa b Jy la quarte de fa b a f i b , fera triton , QU trop
forte d’un femi-ton mineur. Il faudra donc encore
afiaiffer le f i b .d’un ’femi-tfin rniiiefir, c’ eft-à-fitre ,
le faire précéder d’un nouveau bémol. '
Quelques mùficiens ont voulu introduire ï ’u-
fase de marquer le double bémol par un b tout
noir , ainfi h'-,-; mais le b b a prévalu avec ràifon!,
un copifte pouvant aifément noircir un b par un
défaut de fa plume. Nous parlerons, au mot Syf-
têms, de l’idée qu’on doit fe former de l’ufagé
des doubles bémols. ( M. de Caflilhon.) ’
* Le double b eft- l’oppofé du double dièze
( voyez ce mot , ) & s?emploie en raifon inyerfe ;
mais il eft d’un ufage moins fréquent, en ce qu’on
emploie fouvent le double dièze comme note de
goût indépendante de l ’harmonie ; au lieu que le
bémol ne paroît jamais fans indiquer réellement
une modulation. Ce qui multiplie encore l’emoloi
du dièze, c’eft qu’il tient fouyent la place du éé«
mol, comme d?ns l’exempfe fuiyant ;
, , o ù l efoldiiyi n ’e f t v é r ita b lem e n t q u ’un la i. C e