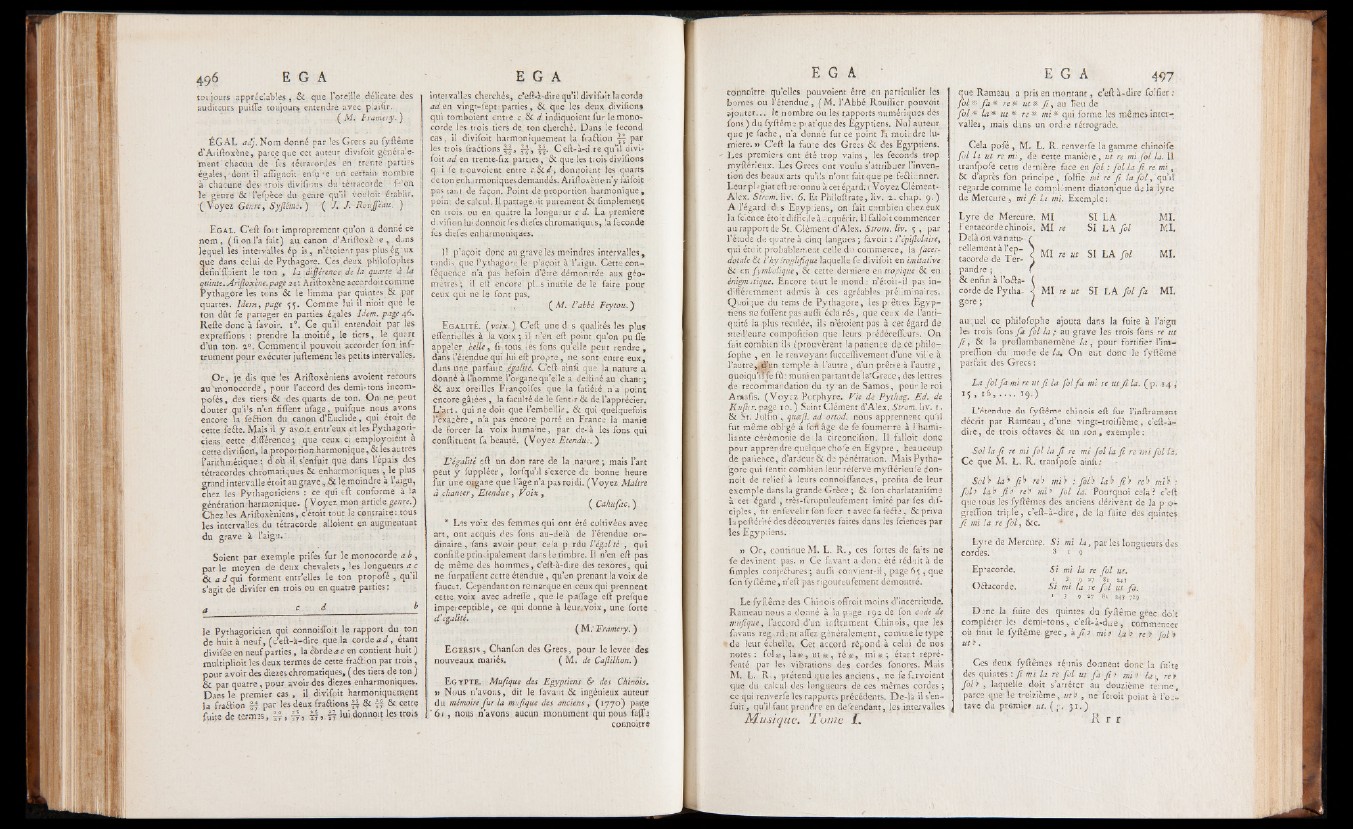
toujours appréciables , & que loreilîe délicate des
auditeurs puiffe toujours entendre avec piaifir.
. ( Mt brama y. )
É G A L ad}. Nom donné par les Grecs au fyflême
d’Arifloxène, parce que cet auteur divifoit générale»
ment ' chadm dè Tes tétracordes en trente parties
égales, dont il afiîgndit en tu 'e qiv certain- nombre
à chacune dës> trois divifions du tétracorde f - ’qn
le genre & T efpèc e du genre qu’il vouloit établir.
(V o y e z Genre, Syjlêmè. ) ( J. J. Rcrujfeau. )
Egal. C ’efl Fott improprement qu’on à donné ce
n om , ( fi on L’a fait) au canon d’Ariftoxène y, dans
lequel les intervalles ép is , n’étoientpas p lu s é g u x
que dans celui de Pythagore. Ces,deux philofophes
défin'ffoient le ton , la différence de la quarte à la
quinte. Arifioxène.page 21: Arifioxène accordoit comme
Pytha gore les tons & le limma par quintes &. par
quartes. Idem, page 55. Comme lui il nioit que le
ton dût fe partager en parties égales Idem, page 40.
Refie donc à favoir. i° . C e qu’il entendoit par les
expreffions : prendre la moitié, le tiers, le quart
d’un ton. 2.0. Comment il pouvoit âccorder,fon;iiîf-
trument pour exécuter juflement les petits intervalle?.
,O r , je dis que les Arifloxéniens avoient recours
au morfoc crd e, pour l’accord des demi-tons incom-
p o fé s, des tiers & des quarts de ton. On- ne peut
dou te r,qui's n’en fiffent ufage, puifque nous avons
encore la feélion du canon d’Euclide, qui étoit de
cette fe£le. Vlais il y avolt, entr’eux et les P ythagoriciens
cette différence; que ceux ci ;employoiént à
cette clivifion, la proporpon-harmonique, & le&autres
l’arithmétique.: d ou -il s’enfuit que dans l’épais des
tétracordes chromatiques &. enharmoniques , le plus
^rand intervalle é toit au grave ^ ÔC le moindre à l’aigu3
chez les Pythagoriciens : ce qui efl conforme à la
génération harmonique. ( V o y e z mon article genre?)
Che z les Arifloxéniens, c’étqit tout le contraire : tous
les intervalles du tétracorde alioient en augmentant
du grave à l’aigu.'
Soient par exemple prifes fur le monocorde a b ,
pat le moyen de deux chevalets , les longueurs aç
%Lad qui forment entr’elles le ton propofé , qu’il
s’agit de divifer en trois ou en quatre parties ;
a , •________g - d_____ ,_________
le Pythagoricien qui connoiffoit le rapport du^ ton
de huit à°neuf, (c’eft-à-dire que la corde a d , étant
divifée en neuf parties, la ebrde a c en contient huit )
multiplioit les deux termes de cette fraélion par trois,
pour avoir des diezes chromatiques, ( des tiers de ton )
& par qua tre, pour avoir des diezes enharmoniques.
Dans le premier cas , il divifpit harmoniquement
la fraélion f y par les deux frayions | | & - f & cetrç
fuite dç t s rm s s ,^ , f f , | l u i d o n n o i t les trois
intervalles cherchés, c’efl-à-dire qu’il divifoit la corde
ad en vingi-feptA parties, & que les deux divifions
qui torr.boient entre. c &C d indiquoient fur le monocorde
les trois tiers dej ton cherché. Dans ie fécond
c a s , il divifoit harmoniquement la fraélion y f par
les trois fraélions Ce fl-à-d.re qu’il divifoit
ad en trente-fix parties, & que les trois divifions
q: i fe nouvoient entre c,$cd, donnoient les quarts
de ton enharmoniques demandés. A rifioxène n’y faifoit
pas tant de façon. Point de proportion harmonique,
point de calcul. Il par.tageoit purement & fimplemeQt
en trois ou en quatre la longueur c d. La première
divifionluidonnoitfcs diefes chromatiques, lafcconde
fes diefes enharmoniques. ,
Il p’açoit donc au gravé les moindres intervalles,
tandis que Py thagore l e p ’açoit à l’aigu. Cette conséquence
n’a pas, befoin d’être démontrée aux géomètres
il èfl encore! p L s inutile de le faire pour
ceux qui ne le font pas.
( M. Vabbé Feytou. )
Egalité. ( veix.). C ’efl une d. s qualités les plus
effeatieites à la vo ix ; il n’en efl point qu’on pu fie
appeler belle, fL.tous, lès fons qu’elle peut rendre ,
dans l’étendue qui lui efl propre , ne sont entre eux,
dans une parfaite „égalité, C ’efl ajnfi que la nature a
donné à l’homme l’organe qu’elle a deflinéau chant ;
& aux oreilles Françoifes que .la fatiété n'a point
encore gâtées la faculté de le fentir & de l’apprécier.
L ’a r t , qui ne doit que l’embellir, & qui quelquefois
1’exàgère, n’a pas encore porté en France la manie
de forcer la voix humaine, par de-!à les fons qui
conflituent fa beauté. (V o y e z E ten d u )
L'égalité efl un don rare de la na'ure ; mais l’art
peut y fuppléer, lorfqu’il s’exerce de bonne heure
fur une ojgane que l’âge n’a pasroidi. (Voyez. Maître
à.chanter, Etendue, Voix,
( Cahufac. )
* Les voix des femmes qui ont été cultivées avec
art, ont acquis des’ fons au-delà de l’étendue ordinaire,
fans avoir pour cela p rdu l ’égal té qui
confifle principalement dans le timbre. Il n’en efl pas
de même des hommes, c’efl-à-d:re des tendres, qui
ne furpaffent cette étendue , qu’en prenant la voix de
faucet. Cependant on remarque en ceux qui prennent
çette. voix avec adreffe , que le paffage efl prefque
imperceptible, ce qui donne à leu r .v o ix , une forte
d’égalité.
( M ,'Fràmery. )
E gersis , Chanfon des Qrecs, pour le lever des
nouveaux mariés. ( M t de Çaffilhon. )
E gypte, Mufique des Egyptiens & des Chinois9
: » Nous n’ayons, dit le favant & ingénieux auteur
du mémoire fur la mufique des anciens , ( 17 7 0 ) page
'Ci , nous n’avons aucun monument qui nous fafl’e
connoî.trç
connoître qu’elles pou voient être en particulier les
bornes ou l’étendue , (M . l’Abbé Roufîier pouvoit
a jou ter... le nombre ou les rapports numériques dès
fons) du fyflêms p» arque des Egyptiens. Nul auteur
que je fâche, n’a donné fur ce point Pa moindre lumière.
» C ’efl la faüre des Grecs & des Egyptiens.
Les premiers ont été trop vains , les féconds trop
myflérieux. Les Grecs ont voulu s’attribuer l’inven^
tion des beaux arts qu’ils n’ont fait que pe feélicnner.
Leur pLgiat efl reconnu à cet égards V o y e z Clémer.t-
A lex. Strcm. liv. 6. Et Philoftrate, liv. 2. chap. 9. )
A l’égard d .s Egyp.iens, on fait combien chez eux
la fcîence étoit difficile à acquérir. 11 falloit commencer
au rapport de St. Clément d’Alex. Strom. liv. 5 , par
l’étude de quatre à cinq langues ; favoir : /’cpiflolaire,
qui étoit probablement celle du commerce, la facer-
dotale & /’hyîroglïfique laquelle fe divifoit en imitative
& en Symbolique, & cette derniere en tropique & en
ènigmitique. Encore tout le monde n’étoit-il pas indifféremment
admis à ces agréables préliminaires.
Quoique du tems de Pythagore, les prêtres Eg yp tiens
nefufTentpas aufli écla rés , que ceux de l’antiquité
la plus reculée, ils n’étoient pas à cet égard de
meilleure compofition que lèürs prédéceffeurs. On
fait combien ils éprouvèrent la patience de_cè philo—
fophe , en le renvoyant fucceflivement d’une vil e à
l ’autre ÿ 4 ’|,n temple à l’autre, d’un p rêtre à l’autre,
quoiqu’ilTe fû: muni en partant de la'Grece, des lettres
de recommandation du ty an de Samos, pour le roi
Arnafis. (V o y e z Porphyre. Vie de Pythag. Ed. de
Kufhr. page 10 .) Saint Clément d’A lex. Strom. liv. 1.
& St. Juftin , quoe{l. ad ortod. nous apprennent qu’il
fut même obl’gé à fon âge de fe foumerre à l humi-
liante cérémonie de la circoncifion. Il falloit donc
pour apprendre quelque chore en Egypte , beaucoup
de patience, d’arJ eu r& d e pénétration. Mais Pythagore
qui fentit combien leur réferve myflérieufe don-
noit de relief à leurs connoiffances, profita de leur
exemple dans la grande Grèce ; &. fon charlatanifme
à cet égard , très-ferupul'eufement imité par fes dif-
ciples , fit enfevelir fon fecr t avec fa feéle, & priva
Lipoflérité des découvertes faites dans les fciences par
les Egyptiens.
» O r , continue M. L. R . , ces fortes, de fa’ts ne
fe devinent pas. » C e favant a donc été réduit à de
fimples conjeélures ; aufli convient-il, page 65 , que
fon fy flême , n’efl pas rigoureufement démontré.
Le fyfiême des Chinois offroit moins d’incertitude.
Rameau nous a donné à la page 192. de fon code de
mufique, l’ac.cord d’un infiniment Chinois, que les
favans reg-.rd;nt affez généralement, comme le type
: de leur échelle. Ce t accord répond à celui de nos
n otes: fol*:, l a * , ut * , r é * , mi * ; étar.t repré-
fenté par les vibrations des cordes fonores. Mais
M. L. R - , prétend que les anciens, _ne fe Lryoient
que du calcul des longueurs de ces mêmes cordes ;
cc qui renverfe les rapport» précédents. D e- là il s’enfu
it , qu’il faut prendre en descendant, les intervalles
Musique. Tome I.
que Rameàu a pris en montant, c ’efl à-dire foîfier :
re% ut * J i, au îîeu de
fo l& la * u t* re* mi* qui forme les mêmes .intervalles
, mais dans un ordre rétrograde.
Cela p o f é , M. L. R. renverfe la gamme chinoife
fo l la ut re mi, de cette manière, ut re mi fol la. 11
tranfpofè cette dernière face en fo l : fo l ia f i re mi,
& d’après fon principe, folfie mi re f i lafiàl, qu’il
regarde comme le complément diatotvque de la lyre
de Mercure , mi f i la mi. Exemple:
Ly re dé Mercure. MI SI L A MI.
F entacorde chinois. M I re SI L A. fol MI.
Delà on v ànatu- (
Tellement à l’ep- ) , , , v . - . , . T
tacorde de Ter- { MI rc ut SI L A f°l M Ipandre
; . (
& enfin à l’oéla- (
corde de Pytha- < MI re ut SI L A fol fa MI.
g o r e ; (
auquel ce philofophe ajouta dans la fuite à l’aigu
les trois fons fa f ç l la ; au grave les trois fons re ut
f i , & la proflambanomène la , pour fortifier l’im-
preflion du mode de /j* O n eut donc le fyflême
parfait des Grecs :
La fo l fa mi re ut f i la fol fa mi re ut f i la. ( p. 14
15 , 16, . . . . 19.)
L ’étendue du fyflême chinois efl fur l’inflrument
décrit par Rameau, d’une vingt-rroifième., cleflrà^
dire, de trois oélaves & un ton, exemple : :
Sol la f i re mi fol la f i re mi fo l la f i re mi fol là.
C e que M. L . R . tranfpofè ainfi ;
S o l[i> laS fi}> reb mi.b ; foCb la b f i t reb mib )
fol y lab f i b reb mib fo l la. Pourquoi cela ? c’eft
que tous les fyflêmes dès anciens dérivent de la p
greflîon triple , c’e f l-à -d ire , de la fuite des quintes
f i mi la re fo l, Ôte. *
Lyre de Mercure. Si mi la, par les longueurs des
cordes. 3 1 9
E p‘acorde. Si mi la re fo l ut.
Oélacorde. . Si mi la re fo l ut fa.
1 3 9 27 81 24j 729
D>nc la fuite des quintes du fyflême grec doit
compléter les demi-tons , c’efl-à-due , commencer
où finit le fyfl&mç g re c , à f i 9 mi 9 la I? reb fol b
ut b .
Ces deux fyflêmes réunis donnent donc la fuite
des quintes : f i mi la re fo l ut fa f i ) mi 9 fo\ reb
fol b , laquelle doit s’arrêter au douzième terme,
parce q u e 'le treizième, Mt b , n é feroirpoint à i’o - -
tave du premier ut. ( r. 31. )
R r r