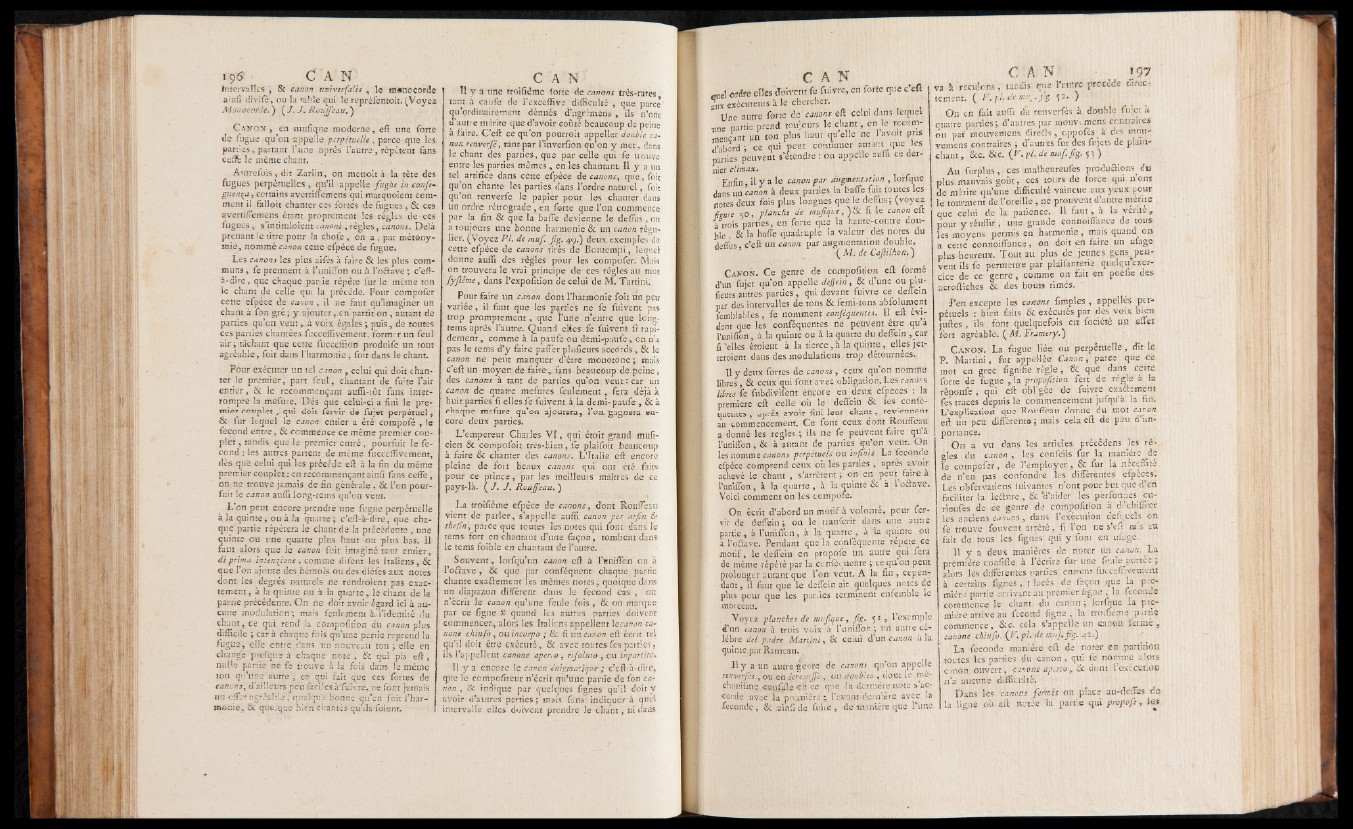
intervalles , & canon univerfalis , le monocorde
ainfi cîiyife, ou la table qui le repréfentoit. (Voyez
Monocarte.) ( / . J. Roujfeau.)
C a n o n , en mnfiqne moderne, eft une forte
de fugue qu’on appelle perpétuelle, parce que les
parties, partant l’une après l’autre, répètent fans
ceftfe le même chant.
Autrefois, dit Zariin, on mettoit à la tête des
fugues perpétuelles , qu’il appelle fughe in confe-
guen^a, certains avertiflemens qui marquoient comment
il falloit chanter ces fortes de fugues * & ces
averti(femens étant proprement les règles de ces
fugues, s’intituloient canoni , règles, canons. Delà
prenant le titre pour la chofe , on a , par métonymie,
nommé canon cette efpèce de fugue.
Les canons les plus aifés à faire & les plus communs
, fe prennent à l ’uni (Ton ou à l’o&ave ; c’eft-
à-clire, que chaque parue répète furie même ton
le chant de celle qui la précède. Pour compofer
cette efpèce de canon , il ne faut qu’imaginer un
chant à fon gré; y ajouter,,en partition, autant de
parties qu’on veut ,_à voix égales ; puis, de toutes
ces parties chantées fucceflivement, former un feul
air ; tâchant que cette fuccefîion produife un tout
agréable, foit dans l ’harmonie, foit dans le chant.
Pour exécuter un tel canon , celui qui doit chanter
le premier, part feuî, chantant de firte Pair
entier, & le recommençant auffi-tôt fans interrompre
la mefure. Dès que celui-ci a fini le premier
couplet, qui doit fervir de fujet perpétuel,
& fur lequel le canon entier a été compofé , le
fécond entre, & commence ce même premier couplet
, tandis que le premier entré , pourfuit le fécond
: les autres partent de même fucceflivement,
dès que celui qui les précède eft à la fin du même
premier couplet: en recommençantainfi fans cefTe,
on ne trouve jamais de fin générale , & l ’on pourfuit
le canon aufli long-tems qu’on veut.
L ’on peut encore prendre une fugue perpétuelle
à la quinte, ou à la quarte ; c’eft-à-dlre, que chaque
partie répétera le chant de la précédente , une
quinte ou une quarte pins haut ou plus bas. Il
faut alors que le canon foit imaginé tout entier,
ai prima inten^ione, comme difent les Italiens , &
que l’on ajoute des bémols ou des tlièfes 2iix notes
dont les degrés naturels ne rendroïent pas exactement,
à la quinre ou à la quarte, le chant de la
partie précédente. On ne doit avoir égard ici à aucune
modulation1; mais feulement à/i’idémité du
chant, ce qui rend .la compofition dü canon plus
difficile ; car à chaque fois qu’une partie reprend la
fugue, elle entre dans un nouveau .fon ; elle en
change prefqne à chaque note , & qui pis eft ,
nulle parue ne fe trouve à la fois dans le même
ton qu’une autre ce qui fait que ces’ fortes de
cane ns x d’ailleurs peu radies à^foivre, ne font jamais
un effet agréable, quelque bonne qu’eri foit l’harmonie,
& quelque bien chantés quMs foient.
Tl y a une troifiéme forte de canons très-rares
tant à caufe de l’exceflive difficulté , que parce
qu’ordinairement dénués d’agrémens , ils n’ont
d’autre mérite que d’avoir coûté beaucoup de peine
à faire. C ’eft ce qu’on pourroit appeller double canon
renverfés tant par l’inverfion qu’on y met-, dans
le chant des parties, que par celle qui fe trouva
entre les parties mêmes , en les chantant. Il y a un
tel artifice dans cette efpèce de canons, que, foit
qu’on chante les parties dans l’ordre naturel, foit
qu’on renverfe le papier pour les chanter dans
un ordre rétrograde , en forte que l’on commence
par la fin & que la baffe devienne le de fins , on
a toujours une bonne harmonie & un canon régulier.
(Voyez PI. de muf. fig. 49.) deux, exemples de
cette efpèce de canons tirés de Bontempi, lequel
donne auffi des règles pour les compofer; Mais
on trouvera le vrai principe de ces règles au mot
fyfiême, dans Pexpofition de celui de M. Tartini;
Pour faire iin canon dont l’harmonie foit un peu
variée, il faut que les parties ne fe fuivent pas
trop promptement, que l’une n’entre qtie long-
tems après fâutre. Quand elles fe fuivent fi rapidement,
comme à la paùfe ou demi-paùfe , en n’a
pas le tems d’y faire paffer pliifieurs accords , & le
canon ne peut manquer d’être monotone; mais
c’efi un moyen de faire*, fans beaucoup de peine,
des canons à tant de parties qu’on veut : car un
canon de quatre mefures feulement, fera déjà à
huit parties fi elles fê fuivent à la demi-paufe , & à
chaque mefure qu’on ajoutera, l’on gagnera encore
deux parties.
L’empereur Charles V I , qui étoit grand mufi-
cien & compofoit très-bien, fe plaifoit beaucoup
à faire & chanter des canons. L’Italie'efi encore
pleine de fort beaux canons qui ont été faits
pouf ce prince, par les meilleurs maîtres de ce
pays-là. ( J. J . Roujfeau. )
La troifiéme efpèce de canons, dont Rouffeatt
vient de parler, s’appelle auffi canon per arfin &
tke.(ih\ parce que toutes les notes qui font dans' le
terns fort en chantant d’une façon, tombent dans
le tems foible en chantant de l’autre.
Souvent, lorfqu’un canon eft à l’anifibn ou à
T’o&ave , & que par conféquent chaque partie
chante exaâement les mêmes notes, quoique dans
un diapazon différent dans le fécond cas , on
n’écrit le canon qu’une feule fois , & on marque
par ce ligne £ quand les autres parties doivent
commencer., alors les Italiens appellent 1 ecanon ca-
none chiufo, ou incorpo ; & fi un canon eft écrit tel
qu’il doit être exécuté, & avec toutes fesparties,
ils l’appellent canone aper. o , rifoluto , ou inpartitc»
Il y a encore le canon'ènizmaîique ; c’cft à-dire,
que le compofiteur n’écrit qu’une partie de fon canon
, & indique par quelques lignes qu’il doit y
avoir d’autres parties; mais fins indiquer à quel
intervalle elles doivent prendre le chant, ni dans
eoel offre elles doivent fe fuivre, en forte que c eft
aux exécuteurs à le chercher.
Une autre forte de canons eft celui dans lequel
me name prend toujours le chant, en le recommençant
un ton plus haut qu’elle ne lavo.t pris
d’abord; ce qui peut continuer autant que les
parties peuvent s’étendre r on appelle auffi ce der-
nier climax.
Enfin, il y a le canon par augmentation , lorfque
dans un canon à deux parties la baffe fait toutes les
notes deux fois plus longues que le deffus; (voyez
faun so, planche de mufiqnc,)&L fi le canon eft
à trois parties, en forte que la haute-contre double
, & la baffe quadiuple la valeur des notes du
defliis c’eft un canon par augmentation double.
-( M. de CaJUlhom )
C anon. Ce genre de compofition eft formé
d’un fujet qu’on appelle défît in , & d’une ou pLu-
fieurs autres parties , tjui devant fuivre ce deffein
par des intervalles de tons & femi-tons abfolument
femblables , fe nomment conféqucntcs. H eft évident
que les conféquentes ne peuvent être qu’à
Punition, à la quinte ou à la quarte du defleîn , car
£ ’elles étoient à la tierce, à la quinte, elles jetteraient
dans des modulations trop détournées.
Il y deux fortes de canons , ceux qu’on nomme
libres, & ceux qui font avec obligation. Les canon s
libres fe fubdivifent encore en deux efpeces : la
premiere eft celle ou le deffein & les confe-
quentes-, après avoir fini leur chantre viennent
au commencement. Ce font ceux dont Ronffeau
a donné les regies ; ils ne fe peuvent faire qu’à
l’unlffon, & à autant de parties qu’on veut. On
les nomme canons perpétuels ou infinis. La fécondé
efpèce comprend ceux où les parties , après avoir
achevé le chant , s’arrêtent ; on en peut^ faire à
runiffon, à la quarte , à la quinte & à 1 oélave.
Voici comment on les compote.
On écrit d’abord un motif à volonté, pour fervir
de deffein ; on le tranferit dans une autre
partie , à l’uniffcn, à la quarte , à 'la quinre ou
à l’o&ave. Pendant que la cqnfequente répété ce
motif, le deffein en propole un autre qui fera
de même répété par la ccnféquente ;~ce qu’on peut
prolonger autant que l’on veut. A la fin , cependant,
il faut que le deffein ait quelques notes dé
plus pour que les parties terminent enlemble le
morceau.
Voyez planches de mvfique, fig. 51 , l’exemple
d’un ..canon à trois voix à l’nniffon; un autre célébré
del padre Martini, & celui d’un canon à la
quinte par Rameau.
Il y a un autre genre -de canons qu’on appelle
renverfés ,'Ou en écrevt'ff'e, du doubles , dont le roe-
chaniûne cpnfifte <en ce que la dernière note s’accorde
avec la première;, l avant-dornière avec la
fécondé, & ,ainfi de fuite , de minière que Tune
C A N ■ »97
va à reculons, tandis' que l’eutte prccede fâtêc.
tentent. ( V. p i de irar .fig - )
On en fait auffi de renverfés à double fiuct »
ouatre parties; d’autres par iriouvimens contraires
oïl par mouvemens direéls, cppofés à des mou-
vemens contraires ; d’autres fur des fujets de plain-
chant, Sic. &c. (V . p l de mif.fig. 53 )
Au furplus ,-ce s malheureufes produfliens^ du
plus mauvais goût, ces tours de force qui n’ont
de mérite qu’une difficulté vaincue aux yeux pour
le tourment de l’oreille, ne prouvent d’autre mérite
que celui de la patience. 11 fau t,.a la v érité,
pour y réuffir , une grande connoiflànce de tous
les moyens permis en harmonie, mais quand on
a cette connoiflance , on doit en faire un ufage
plus heureux. Tout au plus de jeunes gens^peu-
vent ils fe permettre par plaifanterie quelqu exercice
de ce genre, comme on fait en poéfie des
acroftiches & des bouts rimes.
ï ’en excepte les canons fimples , appelles perpétuels
r bien faits & exécutés par des. voix bien
jitftes, ils- font quelquefois en fociété un. effet
fort agréable. ( M. Framery.'j
C an on . La fugue liée ou perpétuelle, dit le
P. Martini, fur appeliée Canon, parce que ce
mot en grec lignifie rè g le , & que dans cette
forte de fugue , l.a propofition fert de règle à la
réponfe , qui eft obl gée 'de fuivre exactement
fes traces depuis le commencement p û t fU la fin.
L’explication que Rouffeau donne du mot canon
eft un peu différente; mais cela eft de peu d’im-
portançe.
O n a vu dans les articles précêdens les règles
du canon, les confeils fur la manière de
le compofer , de l’employer , & .fur la nèceffite
de n’en pas . confondre les différentes efpèces.
Les jobfervaticns lui vantes n’ont pour but que d’en
faciliter la leéture , & "d’aider les perfdmtes cu-
rieufès de ce genre de compofition à déchiffrer
les anciens canons , dans l’exécution defqcels en
fe trouve fottvent arrêté, fi l’on ne s’eft m s au
fait de tous les figues qui y fon: en ufage.:
11 y a deux manières de noter un canon. La
première confifle. à l’écrire fur une feule portée ;
alors les différentes parées entrent fucceffivement
à certains figues , ] lacés de façon .que la première
partie arrivant au premier figue , la fécondé
commence le chant du canon ; lcrlque la première
arrive au fécond figue, la troifiéme pirrie
commence, Sic. cela s’appelle un canon ferme ,
canone chitifo. (K pl.de çui/.jig. 4a.)
La fécondé manière eft de noter en partition
toutes les parties du canon , qui fe nomme alors
canon ouvert, eitor.c ap.no, de dont lc-xecut.OB
.n’a aucune difficulté.
Dans les canons fermés on place au-defius de
la ligne où eft notée la partie qui propofe, les