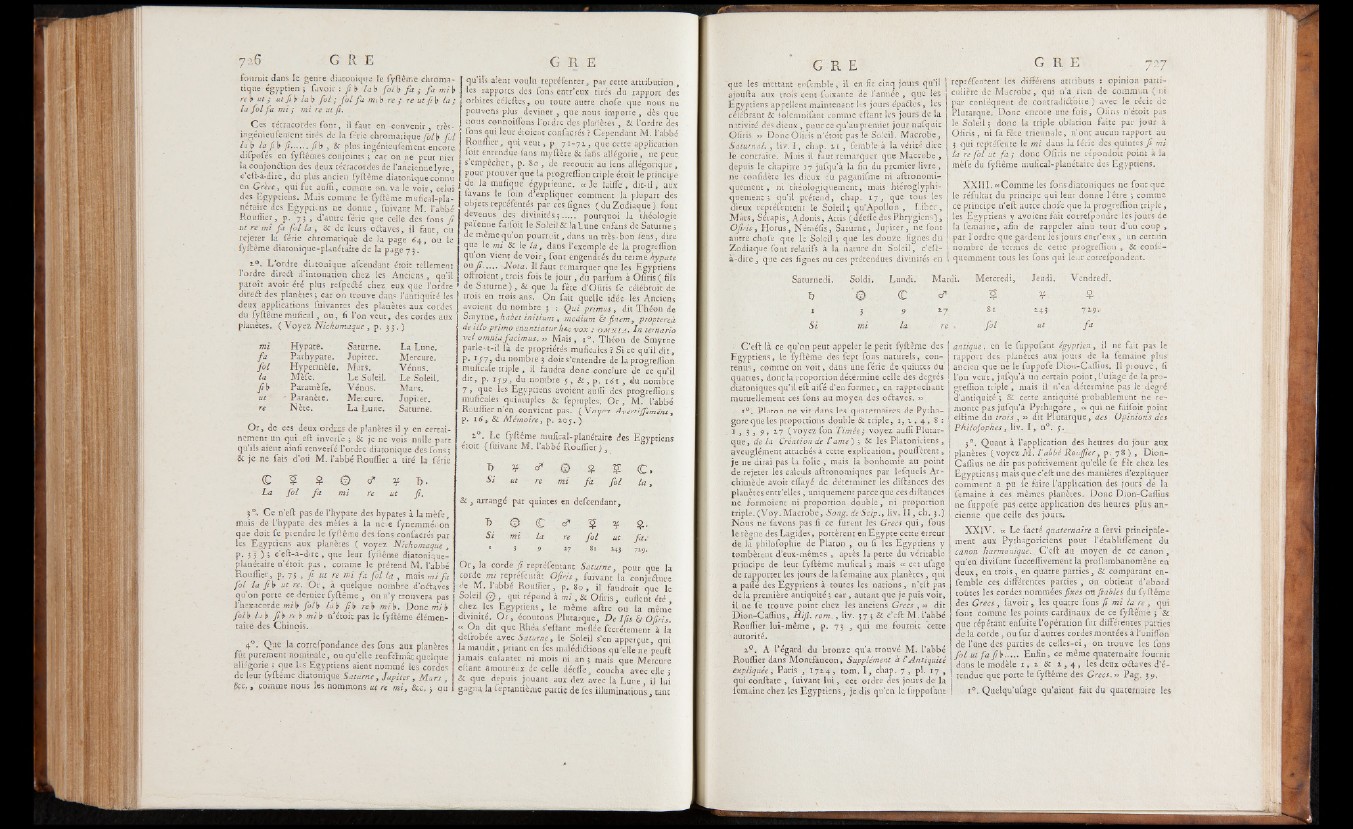
fournit dans le genre diatonique le fyfteme chromatique
égyptien ; favoir : f i b la b fo l b fa ; fa mi b
re b «r y utfiV la b fo l ; fo l fa mi b re y re «z f i b la y
/<a fo l fa mi ; ;nz re z/z fi.
Ce s tétracordes fon t, il faut en convenir , très-
ingénieufenîent tirés de la férié chromatique fo l b fol
la b la fi b f i ....... f i b , & plus ingénieufemenc encore
difpofés en fyftêmes conjoints ; car on ne peut nier
la conjondion des deux tétracordes de fancienne ly re ,
c ’eft-à-dire, du plus ancien fyfteme diatonique connu
en Grèce, qui fut auilï, comme on»va le voir, celui
des Egyptiens. Mais comme le fyftême mufîcal-pla-
nétaire des Egyptiens ne donne fuivant M . l’abbé
Rouiller, p. 73 , d’autre férié que celle des fons ƒ
ut r e m i fa fo l la , & de leurs octaves, il faut, eu
rejeter la férié chromatique de la page 64 , ou le
fyfteme diatonique-planétaire de la page 7 5.
i ° . L ’ordre diatonique afeendant étoit tellement
l’ordre direét d’ intonation chez les Anciens., qu’il
paroît avoir été plus refpeété chez eux que l’ordre
direct des planètes 3 car on trouve dans l’antiquité les
deux applications fuivantes des planètes aux cordes
du fyftême mufical, o u , fi l’on v eu t, des cordes aux
planètes. (V o y e z Nickomaque, p. 33.)
mi Hypate. Saturne. La Lune. 1 Parhypate. Jupiter. Mercure.
fo l Hyperinèle. Mars. .V én u s .
la Mèfe. Le Soleil. Le Soleil.
f i t- Paramèfe. Vénus. Mars.
ut ' ' Paranète. Mercure. Jupirer.. j
re Nète. L a Lune. Saturne.
O r , de ces deux ordres; de planète-; il y en certainement
un qui-eft inverfe: 5 & je ne vois nulle part
qu’ils aient ainfi renverfé 1’ordre diatonique des fons;
Sç je ne fais d’ou M. l’abbé Rouftier a tiré la férié
g 5 $ Ii ¥ T? •
La fo l fa mi re ut fi.
3 °- C e n’eft pas de l’hypate des hypates à la mèfe,
mais de l’hypate des mêles à fa nèie fynemménon
que doit fe prendre le fyftême des. fons confacrés par
les Egyptiens aux planètes ( voyez Nickomaque ,
p. 3 3 ) j c’eft-à-dire, que leur fyftême diatonique-
planétaire n’étoit pas , comme le prétend M. l’abbé
Rouftier, p. 73 , f i ut re mi fa fol la , mais mi fa
fol la ƒ b ut re. O r , à quelque nombre d’oétaves
qu’on porte ce dernier fyftême , 6n n’y trouvera pas
l ’hexacorde mi b fol\ la b' / b re b mz'b. Donc mi b
fo l b la b ƒ b re b mi b n’étoic pas le fyftême élémentaire
des Chinois.
40.' Que la correfpondance des fons aux planètes
fût purement nominale, ou q u e lle renfermât quelque
allégorie 5 que les Egyptiens aient nommé les cordes
de leur fyftême diatonique Saturne , Jupiter, Mars ,
§çc,, comme nous les nommons uç re mi, &c, 3 ou
qu’ils aient voulu repréfenter, par cette attribution|
les rapports des fons entr’ eux tirés du rapport des
orbites céleftes, ou toute autre chofe que nous ne
pouvens plus deviner, que nous importe , dès que
nous connoiffons l’ordre des planètes , & l’ordre des
fons qui leur étoient confacrés ? Cependant M. l’abbé
Rouiller . qui v eu t , p 7 1 - 7 1 , que cette-application
foit entendue fans my Itère & (ans allégorie , ne peut
s empêcher, p. 8 0 , de recourir au fens allégorique,
pour prouver que la piogieilion triple étoit le principe
de la mulîque égyptienne. « J e laifle , d it- il, aux
favans le loin d’ expliquer comment la plupart des
objetsrepréfentés par ces.lignes (duZ odiaque) font
devenus des divinités 3...... pourquoi la théologie
païenne faifôit le Soleil & la Lune enfans de Saturne ;
de même qu’on pourroit, dans un très-bon fehs, dire
que le mi & le la , dans l’exemple de la progrelfion
quon vient de v o ir , font engendrés du terme hypate
ou yî. .... Nota. Il faut remarquer que les Egyptiens
oftroient, trois fois le jo u r , du parfum à Ofiris ( fils
de Satu rne), & que la fête d’Ofiris fe célébroit de
trois en trois ans. On fait quelle idée les Anciens
avoient du nombre 3 - : Qui primus, dit Théon de
Smyrne, habet initium , medium & finem, proptereà
de illo primo enuntiatur h&c vox : omjxia. In ternario
vel omnia facimus. « M a is , i ° . Théon de Smyrne
parle-t-il là de propriétés muficules ? Si ce qu’ii d it,
P* 1 573 du nombre 3 doit s’entendre de la progrelfion
muficale triple, il faudra donc conclure de ce qu’ il
dit, p. du nombre y , & , p. 1 61 3 du nombre
7 , que les Egyptiens avoient au fit des progrelfion s
muficales quintuples & feptuples. O r , M . i’abbé
Rouftier n en convient pas. ( V o y e z Avertijfemênt,
p. 16 , 8c Mémoire, p. 10y. )
z ° . Le fyftême mufical-planétaire des Egyptiens
étoit (fuivant M . l’abbé R ou ftier) ,
h Tf. d* 0 £ ? €
Si Ut re mi f a fo l la
& , arrangé par quintes en defeendant,
T? © ? ? •
Si mi la re ' fol ut fa.- 1 3 9 *■7 81 243 719‘
O r , la corde f i repréfentant Saturne, pour que la
corde mi repiéfemât Ofiris, fuivant la conje&ure
de M. l’abbé Rouftier;, p. 8 0 , il faudroit q u e 'le
Soleil @ , qui répond à mi, & Ofiris , euflent été
chez les Egyptiens, le même aftre ou la même
divinité. O r , écoutons Plutarque, De Ifis & Ofiris.
ce On dit que Rhéa s’eftant me liée fecrétement à la
defrobée avec Saturne, le Soleil s’en apperçut, qui
la maudit, priant en fes malédictions qu’elle ne peuft
jamais enfanter ni mois m an 3 mais que J\Æercure
eltant amoureux de celle déeffe, coucha avec elle j
& que depuis jouant aux dez avec la Lune, il lui
gagna la feptantième partie de les illuminations , tant
que les mettant enfemble, il en fit cinq jours qu’il
ajoufta aux trois cent foixante de l’année , que les
Egyptiens appellent maintenant les jours épaefccs , les
célébrant & iolemnifant comme eftant les jours de la
nativité des dieux , pour ce qu’au premier jour nafquit
Ofiris. m Donc Ofiris n’étoit pas le Soleil. Macrobe,
Satura,il. , liv. I , chap. 21 , femble à la.vérité dire
le contraire. Mais il faut remarquer que Macrobe ,
depuis le chapitre 17 jufqu’à la fin du premier liv re ,
11e cônfidère les dieux eu paganifme ni aftronomi-
quement, ni théologiquement, mais hiéroglyphi-
quement 3 qu’il prétend, chap. 1 7 , que tous les
dieux reprélentent le Soleil; qu’Apollon , Lib e r ,
Mars, Sérapis, Adonis, Attis (déefte des Phrygiens),
Ofiris, Horus, Néméfîs, Saturne, Jupiter, ne font
autre chofe que le Soleil ; que les douze figues du
Zodiaque font relatifs à la nature du S o le il, c’eft-
à-dire , que ces lignes ou ces prétendues divinités en
repiéfentent les difféiens attributs : opinion particulière
de M ac rob e, qui n’a rien de commun ( ni
par conféquent de contradictoire ) avec le récit de
Plutarque. Donc encore une fo is , Ofiris n’étoit pas
le Soleil 5 donc la triple oblation faite par jour à
O fir is , ni fa fête triennale, n’ont aucun rapport au
3 qui repréfente le mi dans la férié des quintes fi mi
ta re fol ut fa ; donc Ofiris ne répondoit point à la
mèfe du fyftême mufical-planétaiue des Egyptiens.
X X I I I . «Comme les fons diatoniques ne font que
le réfui ta t du principe qui leur donne l’être ; comme
ce principe n’eft autre chofe que la progrelfion triple,
les Egyptiens y avoient fait correfpondre les jours de
la femaine, afin de rappeler ainli tout d’un coup ,
par l ’ordre que gardent les jours entr’eux , un certain
■ nombre de termes de cettè progrelfion , & confé-
quemment tous les fons qui leur correfpondent.
Saturnedi. Soldi. Lundi. Mardi. Mercredi, Jeudi. Vendredi
I) ■ '© , £ m ty I
1 3 9 1 f J ■ 81 243 - '
Si mi la / re > : fo i ' / ut f a
: C ’eft là ce qu’on peut appeler le petit fyftême des
Egyptiens, le fyftême des fépt fons naturels, contenus
, comme on v o it , dans une férié de quintes du
quartes, dont la proportion détermine celle des degrés
diatoniques qu’ il eft aifé d’en former, en rapprochant
mutuellement ces fons au moyen des oÇtaves. gf
i ° . Platon ne vit dans les quaternaires de Pytha-
gore que les proportions double & triple, 1 , 1 , 4 , 8 :
1 , 3 j 9, 17 (vo y e z fon Timée; voyez aulfi Plutarqu
e , de la Création de lame) 3 St les Platoniciens,
aveuglément attachés à cette explication, pouffèrent, 1
je ne dirai pas la fo lie , mais la bonhomie au point
de rejeter les calculs aftronomiques par lefquels A rchimède
avoit eflayé de déterminer les diftances des
planètes entr’elles, uniquement par.ee que ces diftances
nè formoient ni proportion double, ni proportion
triple. (V o y . M acrobe, Song. de Scip., liv. I I , ch. 3.)
Nous ne favons pas fi ce furent les Grecs q u i, fous
le règne des Lagides, portèrent en Egypte cette erreur
de la philofophie de Platon , ou fi les Egyptiens y :
tombèrent d’eux-mêmes , après la perte du véritable
principe de leur fyftême mufical 3 mais « cet ufage
de rapporter les jours de lafemaine aux planètes, qui
a paflé des Egyptiens à toutes les nations , n’eft pas
de la première antiquité 3 ca r , autant que je puis voir,
il ne fe trouve point chez les anciens Grecs , » dit
Dion-Caffius, Hifi. rom., liv. 37 ; & c’eft M . i’abbé
Rouftier lui-même , p. 73 , qui me fournit cette
autorité. .
i ° . A l’égard du bronze qu’a trouvé M . l’abbé
Rouftier dans Montfaucon, Supplément a l’Antiquité
expliquée, Paris , 1 7 2 4 , tom. I , chap. 7 , pl. 17 ,
qui conftate , fuivant lu i , cet ordre des jours de la
lemaine chez les Egyptiens, je dis qu’en le fuppofant
antique, en le fuppofant égyptien, il ne fait pas le
rapport des . planètes aux jours de la femaine plus
ancien que ne le fuppofe Dion-Caftius. Il prouve, fi
l’on v eu t, jufqu’à un certain p o in t,l’ufage de lapro-
greftion triple, mais il n’en détermine pas le degré
d’antiquité j & cette antiquité probablement ne remonte
pas jufqu’à Pychagore , <* qui ne faifoit point
eftime du trois , -*> dit Plutarque, des Opinions des
Philofophes3 liv. I , n°. y.
30. Quant à l’application des heures du jour aux
planètes: ( voyez M. l'abbé Roujfier, p; 78 ) , Dion-
Caftius ne dit pas pofitivement quelle fe f î t chez les
Egyptiens 3 mais que c’eft une des manières d’expliquer
comment a pu fe faire l’application, des jours de la
femaine à ces mêmes planètes. Donc Dion-Caflius
ne fuppofe pas .cette application des heures plus ancienne
que celle des jours.
X X IV . « Le facré quaternaire a fervi principalement
aux Pythagoriciens pour l’établiflement du
canon harmonique. C ’eft au moyen de ce canon ,
qu’en divifant fucceflivement la proflambanomène en
deux, en trois, en quatre parties, & comparant enfemble
ces différentes parties , ôn obtient d’abord
toûtes les cordes nommées fixes on fiables du fyftême
des Grecs, favoir , les quatre fons f i mi la re , qui
font comme les points cardinaux de ce fyftême 3 &
que répétant enfuite l ’opération fur différentes parties
de la cord e, ou fur d’autres cordes montées à l’u.niflon
! de l’une des parties de ce lles -ci, on trouve les fons
! fo l ut fa ƒ b...... Enfin, ce même quaternaire fournit
dans le modèle 1 , 2 & 1 , 4 , les deux oétaves d’étendue
que porte le fyftême des Grecs.» Pag. 39.
i ° . Quelqu’ufage qu’aient fait du quaternaire les