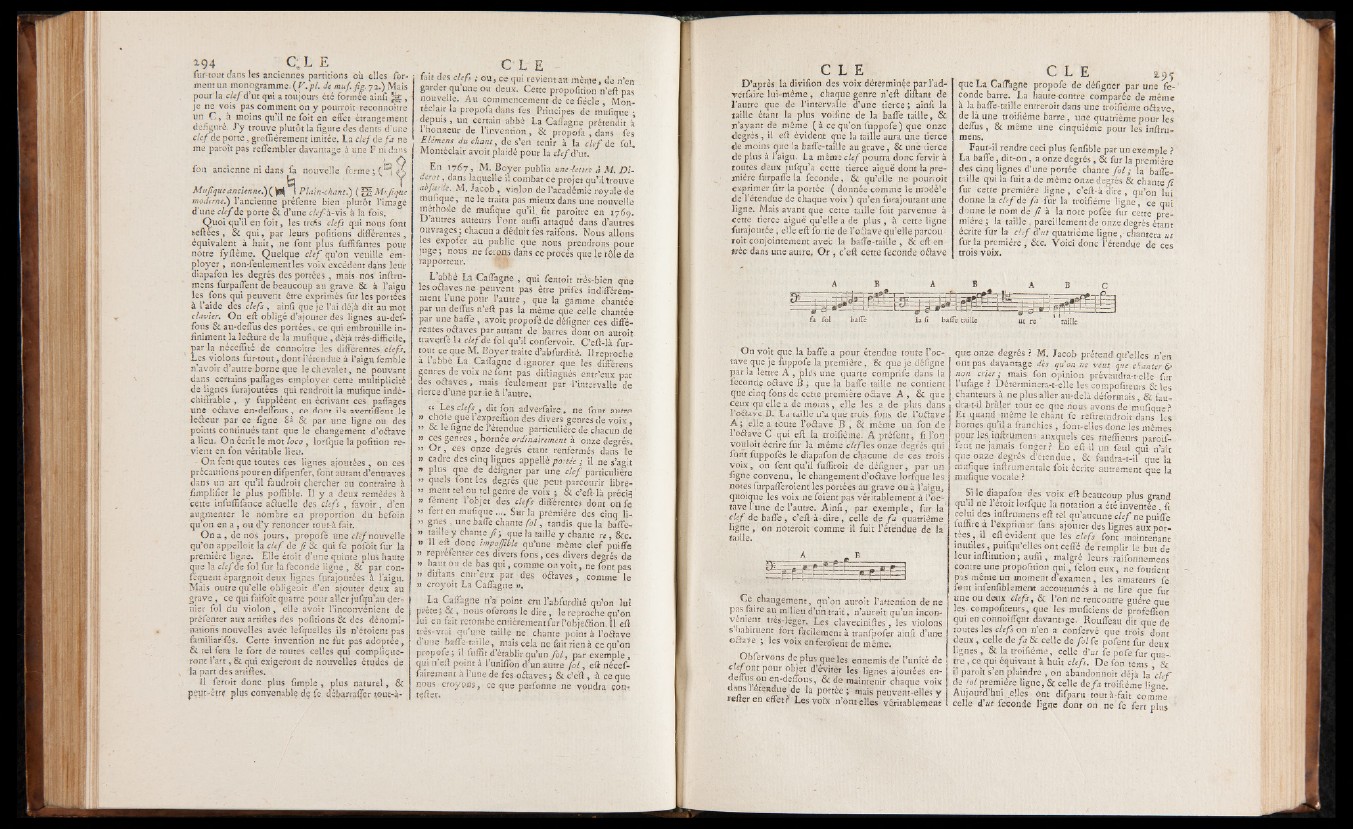
î-94 C;L E
fur-tout clans les anciennes partitions oit elles forment
un monogramme. [V .p l. de muf fig .jz.) Mais
pour'la clef d’ut qui a toujours été formée ainfi ^=j:,
je ne vois pas comment on y pourroit reconnoître
un C , à moins qu’il ne foit en effet étrangement
défiguré. J’y trouve plutôt la figure des dents d’une
c le f cle porte, grofiièrement imitée. La clef de fa ne
me paroît pas reflembler davantage à une F ni dans
fon ancienne ni dans fa nouvelle forme ; ( ^
h Y
Mufiqut ancienne.) ( ^ { Plain-chant.) ( f l Mt.fique
moderne?) l’ancienne préfente bien plutôt l’image
dune clef de porte & d’une clefk-vis à la fois.
Quoi qu’il en foit, les trc6s clefs qui nous font
heftées , & qui, par leurs positions differentes ,
équivalent à huit, ne font plus fuffifantes pour
nôtre fyflême. Quelque c le f qu’on veuille employer
, non-feulement les voix excèdent dans leur
diapafon les degrés des portées , mais nos inftru-
msns furpaflent de beaucoup au grave & à l’aigu
les fions qui peuvent être exprimés fur les portées
à l’aide des clefs-, ainfi que je l’ai déjà dit au mot
clavier. On eft obligé d’ajouter des lignes au-def-
fous & au-deffus des portées, ce qui embrouille in-
finiment la leéhire de la mufique , déjà très-difficile,
par la néceflité de connoître les differentes clefs, j
Les violons fur-tout, dont l’étendue à l’aigu femble
n’avoir d’autre borne que le chevalet, ne pouvant j
dans certains paffages employer cette multiplicité
de lignes furajoutées qui rendroit la mufique indéchiffrable
, y fuppléent en écrivant ces paffages
une oâave en-deffbus , ce dont ils avertiffent le
lecteur par ce figne 84 & par une ligne ou des
points continués tant que le changement d’o&ave
a lieu. On écrit le mot loco , lorfque la pofition revient
en fon véritable lieu.
On fent que toutes ces lignes ajoutées , ou ces
précautions pouren difpenfer, font autant d’entraves .
dans un art qu’il faudroit chercher au contraire à
fimplifier le plus pofiible. Il y a deux remèdes à
cette infuffifànce afluelle des clefs , favoir, d’en
augmenter le nombre en proportion du befoin
qu’on en a , ou d’y renoncer tout-à fait.
On a , de nos jours, propofé une clef nouvelle
qu’on appelloit la c le f de ƒ & qui fe pofôit fur la
première ligne. Elle étoit d’une quinte plus haute
que la clef de fol fur la fécondé ligne , & par con?
féquent épargnoit deux lignes furajoutées à l'aigu.
Mais outre qu’elle obligeoit d’en ajouter deux au
grave , ce qui faifo/tt quatre pour aller jufiqifau dernier
fol du violon, elle avoit l’inconvénient de
prélenter aux artiftes des pofitions & des dénominations
nouvelles avec lefquelles ils n’étoient pas.
familiarifés. Cette invention ne fut pas adoptée,
& tel fera le fort de toutes celles qui compliqueront
l’art, & qui exigeront de nouvelles études de
la part des artiftes.
11 feroit donc plus fimple , plus naturel, &
peut-êtrf plus convenable de fe débarraffer tout-à--
C L E
fait des clefs ; ou , ce qui revient au même, de n’en
garaer qu une ou deux. Cette propofition n’eft pas
nouvelle. Au commencement de cefiècle , Mon-
téclair la propofa dans fes Principes de mufique ;
depuis , un certain abbé La Caffagne prétendit à
1 honneur de l’invention, & propofa , dans fes
Elèmens du chant, de s’en tenir à la c le f de fol.
- Montéclair avoit plaidé pour la clefdhit.
En 17:67., M. Boyer publia une lettre à M. DU
derot, dans laquelle il combat ce projet qu’il trouve
ah fur as, M. Jacob , violon de l’académie royale de
mufique, ne le traita pas mieux dans une nouvelle
méthode de mufique qu’il, fit paroître en 1769.
D autres auteurs l’ont auffi attaqué dans d’autres
ouvrages; chacun a déduit fès raifons. Nous allons
les expofer au public que nous prendrons pour
juge ; nous ne fei^ns dans ce procès que le rôle de
rapporteur.
L’abbé La Caffagne , qui fentoit très-bien que
les ottaves ne peuvent pas être prifies indifféremment
1 une pour l’autre , que la gamme chantée
par un deflus n’eft pas la même que celle chantée
par une baffe , avoit propofé de défigner ces différentes
o&aves par autant de barres dont on auroit
traverfé U clef de fol qu’il confervoit. C ’eft-là fur-
tout ce que M. Boyer traite d’abfurdité. Il reproche
à 1 abbé La Caffagne d ignorer que les diftere<ns
genres de voix ne font pas diftingués entr’eux par
des oftaves, mais feulement par l’intervalle de
tierce d’une parue à l’autre.
“ Les clefs^, dit fon adverfaire , ne font autre
» chôfe que 1 exprefiion des- divers genres de v o ix ,
55 & le Ligne de l’étendue particulière de chacun de
” ces genres , bornée ordinairement à onze degrés.
55 O r , ces opze degrés étant renfermés dans le
v cadre des cinq lignes appellé portée ; il ne s’agit
y* plus que de défigner par une c le f particulière
55 quels font les degrés que peut parcourir libre-
» ment tel ou tel genre de voix ; & c’eft-là précis
» fement 1 objet des clefs différentes dont on fe
53 Lert en mufique .... Sur la première des cinq li-
53 §nes 5 une baffe chante fo l , tandis que la baffe-r
» taille y chante f i ; que la taille y chante re , &c.
» Il eft donc impojfibie qu’une même cle f puiffe
» repréfenter ces divers fons, ces divers degrés de
» haut ou de bas qui, comme on vo it, ne font pas
» diftans entr’eux par des o â a v e s , comme le
» croyoit La Caffagne ».
La Caffagne n a point cru l’abfüfdité qu’on lui
prete ; , nous oferons le dire, le reproche qu’on
lui en fait retombe entièrement fur Pobje&ion. Il eft
très-vrai qu une taille ne chante point à l’o&ave
a une baffe-taille, mais cela ne fait rien à ce qu’on
propofé; il fuffit d établir qu’un f o l , par exemple,
qui n eft point à 1 uniflon d un autre f o l , eft née effacement
à l’une de fes oélaves ; & c’e f t , à ce que
nous croyons, ce que perfohne ne voudra ço^
tçfter.
D ’après la divifion des voix déterminée par lad-
vérfaire lui-même, chaque genre n’eft diftant de
l ’autre que de l’intervalle d’ une tierce ; ainfi la
taille étant la plus voifine de la baffe taille, &
n’ayant de même ( à ce qu’on luppofe) que onze
degrés, il eft évident que la taille aura une tierce
de moins que !a baffe-taille au grave, & une tierce
de plus à l’aigu. La même clef pourra donc fervir à
toutes deux jufqu’à cette tierce aiguë dont la première
furpaffe la fécondé, & qu’ elle ne pourroit
exprimer fur la portée ( donnée comme le modèle
de l’étendue de chaque voix) qu’en furajoutant une
ligne. Mais avant que cette taille foit parvenue à
cette tierce aiguë qu’elle a de plus , à cette ligne
furajoutée, elle eft fortie de l’oÇtave qu’elle parcou
roit conjointement avec la baffe-taille, & eft en
frée dans une autre. Or , c’eft cette fécondé oélave
que La Caffagne propofé de défigner par une fécondé
barre. La haute-contre comparée de même
à la baffe-taille entreroit dans une troifiëme oélave,
de là une troifième barre, une quatrième pour les
deffus, & même une cinquième pour les inftru-
mens.
Faut-il rendre ceci plus fenfible par un exemple ?
La baffe, dit-on, a onze degrés, & fur la première
des cinq lignes d’une portée chante fo l ; la baffe-
r.ille qui la fuit a de même onze degrés & chante f i
fur cette première ligne, c’eft-àdire, qu’on lui
donne la c le f de fa fur la troifième ligne , ce qui
donne le nom de ƒ à la note pôfée fur cette première
; la taille , pareillement de onze degrés étant
écrite fur la cle f d'ut quatrième ligne, chantera ut
fur la première , &c. Voici donc Pétendae de ces
trois voix.
A B A B A
fa fol baffe la fî baffe taille ut re taille 6
On voit que la baffe a pour étendue toute l’oc- .
tave que je luppofe la première , & que je défigne
par la lettre A , pliîs une quarte comprife dans la
fécond^ oéiave B ; que la baffe-taille ne contient
que cinq fons de cette première oétave A , & que
ceux qu elle a de moins, elle les a de plus dans
l’odave B. La taille n’a que trois fons de l’o&ave
A ; elle a.toute l’o&ave B , & même un fon de
l’oâave C qui eft la troifième. A préfent, fi l’on
vouloit écrire fur la même clef les onze degrés qui
font fuppofés le diapafon de chacune de ces trois
v oix , on fent qu’il fuffiroit de défigner, par un
figne convenu, le changement d’oéiave lorfque les
notes furpafferoient les portées au grave ou à l ’aigu,
quoique les voix ne foient pas véritablement à l’octave
lune de l’autre. Ainfi, par exemple, fur la*
clef de baffe , c’eft-àd ire, celle de fa quatrième
ligne, on noteroit comme il fuit l’étendue de la
taille.
-
.changement, qu’on auroit l’attention de ne
pas faire au milieu d’un trait, n’auroit qu’un incon-
venient tres-leger. Les claveciniftes , les violons
s labituent fort facilement à tranfpofer ainfi d’une
©craye ; les voixenferolent de même.
Obfervons de plus que les ennemis de l’unité de
^'eÙont Pour ,°y.et d’évitèr les lignes ajoutées en-
defius ou en-deffous, & de maintenir chaque voix
dans 1 etendue de la portée ; mais peuvent-elles y
refter en effet? Les voix n’ont elles véritablement
que onze degrés ? M. Jacob prétend qu’elles n’en
ont pas davantage dès qu'on ne veut que chanter &
non crier ; mais fon opinion prévaudra-t-elle fur
l’ufage ? Déterminera-t-elle les compofiteurs & les
.chanteurs^à ne plus aller au-delà déformais, & £au-
dra-til brûler tout ce que nous avons de mufique?
Et quand même lé chant fe reftreindroit dans les
bornes.qu’il a franchies , font-elles donc les mêmes
pour les inftrumens auxquels ces mefiieurs paroif-
fent ne jamais fonger? En eft-il un feul qui n’ait
que onze degrés d’étendue, & faudra-t-il que la
mufique inftrumentale foit écrite autrement que la
.mufique vocale ? ^
Si le diapafon des voix efi beaucoup plus grand
qu il ne 1 etoit lorfqiie la notation a été inventée , fi
celui des inftrumens eft tel qu’aucune cle f ne puiffe
fuffire à l’exprimer fans ajouter des lignes aux portées,
il eft évident que les clefs font maintenant
inutiles, puifqu’elles ont ceffé de remplir le but de
leur inftitution ; auffi, malgré leurs raifonnemens
contre une propofition qui, félon eux, ne foutient
pas même un moment d’examen, les amateurs fe
font infenfiblemerit accoutumés à ne lire que fur
une ou deux clefs, & l ’on ne rencontre guère que
les. compofiteurs, que les muficiens de profeffion
qui en connoiffqnt davantage. Rouffeau dit que de
toutes les clefs on n’en a confervé que trois dont
deux, celle de fa & celle de fo lie pofent fur deux
lignes , & la troifième, celle à'ut fe pofe fur quatre
, ce qui équivaut à huit clefs. De fon tems ’ &
11 paroît s’en plaindre , on abandonnoit déjà la *c le f
de toi première ligne, & celle de fa troifième ligne
Aujourd’hui elles ont difparu tout à-fait comme
celle Sut fécondé ligne dont on ne fe fert plus