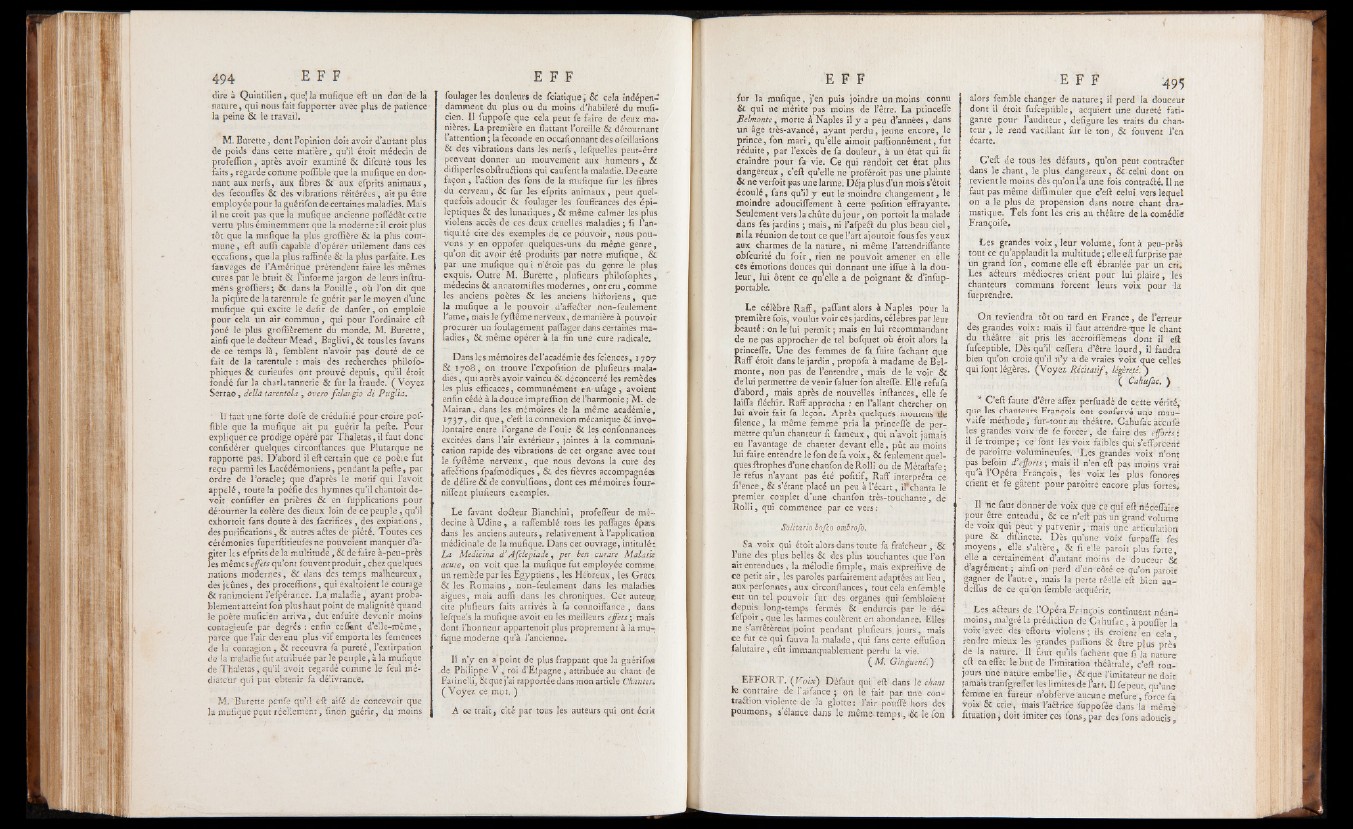
dire à Qu intilien, que’ l a mufique eft un don de la
nature, qui nous fait fupporter avec plus de patience
l a peine & le travail.
M. Burette , dont l’opinion doit avoir d’autant plus
de poids dans cette matière, qu’il étoit médecin de
profeffion, après avoir examiné & difcuté tous les
faits, regarde comme poffible que la mufique en donnant
aux nerfs, aux fibres & aux efprits animaux,
des fecouffes & des vibrations réitérées, ait pu être
employée pour la guérifon de certaines maladies. Mais
il ne croit pas que la mufique ancienne poffédât cette
vertu plus éminemment que la moderne : il croit plus
tôt que la mufique la plus groffière & la plus commune
, eft auffi capable d’opérer utilement dans ces
ççcafions, que la plus raffinée & la plus parfaite. Les
fauvages de l’Amérique prétendent faire les mêmes
cures par le bruit & l’informe jargon de leurs inftru-
méns groffiers ; 8c dans la Pouille, où l’on dit que
la piqûre de la tarentule fe guérit par le moyen d’une
mufique qui excite le defir de danfer, on emploie
pour cela un air commun , qui pour l’ordinaire eft
jou é le plus gromèrement du monde. M. Burette,
ainfi que le doéleur M ead, B aglivi, & tous les favans
de ce temps là , femblent n’avoir pas douté de ce
fait de la tarentule : mais des recherches philofo-
phiques & curieufes ont prouvé depuis, qu’il étoit
fondé fur la charktannerie & fur la fraude. (V o y e z
Serrao, délia tarentola , overo fatangiô di Publia.
' 11 faut une forte dofe de crédulité pour croire pof-
fible que la mufique ait pu guérir la pefte. Pour
expliquer ce prodige opéré par Thaletas, il faut donc
confidérer quelques circonftances que Plutarque ne
rapporte pas. D ’abord il eft certain que ce poèie fut
reçu parmi les Lacédémoniens, pendant la pefte, par
ordre de l ’oracle; que d’après le motif qui l’avoit
ap p e lé , toute la poéfie des hymnes qu’il chantoit de-
voit confifter en prières & en fupplications pour
•détourner la colère des dieux loin de ce peuple , qu’il
exhortoit fans doute à des facrifices , des expiations,
des purifications, & autres aétes de piété. Toutes ces
cérémonies fuperftitieufes ne pouvoient manquer d’agiter
les efprits de la multitude , & de faire à-peu-près
les mêmes effets qu’ont fouvent produit, chez quelques
nations modernes, & dans des temps malheureux,
des jeûnes, des procédions, qui exaltoient le courage
& ranimoient l’efpérance. La. maladie , ayant probablement
atteint fon plus haut point de malignité quand
le poète muficien a r r iva , dut enfuite devenir moins-
contâgieufe par degrés : enfin ceffent d’eile-même,
parce que l’air devenu plus-vif emporta les femences
de la contagion, & recouvra fa pureté, l’extirpation
de la maladie fut attribuée par le peuple, à la mufique
de Thaletas, qu’il avoit regardé comme le feul médiateur
qui put obtenir fa délivrance.
M. Burette penfe qu’il eft aifé de concevoir que
la mufique peut réellement, finon guérir, du moins
foulager les douleurs de fciatique ; & cela indépendamment
du plus ou du moins d'habileté du muficien.
I l fuppofe que cela peut fe faire de deux manières.
La première en flattant l’oreille & détournant
l’attention ; la fécondé en occafionnant des ofcillations
& des vibrations dans les nerfs, lefquelles peut-être
peuvent donner- un mouvement aux humeurs, &
difliperlesobftruéfions qui caufentla maladie. D e cette
fa çon , l’a&ion des fons de la mufique fur les fibres
du cerveau, & fur les efprits animaux, peut quelquefois
adoucir & foulager les fouffrances des épileptiques
& des lunatiques, & même calmer les plus
violens accès de ces deux cruelles maladies ; f i l’antiquité
cite des exemples dg ce pouvoir, nous pouvons
y en oppofer quelques-uns du même genre,
qu’on dit avoir été produits par notre mufique, &
par une mufique q u i n’étoit pas du genre le plus
exquis. Outre M. Bu rette, plufieurs j^hilofophes,
médecins 8t annatomiftes modernes, ont c ru , comme
les anciens poètes & les anciens hiftoriens, que
la mufique a le pouvoir d’affe&er non-feulement
Famé, mais le fyftême nerveux, de manière à pouvoir
procurer un foulagement paffager dans certaines maladies
, 8c même opérer à la fin une cure radicale.
Dans les mémoires de l’académie des fciences, 170 7
& 170 8 , on trouve l’expofition de plufieurs maladies
, qui après avoir vaincu 8c déconcerté les remèdes
les plus efficaces, communément en- u fage, avoient
enfin cédé à la douce impreffion de l’harmonie ; M. de
Mairan, dans les mémoires de la même académie,
1 7 3 7 , dit q u e , c’eft la connexion mécanique & involontaire
entre l’organe de lo u ie 8c les confonnances
excitées dans l ’air extérieur, jointes à la communication
rapide des vibrations de cet organe avec tout
le fyftême nerveu x, que nous devons la cure des
affe&ions fpafmôdiques, 8c des fièvres accompagnées
de délire 8c de convulfions, dont ces mémoires four-
niffent plufieurs exemples.
L e favant doâeur Bianchini, profeffeur de médecine
à U d in e, a raffemblé tous les paffages épars
dans les anciens auteurs, relativement à l’application
médicinale de la mufique. Dans cet ouvrage, intituler.
La Medicina d’Afclepiade, per ben curare Malatie
acute, on voit que la mufique fut employée comme
un remède par les Egyptiens , les Hébreux, les Grecs,
8c les P«.omains, non-feulement dans les maladies
aigues, mais auffi dans les chroniques. Cet auteur.,
cite plufieurs faits arrivés à fa connoiffance , dans
lefquels la mufique avoit eu les meilleurs effets ; mais
dont l’honneur appartenoit plus proprement à la mufique
moderne qu’à l’ancienne.
Il n’y en a point de plus frappant que la guérifodr
-de Philippe V , roi d’Elpagne, attribuée au chant de
Faiinelli, 8c que j’ai rapportée dans mon article Chanter,
( V o y e z ce mot. )
A oe tra it, cité par tous les auteurs qui ont écrit
fur la mufique, j’en puis joindre un moins connu
& qui ne mérite pas moins de l’être. La piinceffe
Belmonte, morte à Naples il y a peu d’années, dans
un âge très-avancé, ayant perdu, jeune encore, le
prince, fon mari, qu’elle aimoit paffionnément, fut
réduite, par l’excès de fa douleur, à un état qui fit
craindre pour fa vie. C e qui rendoit cet état plus
dangereux , c’eft qu’elle ne proféroit pas une plainte
& ne verfoit pas une larme. D éjà plus d’un mois s’étoit
é c o u lé , fans qu’il y eut le moindre changement, le
moindre adouciffement à cette pofition effrayante.
Seulement vers la chûte du jou r, on portoit la malade
dans fes jardins ; mais, ni l’afpeét du plus beau c iel,
ni la réunion de tout ce que l’art ajoutoit fous fes yeux
aux charmes de la nature, ni même l’attendriffante
obfcurité du f o i r , rien ne pouvoit amener en elle
ces émotions douces qui donnant une iffue à la douleu
r , lui ôtent ce que lle a de poignant & d’infup-
portable.
L e célèbre R a ff , paffant alors à Naples pour la
première fois, voulut voir ces jardins, célèbres par leur
beauté : on le lui permit ; mais en lui recommandant
de ne pas approcher de tel bofquet où étoit alors la
princeffe. Une des femmes de fa. fuite Tachant que
R a ff étoit dans le jardin, propofa à madame de Belmonte
, non pas de l’entendre, mais de le voir &
de lu i permettre de venir faluer fon alteffe. Elle refufa
d’abord, mais après de nouvélles inftances, elle fe
laiffa fléchir. R a ff approcha : en l’allant chercher on
lui avoit fait fa leçon. Après quelques momens de
filen ce , la même femme pria la princefiè de permettre
qu’un chanteur ft fam eu x, qui n’avoit jamais
eu l’avantage de chanter devant elle , pût au moins
lui faire entendre le fon de fa v o ix , & feulement quelques
ftrophes d’une chanfon de R olli ou de Métaftafe;
le'refus n’ayant pas été pofitif, Raff interpréta ce
f i’ence, & s’étant placé un peu à l’écart, il*chanta le
premier couplet d'une chanfon très-touchante, de
R o lli, qui commence par ce vers: x
Solitario Bofco ombrofo.
Sa vo ix qui étoit alors dans toute fa fraîcheur , 8c !
l’une des plus belles & des plus touchantes que l’on
ait entendues, la mélodie fimple, mais expreffive de
ce petit a i r , les paroles parfaitement adaptées au lieu ,
aux perfonsies, aux circonfiances, toutcéla enfemble
eut un tel pouvoir fur des organes qui fembloiënt
depuis long-temps fermés & endurcis par le dë-
lefp o ir, que les larmes coulèrent en abondance. Elles- ;
ne s’arrêtèrent point pendant plufieurs. jours, mais
ce fut ce qui fauva la malade, qui fans cette effufion •
falutaire, eût immanquablement perdu la vie.
( Af. Ginguené. ) 1
E F F O R T . (Voix) Défaut qui eft dans le chant
le contraire de 1 aifance 5 on le fait par une contraction
violente de la glotte: l’air pouffé hors des
poumons, s’élance dans le même- temps*, <$c le fon
. alors femble changer de nature ; il perd la douceur
dont il étoit fufceptible, acquiert une dureté fatigante
pour- l’auditeur, défiguré les traits du chanteur
, le rend vacillant fur le ton | & fouvent l’en
écarte.
C ’eft de tous des défauts, qu’on peut contrarier
dans le chant, le plus, dangereux, & celui dont on
revient le moins dès qu’on l a une fois contracté. Il ne
faut pas même diffimuler que c’eft celui vers lequel
on a le plus de propension dans notre chant dramatique.
T e ls font les cris au théâtre de la comédie
Françoife.
Les grandes v o ix , leur volume, font à peu-pràs
tout ce qu’applaudit la multitude; elle eft furprise par
un grand fon , comme elle eft ébranlée par un cri.
Les àCteurs médiocres crient poiir lui p la ire, les
chanteurs communs forcent leurs v o ix pour la
furprendre.
O n reviendra tôt ou tard en France, de l’erreur
des grandes voix : mais il faut attendre^que le chant
du théâtre ait pris les accroiffemens dont il eft
fufceptible. Dès qu’il ceffera d ’être lourd, il faudra
bien qu’on croie qu’il n’y a de vraies vo ix que celles
qui font légères. (V o y e z Récitatif, légèreté.)
( Cahufac, )
* C ’eft faute d’être allez perfuadé de cettè vérité,
que les chanteurs François ont confervé une mau-
vaife méthode; fur-tout au théâtre. Cahufac accufe
les grandes v o ix de fe forcer , de faire des efforts i
il fe trompe; c e : font les voix faibles qui s’efforcent
de paroître volumineuses. L e s grandes voix n’ont
pas befoin d’efforts ; mais il n?en eft pas moins vrai
qu’à l’Opéra François, lès voix les plus fonores
crient et fe gâtent pour paroître encore plus fortes;
Il n e faut don n e r de V oix que ce qu i eft.n é c e ffa ire
pour ê tre en ten d u , & ce. n’eft pas un grand v o lum e
de v o ix ‘qui peut* y p a rv en ir , mais une articulation
pu re & diftincte. Dès qu ’u n e v o ix furpa ffe fes
m o y e n s , elle s’a lt è r e , & fi elle pa ro it plus f o r t e ,
elle a certainement d’autant moins de dou ceur &
d’agrément ; ainfi on perd d’un cô té ce qu’on p a ro ît
g agner de l ’a u t r e , mais la p erte réelle eft b ien a u -
deffus d e c e q u ’on femble acquérir.
Les a&eurs de l’Opéra François continuent néanmoins,
malgré la prédiâion de C a h u fa c , à pouffer la
voix JaVec des'efforts violen s; ils croient en cela
rendre mieux les grandes pallions & être plus près
de la nature. Il faut qu’ils fâchent que fi la nature
eft en effet le but de l’imitation théâtrale, c’eft toujours
une nature embe’l ie , & que l’imitateur ne doit
jamais tranfgreffer les limites de l’art. Il fepeut, qu’une
femme en fureur n’obferve aucune mefure, force fa
voix 8c crie, maisTaftrice fuppofée dans la même
fituation i doit imiter, ces fons, par des fons adoucis,