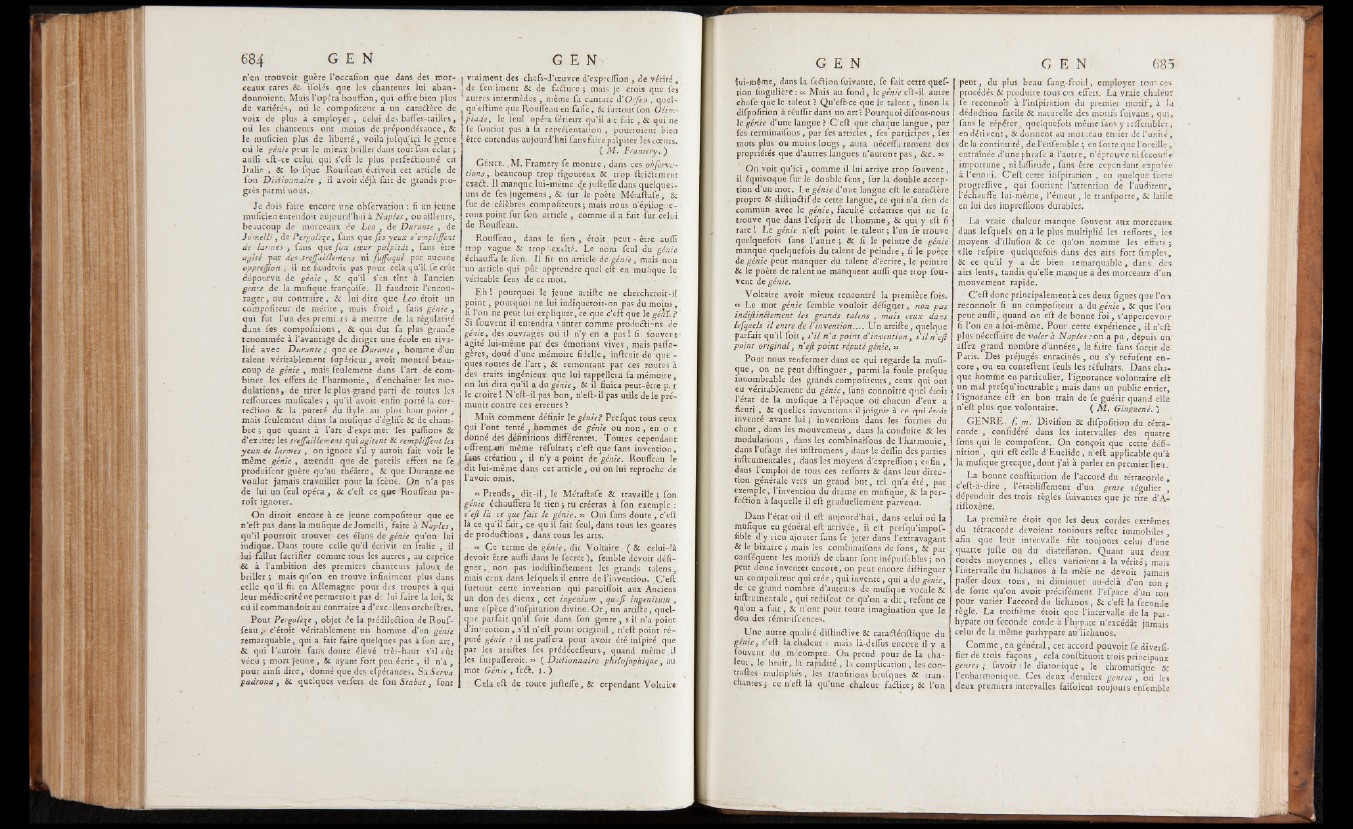
n’en trouvoic guère l’occafion que dans des morceaux
rares ifolés : que les chanteurs lui aban-
donnoientv Mais l’opéra bouffon, qui offre bien plus
de variétés, où le compofiteur a un cara&ère de
voix de plus à employer , celui des baffes-tailles,
où les chanteurs ont moins de prépondérance, &
le muficien plus de liberté, voilà jufqu’ ici le genre
où le génie peut le mieux briller dans tout ion éclat }
aufii tft-ce celui qui. s’cft le plus perfectionné en
Italie , & lo fque Rouffeau écrivoit cet article de
(on Dictionnaire , il avoir déjà fait de grands pio-
grès parmi nous...
Je dois faire encore une ôbfervation : fi un jeune
muficien entendoit aujourd’hui à Naples, ou ailleurs,
beaucoup de morceaux de Léo , de Durante , de
Jotnellr, de PergoVeze, fans que fes yeux s ’empliffent
de larmes y fans que fon coeur palpitât, fans être
agité par des ,trejfai lie métis ni fuffoqué par aucune
opprejjtori, il ne faudroic pas pour cela qu’il fe crût
dépourvu de génie , & qu’il s’en tînt à l’ancien
genre de la mufique françoife. Il faudroit l’encourager
y au contraire ,• & lui dire que Léo étoit un
compofîteur de mérite , mais froid , fans génie ,
qui fut l’un des premiers à mettre de la régularité
dans fes compofitions, & qui dut fa plus grande
renommée à l’avantage de_diriger une école en rivalité
avec Durante ; que ce Durante , homme d’un
talent véritablement fupérieur, avoit montré beaucoup
de génie , mais feulement dans l’art de combiner
les effets de l’harmonie, d’enchaîner les modulations,
de tirer le plus grand parti de toutes les
reffources muficales j qu’il avoit enfin porté la correction
& la . pUreté du ftyle au plus haut point ,
mais feulement dans la mufique d’églife & de chambre
y que quant à l’art d’exprmer les partions &
d’exciter les trejfaillemens qui agitent & remplirent les
yeux de larmes , on ignore s’il y auroit fait voir le
même génie y attendu que de pareils effets ne fe ,
produifent guère qu’au théâtre, & que Durante ne
voulut jamais travailler pour la fcène. Qn n’a pas
de lui un feul opéra , & c’eft ce qpc Rouffeau pa-
roît ignorer.
O n diroit encore à ce jeune compofiteur que ce
n’eft pas dans la mufique de Jomclli, faite a Naples y
qu’il pourroit trouver ces élans de génie qu’on lui
indique. Dans toure celle qu’il écrivit en Italie , il
lu i fallut facrifier comme tous les autres, au caprice
& à l’ambition des premiers chanteurs jaloux de
briller ; mais qu’on en trouve infiniment plus dans
celle q u'il fit en Allemagne pour des troupes à qui
leur médiocrité ne permettoit pas de lui faire la loi, &
où il commandoit au contraire à d’excellens orcheftres.
Pour Pergolé\e , objet de la prédile&ion de Rouffeau
y* c’étoit véritablement un homme d’un génie
remarquable, qui a fait faire quelques pas à fon art,
& qui l ’auroit fans doute élevé très-haut s’il eût
vécu , mort jeune , 6c ayant fort peu é c r it , il n’a ,
pour ainfi dire, donné que des efpérances, SzServa
padrona, & quelques verfets de fon Stabat, font
| vraiment des chefs-d’oeuvre d’expreflion , de v érité,
| de lemiment & de fafture } mais je crois que fes
! autres intermèdes , même fa cantate d'Orfeo , quel-
qu’eftime que Rouffeau en fa lfe , & furtouc fon Olim-
piade, le feul opéra férieux qu’il ait fa it , & qui ne
fe foutint pas à la repréfentàtion , pourroient bien
être entendus aujourd’hui fans faire palpiter les coeurs.
( M.. Frameryi. )
G én ie . , M . Framery fe montre, dans ces obfervu-
tionsy beaucoup trop rigoureux & trop ftri&ement
exaét. Il manque lui-même de jüfteffe dans quelques-
uns de fes jugemens, & fur le poète Méraftafe, 8c
fur de célèbres cpmpofiteursj mais nous n’épilogue-
rons point fur fon article , comme il a fait fur celui
de Rouffeau.
Rouffeau, dans le f ien , étoit p eu t-ê tre aufli
trop vague & trop exalté. Le nom feul du génie
échauffa le fien. Il fit un article de génie, mais non
un article qui pût apprendre quel eft en mulique le
véritable fêns de ce mot.
Eh 1 pourquoi le jeune artifte ne chercheroit-il
poin t, pourquoi ne lui indiqueroît-on pas du moins,
fi l'on ne peut lui expliquer, ce que c’eft que le gerîi, ?
Si fouvent il entendra vanter comme productions der
géniet des .ouvragés où il n’y en a pas I fi fouvert-
agité lui-même par des émotions viv es , mais paffa-
gères, doué d’une mémoire fidelle, inftrnit de que -
ques routes de l’a r t , & remontant par ces routes à
des traits ingénieux, que lui rappellera fa mémoire ,
on lui dira qu’il a du génie, & il finira peut-être p. r
le croire 1 N ’eft-il pas bon, n’eft-il pas utile de le prémunir
contre ces erreurs ?
Mais comment définir le génie? Prefque tous ceux
qui l’ont tenté , hommes de génie ou non , en o= c
donné des^définitions différentes. Toutes cependant
offrent-un même rêfultat} c’eft que fans invention,
fàas création , il n’y a point de génie. Rouffeau le
-dit lui-même dans cet article, où on lui reproche de
l’avoir omis.
« Prends, d it- il, le Métaftafe & travaille j fon
génie échauffera le tien j tu créeras à fon exemple :
c’eft la ce que fait le génie, sa Oui fans doute, c’eft
là ce qu’il fa it, ce. qu'il fait feul, dans tous les genres
de productions, dans tous les arts.
• « C e terme de génie, dit Voltaire ( & . celui-là
devoir être aufli dans le fecrc t) , femble dévoir défi-
gner, non pas indiftinCtement les grands talens,.
mais ceux dans lefquels il entre de l’ invention. C ’eft
furtout cette invention qui paroiffoit aux Anciens,
un don des dieu x, cet ingenium , quufi ingenitum ,
une efpèce d’infpiratïon divine. O r , un artifte, quelque
parfait qu’il foit dans fon genre, s il n’a point
d’invention , s’il n’eft point or ig in a l, n’eft point réputé
génie : il ne paffera pour avoir été inlpiré que
par les artiftes fes prédéceffeurs, quand même il
les furpafferoit. » ( Dictionnaire pkilofopkique, au
mot Génie, feCt. i . )
C e la .eft de toute jüfteffe, & cependant Voltaire
lui-même, dans la feCtion fuivante, fe fait cette qnef-
tion fingulière : ce Mais au fon d, le génie eft-il autre
chofe que le talent ? Qu ’eft-ce que le talent, finon la
difpofition à réuflir dans un art? Pourquoi difons-nous
le génie d’une langue ? C 'e ft que chaque langue, par
fes terminaifons, par fes articles , fes participes, fes
mots plus ou moins longs , aura néceffalrement des
propriétés que d’autres langues n'auront pas, &c. *>
On voit qu’i c i , comme il lui arrive trop fou ven t,
il équivoque fur le double fens, fur la double acception
d’un mot. Le génie d’une langue eft le caraClère
propre & diftinCtifde cette langue, ce qui n’a rien de
commun avec le génie, faculté créatrice qui ne fe
trouve que dans l’efprit de l'homme, & qui y eft fi
rare! L e génie n’eft point le.talent} l’un fe trouve
quelquefois fans l ’autre} & fi le peintre de génie
manque quelquefois du talent de peindre , fi le poète
de génie peut manquer du talent d’écrire, le peintre
& le poète de talent ne manquent aufli que trop fouvent
de génie.
Voltaire avoit mieux rencontré la première fois.-
*c Le mot génie femble vouloir défigger, non pas
indiftinétement les grands talens , mais ceux dans
lefquels i l entre de l ’invention.... Un artifte, quelque
parfait qu’il fo it, s'il n a point d'invention, s’iln eft \
point original, n’eft point réputé génie, »
Pour nous renfermer dans ce qui regarde la mufiq
u e , on ne peut diftinguer, parmi la foule prefque
innombrable des grands compofîteurs, ceux qui ont
eu véritablement du génie y fans connoître quel écoit .
l ’etat de la mufique à l’époque où chacun d’eux a ;
fleuri, & quelles inventions il joignit à ce qui étoit
inventé avant lui f inventions dans les formes du
chant, dans les mouvemens, dans la conduite & les
modulations, dans les combinaisons de l'harmonie,
dans l’ufage des inftrumens, dans le deflin des parties
inftrumentales, dans les moyens d’expreflion j enfin ,
dans l’emploi de tous ces refforts & dans leur direction
générale vers un grand bu t, tel qu’a é té , par
exemple, l’invention du drame en mufique, & la perfection
à laquelle il eft graduellement parvenu.
Dans l’ état où il eft aujourd’hui, dans celui où la
mufique en général eft arrivée, il eft prefqu’impof-
fible d’y rien ajouter fans fe jeter dans l'extravagant
& le bizarre $ mais les combinaifons de fons, & par
conféquent les motifs de chant font inépuifables, on
peut donc inventer encore., on peut encore diftinguer
un compoficeur qui crée, qui invente, qui a du génie,
de ce grand nombre d'auteurs de mufique vocale &
inftrumentale, qui redifent ce qu’on a d it, refont ce
u’on a fa it , & n’ont pour toute imagination que le
on des réminifcences.
Une autre qualiié diftin&ive & caraftériftique du
génie, c’eft la chaleur : mais là-deffus encore il y a
fouvent du m.'compte. On prend pour de la chaleur
, le bruit, la rapidité , la complication , les con-
traftes-multipliés, les tranfitions brufques & tranchantes}
ce n’eft là qu’une chaleur fa&icej & l’on
peut, du plus beau fang-froid, employer tous ces
‘procédés.& produire tous ces effets.- La vraie chaleur
iCe reconnoît à l’infpiration du premier motif, à la
déduction facile & naturelle des motifs fuivans, qui,
fans le répéter, quelquefois même fans y reffcnibler,
en dérivent, & donnent au morceau enrier de l’unité,
de la continuité, de l’enfemble ; en forte que l’o reille,
entraînée d’une phrafe à l’autre, n’éprouve ni fecouiTe
importune, nilaffuude, fans être cependant expofée
à l’ ennui. C ’eft cette infpiration , en quelque forte
progrc-flive , qui foutient l’attention de l’auditeur,
1’échauffe lui-même, l’émeut, le tranfporte, & laifle
en lui des impreflions durables.
La vraie chaleur manque fouvent aux morceaux
dans lefquels on a le plus multiplié les refforts, les
moyens d’illufion & ce qu’on nomme les effe ts}
elle refpire quelquefois dans des airs fortfimples,
& ce qu’il y a de bien remarquable, dans, des
airs lents, tandis que lle manque à des morceaux d’un
mouvement rapide.
C ’eft donc principalement à ces deux lignes que l ’on
reconnoît fi un compofiteur a du génie, & que l’on
peut aufli, quand on eft de bonne f o i , s’appercevoir
fi l’on en a foi-même. Pour cette expérience, il n’eft
plus néccffaire de volera Naples .*on a p u , depuis un
affez grand nombre d’années, la faire fans fortir de
Paris. Des préjugés enracinés y ou s’y refufent encore
, ou en conteftent feuls les réfulrats. Dans chaque
homme en particulier, l’ignorance volontaire eft
un mal prefqu’incurable} mais dans un public entier,
l ’ignorance eft en bon train de fe guérir quand elle
n’eft plus que volontaire. ( M. Ginguené. )
G E N R E , f . m. Divifion & difpofition du tétra-
corde , confidéré dans les intervalles des quatre
fons qui le compofent. On conçoit que cette définition
, qui eft celle d’Eu clid e, n’eft applicable qu’à
la mufique g recque, dont j’ai à parler en premier lieu.
La bpnne conftitution de l’accord du tétracorde ,
c’eft-à-dire , l’érabüffement d’un genre régulier ,
dépendoit des trois règles fuivantes que je tire d’A -
riftoxène.
La première étoit que les deux cordes extrêmes
du tétracorde dévoient toujours refter immobiles
afin que leur intervalle fût toujours celui d’une
quarte jufte ou du diateffaron. Quant aux deux
cordes moyennes , elles varioient à la vérité} mais
l’intervalle du lichanos à la mèfe ne devoir jamais
paffer deux tons, ni diminuer au-delà d’un ton..*
de forte qu’on avoit précifémenc l ’efpace d’un ton
pour varier l’accord du lichanos , & c’eft la fécondé
règle. La troifième étoit que riutervalle de la par-
hypate ou fécondé corde à l’hypate n’excédât jamais
celui de la même parhypate au'îicljanos.
Comme , en général, cet accord pouvoît fe diverfi-
fier de trois façons, cela conftituoit trois principaux
genres ; favoir : le diatonique , le chromatique &
l’enharmonique. Ces deux derniers genres, où les
deux premiers intervalles faifoient toujours enfemble