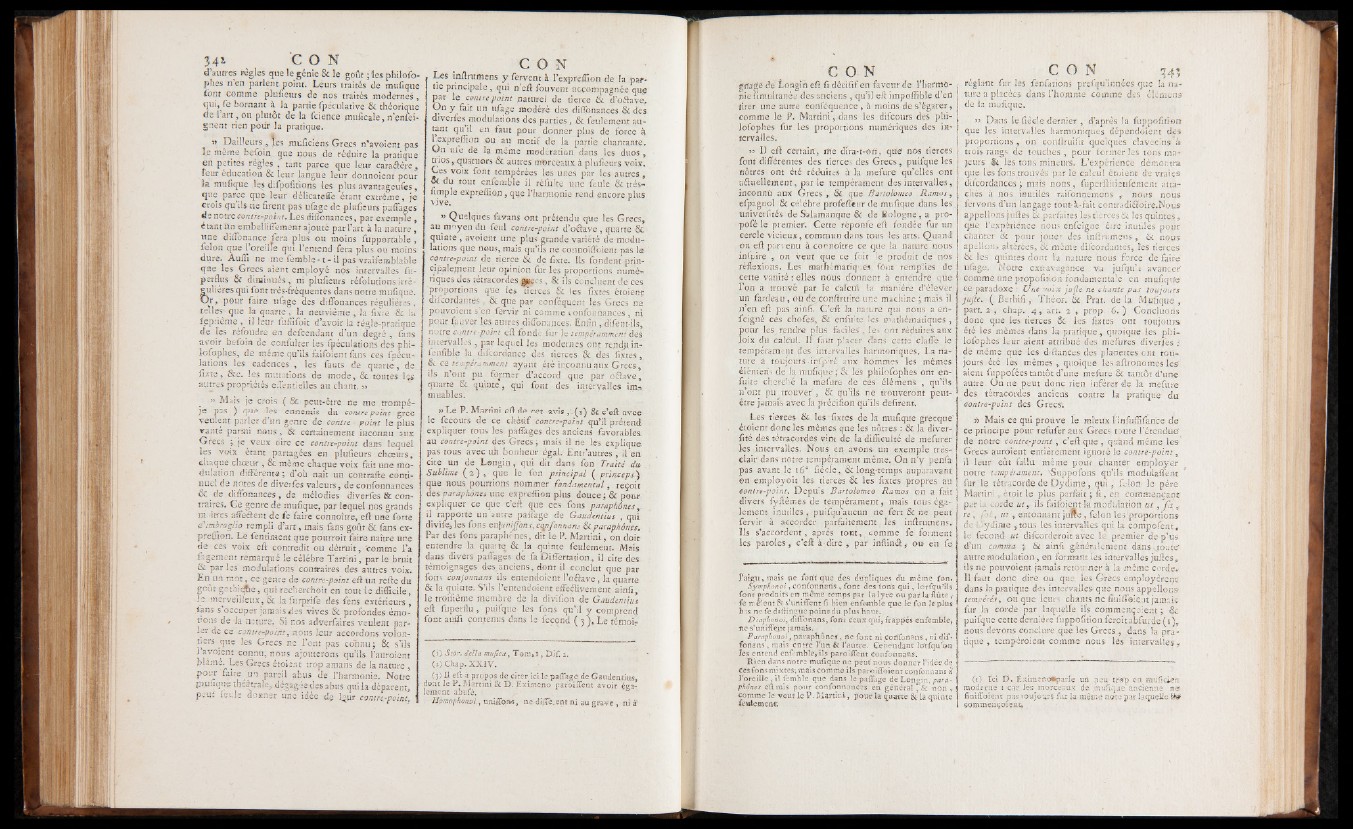
34* C O N
d’autres règles que le génie & le goût ; les philofo-
phes n’en parlent point. Leurs traités de mufique
fbiît comme plufieurs de nos traités modernes,
qui, fe bornant à la partie fpéculative & théorique
de 1 art, ou plutôt de la fcience muficale, n’enfei-
gnent rien pour la pratique.
Dailleurs.j les jnuficiens Gre.cs n’avoient pas
le même besoin. que nous de réduire la pratique
en petites règles , tant parce que leur çara&è.re ^
leur éducation & leur langue leur donnoient pour
la mufique le s difpofitions les plus avantageuses,
que parce que- leur délicateffe étant extrême, je
crois qu ils ne firent pas ufage de plufieurs paffages
de notre contre-point. Les diffonances, par exemple ,
étant an embelliffement ajouté par l’art à la nature,
une diffonance fera plus ou moins fupportable,
félon que l’oreille qui l’entend fera plus ou moins
dure. Aufli ne me femble-t- il pas vraifemblable
qae les Grecs aient employé nos intervalles fn-
perflus & diminués, ni plufieurs réfolutions irré-
gulières qui font très-fréquentes dans notre mufique.
O r , pour faire ufage des diffonances régulières., j
telles^que la quarte, la neuvième, la fix;e & la !
fep: ième , il leur fuffifoit d’avoir la règle-pratique
de les réfoudre en defcendant d’un degré , lans
avoir befoin de confulter les fpéculations des phi-
lofophes, de même qu’ils faifoient fans ces fpécu-
lations les cadences , les fauts de quarte, de
fix te, &c. les mutations de mode, & toutes l$s
autres propriétés edèntieiles au chant. »
| Mais je crois ( & peut-être ne me trompé-
jé pas ) que les ennemis du contre-point grec
veulent parler d ’un genre de contre - point le plus
vanté parmi nous, & certainement inconnu aux
Gtécs ; je veux dire ce contrepoint dans lequel
les voix étant partagées en plufieurs choeurs,
chaque choeur , & meme chaque voix fait une modulation
différente ; d’où naît un contrafte continuel
de notes de diverfes valeurs, de confonnances
& de diffonances, de mélodies diverfes & contraires.
Ce genre de mufique, par lequel nos grands
maîtres affeâent de fe faire connoître, eft une forte
d? imbroglio rempli d’art , mais fans goût .& fans ex-
prefiion. Le fentiment que pourroit faire naître une
de ces voix eft contredit ou détruit, 'comme l’a
fagement remarqué le célébré Tartini, par le bruit
& par les modulations contraires des autres voix.
En un mot, ce genre de contre-point eft un refte du
goût gerh-qtie, qui recherchoit en tout le difficile,
Je merveilleux, & la furprife des fens extérieurs ,
fans s’occuper jamais des vives & profondes émo- •
nous de la nature. Si nos adverfaires veulent parler
de ce contre-point, sa-ous leur accordons volon-
tiers que les Grecs ne l’ont pas connu; & s’ils
lavoient connu, nous ajouterons qu’ils l’auroient
jblamé. Les Grecs étoient trop amans de la nature ,
pour faire un pareil abus de l’harmonie. Notre
punique théatrale, dégagée des abus qui la déparent,
peut feule donner une idée d$ %ûr contrepoint, '
C O N
Les inftrumens y fervent à l’expreftion de la partie
principale , qui n’eft fouvent accompagnée q.u@
par le contrepoint naturel de tierce & d’oâave.
On y faivt un ufage modéré des diffonances & des
diverfes modulations des parties, .& feulement autant
qu il en faut pour donner plus de force à
hexpreflion .©u au motif de, la partie chantante.
On ufe de la même modération dans les duos,
trios, quatuors & autres morceaux à plufieurs voix.
Ces voix font tempérées les unes par les autres 9
oc du tout enfemble il réfuite une feule & très-
fimple expr.effi.on, que l’harmonie rend encore plus
vive.
» Quelques favans ont prétendu que les Grecs,
an moyen du feul contrepoint d’oftave, quarte &
quinte, avoient une plus grande variété de modulations
que nous, mais qu’ils ne connoiffoient pas le
contre-point de tierce & de fixte. Ils fondent prin-
cjpalezpent leur opinion fur les proportions mimé*
riques des tétracordes ge^cs, & ils concluent de ces
proportions que les tierces & les fixtes étoient
difeordantes, & que par coriféquent les Grecs ne
pouvoient s’en fervir ni comme lonfonnances , ni
pour fauver les autres diffonances. Enfin, difent-ils,
notre contre -point eft fonde fur le tempéramment des
intervalles , par lequel les modernes ont rendu in*
fenfible la difeordaneç des tierces $c des .fiâtes,
& ce tempfrarnment ayant éjé inconnu aux Grecs,
ils n’ont pu former d’accord que par o â a v e ,
: quarte & quinte ? qui font des intervalles imr.
muables.
» Le P. Martini eft de cet avis , . ( i ) & c’eft avec
le fecours de ce chétif contrepoint qu’il prétend
expliquer tous les paffages des anciens favorables,
au contrepoint des Grecs ; mais il ne les explique,
pas tous avec uja bonheur égal; Entr’autres , il en
cite un de Longin, qui dit dans fon Traité du
Sublime ( 2 ) , que le fon principal ( princeps).
que nous pourrions nommer fondamental, reçoit
des par aphones une expreffion plus douce; & pour
expliquer ce que c’eft que ces fous paraphônes,
4 rapporte un autre paffage de Gaudentius , qui
divife, les fons enfunifions, cqpfonnans 6c paraphâmes.
Par des fons paraphônes, dit le P. Martini, on doit
entendre la quarte & la quinte feulement. Mais
dans divers paffages de fa Differtation, il cite des
témoignages des_anciens, dont il conclut que par
fons conjonnans ils entendoient l’o&ave, la quarte
& la quinte. S’ils Pentendoient effeélivement ainfi
le troifième membre de la divifiçn de Gaudentius
eft fupérflu , puifque les fons qu’il y comprend
font aufli contenus dans le fécond ( 3 ). Le témoir
(1) Stor. délia mu fie a, Tomt i ? Dijf. 2.
(2 ) .C h a p , X X IV .
. (3) Il eff à propos de citer ici le paffage de Gaudentius,
dont le P. Martini & D. Exùneno paroiffent avoir également
abufé. r '
Iipmophonoi., unifions, ne., diffèrent ni au grave , ni a
c O N
grfdg'é dé Lohgïn eft fi décifif en faveur de l’harmô-
nie fimultanés des anciens , qu’il eft impofiible d’en
tirer une autre eonféquence , à moins de s’égarer,
comme le P. Martini, dans les difeours des phi-
lofophes fur les proportions numériques des intervalles.
»a II eft certain, me dira-t-orr, qné nos tierces
font différentes des tierces des Grecs, puifque les
nôtres ont été réduites à la mefure qu’elles ont
a&uellemenf, par le tempérament des intervalles,
inconnu aux Grecs , & que Bariolâmes Ramos,
efpagnol & célèbre profeffeur de mufique dans les
tmiverfités de Salamanque & de Mologne, a pro-
pofé le premier. Cette réponfe eft fondée fur un
cercle vicieux , commun dans tous les arts. Quand
on eft parvenu à cornoître ce que la nature nous
înfpire , on vent que ce foit le produit de nos
réflexions. Les mathémafiq'.es font remplies de
cette vanité : elles nous donnent à entendre que
l ’on a trouvé par le calcul la manière d’élever
un fardeau , ou de^coHftruirè une machine ; mais il
n’en eft pas ainfi, C ’eft la nature qui nous a en-
feigné ces chofes, & enfin te lés mathématiques ,
ponr lesr rendre plus faciles’ , les ont réduites aux ;
Joix du calcul. 11’faut placer dans cette claffe le
tempérament des intervalles harmoniques. La nature
à toujours infplré aux- hommes les mêmes
élément de la mufique; & lés philofophes ont en-
fuite cherché la mefure de ces: élémens , qu’ils
n’ont pu trouver , & qu’ils né trouveront peut-
être jamais avec la préçifion qu’ils défirent.
Les tierces & les fixtes delà mufique grecque'
étoient donc les mêmes que les nôtres : & la diversité
des tétracordes vint de la difficulté de mefurer
les intervalles. Nous en avons un exemple très-
clair dans notre tempérament même. On n y penfa-
pas avant le 16e fiècle, & long-temps auparavant
©n; èmployoit les tierces & les fixtes propres au
contre-point. Depuis Bartolomeo Ramos eii a fait
divers fyftêmes de tempérament, mais tous également
inutiles , puifqu’aucun ne fert & ne peut
fervir à accorder parfaitement les inftrumens.
Ils s’accordent, après tout, comme fe forment
les paroles, c’eft à-dire , par infiimft ,■ ou en fe
f aigu, mais ne font que des dupliques du même fon.
Symphonoi, confonnaris , font des tons q u i, lorfqu’îls
font' produits etr même temps par la lyre ou par la flûte ,•
fe mêlent & s’uniffent fi bien enfemble que le fon le plus
bas ne fe diftingue point-du plus haut.
Diaphonoi, difibhans, font ceux qui, frappés enfemble,
fie shmiffebt jamais. •
Paraphonoi, paraphônes, rie font ni corffonans, ni dif-
fonans , mais- entre l’un & l’autre. Cependant lo'rfqu’on
les eritend enfemble,-ils paroiffent donfonnàns.
Rien' dans notre mufique ne peut' nous donner l’idée de
Ces fons mixtes-, mais comme ils paroiffoient confonnans a
l’oreille , il fembte que d’ans le paffage de Longin, pard-
p.hones eft mis pour confonnances en général , & non ,
comme Fe veut le P. Martini, pour la quarte & la quinte
feulement
C O N 345
réglant fur les fenfations prefqu’innées que !a nature
a placées dans l’homme comme des élémens'
de la mufique.
... 53 Dans ,le fiècle dernier , d’après la fuppofirion
que les intervalles harmoniques dépendoient des
proportions , on conftruifit quelques clayecins à
trois rangs de touches , pour former les tons majeurs
& les tons mineurs. L’expérience démontra
que les fons trouvés par le calcul étoient dé vraies
discordances ; mais nous, fuperftiiieufement attachés
à nos inutiles raifonnemens 9- nous nous
fervons d’un langage tout-à-fait contradiéïoire.Nous
appelions juftes 6c parfaites les tierces 6c les quintes,
que l’expérience nous enfeigne être inutiles pour
chanter &c pour jouer des inftrumens , & nous
apellons altérées, 6c même difeordantes, l’es tierces
6c les quintes dont la nature nous force de faire'
ufage. Notre extravagance va jufqu’a avancer’
comme une propofitioii fondamentale en mufiqife
ce paradoxe : Une voix jufle ne chante pas toujours
jufie. (. Berhifi, Théor. 6c Prat. delà- Mufique,
part. 2 , chap. 4 , art. 2 , prop. 6 . ) Concluons
donc que les tierces & les fixtes ont toujours
été les mêmes dans la pratique, quoique les philofophes
leur aient attribué des mefures diverfes <
de même que les dffîanées des plaoettes ont- toujours
été les mêmes, quoique les aftronoines les:
aient fuppofées tantôt d’une mefure & tantôt d’une
autre. On ne peut donc rien inférer de la mefure
des tétracordes anciens contre la pratique du’
contrepoint des Grecs'.
s> Mais ce qui prouve le mieux l infuffifance de
ce principe pour refufer aux Grecs toute l’étendue'
de notre contrepoint, c’eft que, quand même les-
Grecs auroient entièrement ignoré le contre-point,
il leur eut fallu même pour chanter employer
notre tempérament. NSuppofons qu’ils modulaflènt
fur le tétracorde de Dydime, qui ? félon- le père
Martini,, étoit le plus parfait ; f i , en commençant
par la corde ut, ils faifoient-la modulation u t , fa ^
te , f o l , u t , entonnant jurte, félon les proportions-
de üydinae ,-tous les intervalles qui la compofent,
le fécond- ut difeorderoit avec le premier de p’us
d’un comma ;- & ainfi généralement dans ...toute'
autre modulation, en formant les intervalles juftes,
ils ne pouvoient jamais retourner à la même corde.-
11 faut donc dire ou que les Grecs employèrent?
dans la pratique des intervalles que nous appelions
tempérés, ou que leurs chants ne finiffoient jamais
fur la corde par laquelle ils commençoient ; 6c
puifque cette dernière fiippofition feroitabfurde (1),
nous devons conclure que les Grecs , dans la pratique
, tempérôient comme nous lés intervalles y
(1) Ici D. Éxiiîienospat-le un peu trs’p en muficién
moderne : car les morceaux de ,mufique ancienne a et
finiffoient pas toujours fur la même note par laquelle lè#
conimençoient*