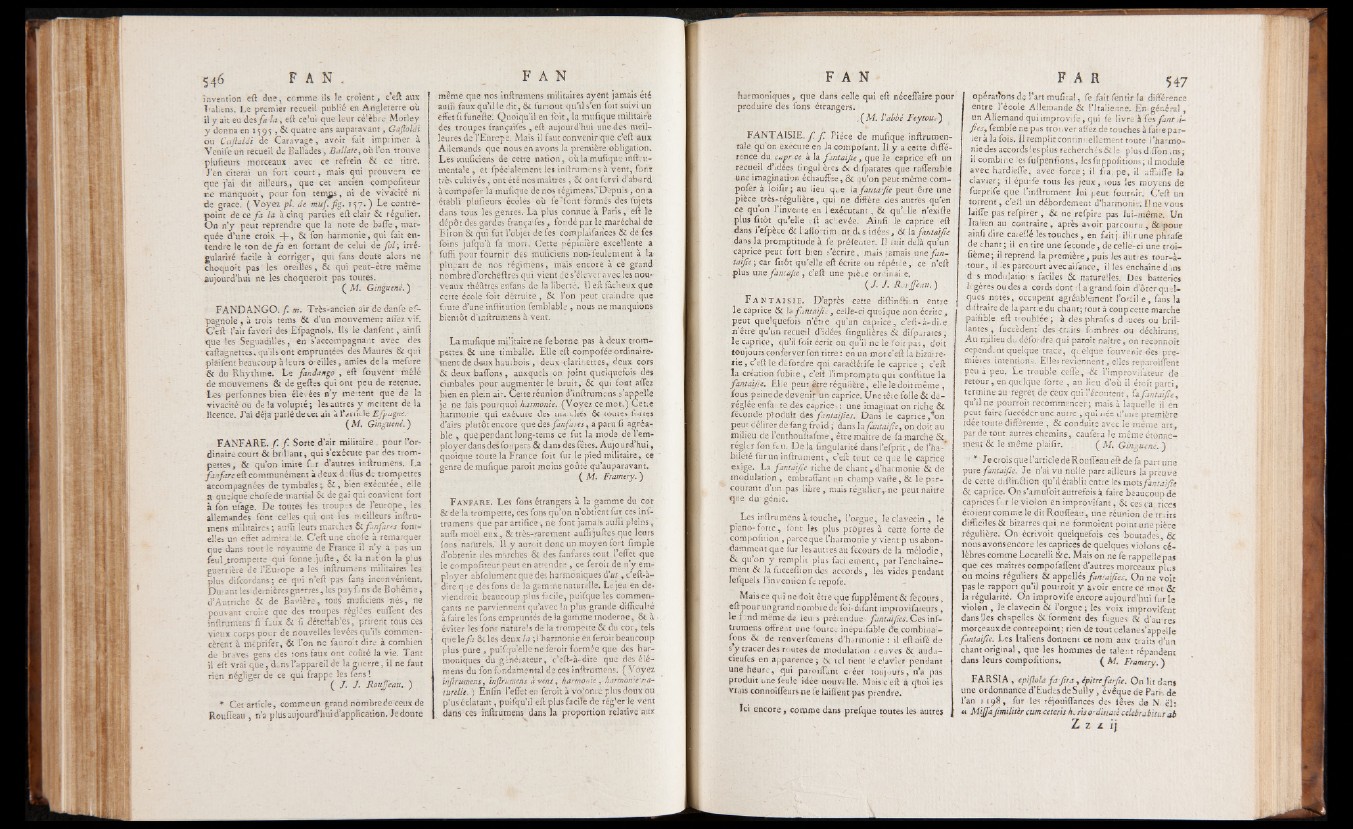
546 F A N ,
invention eft du e, comme ils le croient, c’eft aux
Italiens. L e premier recueil publié en Angleterre où
il y ait eu des fa-la, eft celui que leur célèbre Morley
y donna en 1595 , & quatre ans auparavant , Gafloldi
ou Cafialdi de C a ra v a g e , avoir fait imprimer, à
V e n t e un recueil de Ballades, Ballate, où i’on trouve
plufieurs morceaux avec ce refrein & ce titre.
J’en citerai un fort co u r t , mais qui prouvera ce
que j’ai dit ailleurs,., que cet ancien çompofiteur
ne manquoit, pour fon temj^s, ni de vivacité ni
de grâce. (V o y e z pl. de muf. fig. 1 5 7 . ) L e contrepoint
de ce fa la a cinq parties eft clair & régulier.
O n n’y peut reprendre que la note de b a ffe, marquée
d’une croix - f - , & fon harmonie, qui fait entendre
le ton de fa en fortant de celui de fol\ irrégularité
facile à corriger, qui fans doute alors ne
choquoit pas les oreilles, & qui peut-être même
aujourd’hui ne les choqueroit pas toutes.
( M. Ginguené. )
F A N D A N G O , f m. Très-ancien air de danfe e s pagnole
, à trois tems & d’un mouvement allez vif.
C ’eft l’air favori des Efpagnols. Ils le danfent, ain'fi
que les Seguadilles, en s’accompagnant avec des
eaftagnettes, qu'ils ont empruntées des Maures & qui
pîâifent beaucoup à leurs o-eilles, amies d e là mefure
& du Rhythme. L e fandango , eft fou v en r mêlé
de mouvemens & de geftes qui ont peu de retenue.
Les perfonnes bien élevées n’y mettent que de la
vivacité ou de la volupté ; les autres y mettent de la
licence. J’ai déjà parlé de cet air à l’article Efpagne.
(M. Ginguené.')
F A N F A R E , f . f Sorte d’air militaire . pour l’ordinaire
court & brillant, qui s’exécute par des trompettes,
& qu’on imite fur d’autres ir.ftrumens. La
fanfare eft communément à deux d tffus de trompettes
accompagnées de tymbales \ & , bien exécutée, elle
S quelque chofe de martial & de gai qui convient fort
à fon ulage. D e toutes les troupes de l’europe, les
allemandes font celles qui ont les meilleurs inftru-
mens militaires ; auftï leurs marches & fanfares font-
elles un effet admirable. C ’eft une chofe à «marquer
que dans tout le royaume de France il n’y a pas un
feul^trompette qui fonne .jufte , & la nat on la plus
guerrière de l’Europe a les inftrumens militaires les
plus difeordans ; ce qui n’eft pas fans inconvénient,
b u tan t les dernières guerres, les payfans de Bohême,
d’Autriche & de B a v iè re , tous muficiens n é s , ne
pouvant croiie que des troupes réglées'euffent des
inftrumens fi faux & fi déteftab’ es , prirent tous ces
vieux corps pour de nouvelles levées qu’ils Commencèrent
à méprifer, & l’on ne fauro't dire à combien
de braves gens des tons faux ont coûté la vie. Tant
il eft vrai q u e , dans l’appareil de la gue rre, il ne faut
rien négliger de ce qui frappe les fens!
( J. J. Rôujfcau. )
* Cet article, commeun grand nombre de ceux de
Rouffeau , n’a plus aujourd’hui d’application. Je doute
F A N
meme que nos inftrumens militaires ayent jamais été
auift faux qu’il le d it, ôc furtout qu’il s’en foit suivi un
effet fi funefte: Quoiqu’il en fo it, la mufique militaire
des troupes françaifes , eft aujourd’hui une des meilleures
de l’Europe. Mais il faut convenir que c’eft aux
Allemands que nous en avons la première obligation.
L e s muficiens de cette nation, où la mufique inftru-
mentale , et fpéc'alement les inftrumens à v ent, font
très cu ltivés, ont été nos maîtres , & ont fervi d’abord
à compofer la mufique de nos tégimèns.'Depuis, on a
établi plufieurs écoles où feT on t formés des fujets
dans tous les genres. La plus connue à Paris, eft le
dépôt des gardes f r a n ç a i s , fondé par le maréchal de
Eiron & qui fut l’objet de fes complailances &. de fes
foins jufqu’à fa mort. Cette pépinière excellente a
fuffi pour fournir des muficiens non-feulement à la
plupart de nos régi mens, mais encore à ce grand
nombre d’orcheftres qui vient de s’élever avec les nouveaux
théâtres enfans de la liberté. 11 eft fâcheux que
cette école foit détruite , & l’on peut craindre que
faute d’une inftitution femblable , nous ne manquions
bientôt d'mftrumens à vent.
La mufique militaire ne fe borne pas à deux trompettes.
& une tîmballe. Elle eft compofée ordinairement
de deux hau.bois , deux clarinettes, deux cors
& deux baffons, auxquels on joint quelquefois des
cimbales pour augmenter le bruit , & qui font affez
bien en plein air. Cette réunion d’inftrumens s’appelle
je ne fais pourquoi harmonie. (V o y e z ce mot.) Cette
harmonie qui exécute des marchés & toutes fortes
d’airs plutôt encore que desfanfares t a paru fi agréable
, que pendant long-tems ce fut la mode de l’employer
dans des foupers & dans des fêtes. Aujourd’hui,
quoique toute la France foit fur le pied militaire, ce
genre de mufique paroît moins goûté qu’auparavant.
( Ai. Framery. )
F anfare. Les fons étrangers à la gamme du cor
& de la trompette, ces fons qu’on n’obtient fur ces inftrumens
que par a rtifice, ne font jamais aufîï pleins,
aufhmoël eu x , & très-rarement auffi'juftes que leurs
fons naturels. 11 y auroit donc un moyen fort fimple
d’obtenir des marches & des fanfares tout , l’effet que
le çompofiteur peut en attendre , ce feroit de n’y employer
abfolument que des harmoniques d'u t, c’eft-à-
dire que des fons de la gamine naturelle. Le jeu en de-
viendroit beau coup pi us facile, puifque les commençants
ne parviennent qu’avec la plus grande difficulté
à faire les fons empruntés de la gamme moderne, & à
-éviter les fons naturels de la trompette & du cor, tels
que lefa & lès deux la ; l'harmonie en feroit beaucoup
plus pure , puifqifelle ne feroit formée que des harmoniques
du générateur, c’eft-à-dïrè que des éié-
mens du fon fondamental de ces inftrumens. (V o y e z
in f rumens, inflrumens àvént, harmonie, harmonie’naturelle.
) Enfin l’effet en leroit à volonté plus doux ou
p’us éclatant, pnifqu’il eft plus facile de rég’er le vent
dans ces inftrumens dans la proportion relative aux
F A N
harmoniques, que dans celle qui eft néceffaire pour
produire des fons étrangers.
.{M. L'abbé Feytou
F AN T A IS IE , y? f . Pièce de mufique inftrumen-
tale qu'on exécute en ia compofant. Il y a cette différence
du çapr ee à la fantaifie, que le caprice eft un
recueil d’ idées fingul ères & difparates que raffemble
une imagination échauffée, & qu’on peut même compofer
à loifir ; au iieu qee la fantafie peut êire une
pièce très-régulière, qui ne diffère des autres qu'en
ce qu’on l’invente en 1 exécutant, & q u e lle n'exifte
plus fitôt qu’elle eft achevée. A in fi je caprice eft
dans l’efpèce & laffortim.nr d<s id ées , & la fantaifie
dans la promptitude à fe préfeuter. Il luit delà qu’un
caprice peut fort bien ‘ ’écrire, mais jamais une fantaifie
\ car fitôt q u ’elle eft écrite ou répétée, ce n’eft
plus une faniafie, c’eft une pië-e or<iinai.e.
( J. J. Rji Jfeau. )
Fantaisie. D ’après cette diftinfticn entre
le caprice & la fantaifie, ceile-ci quoique non écrite,
peut quelquefois n’être q u ’un caprice, c’efl>à-di.e
n’être qu’un recueil d ’idées fîngulières & difparates ;
le caprice, qu’il foit écrit ou qu’il ne le foit pas, doit
toujours conferver fon titre : en un mot c’eft la bizarrerie
, c’eft le défordre qui caraétérife le caprice ; c’eft
la création fubiie , c’eft l’impromptu qui conftiiue la
fantaifie. Elle peut ^re régulière, elle le doit même ,
fous peine de devenir-un caprice. Une tête folle & déréglée
enfante des caprice-, : une imaginât on riche &
féconde produit des fantaifies. Dans le caprice ,^on
peur delirer de fang froid ; dans la fantaifie, on doit au
milieu de l’enthoufiafme, être.maître de fa marche &
régler fon feu. D e la fingularité dansl’efprit, de l’habileté
fur ün infiniment, c’eft tout ce que le caprice
exige. La fantaifie riche de Chant, d’harmonie & de
modulation , embraffant un champ vafte, & le parcourant
d’un pas lib re, mais régulier,, ne peut naître
que du génie.
< Les inftrumens à touche, l’orgue, le clavecin , lé
piano-forte, font les plus propres à cette forte de
compofnion , parce que l’harmonie y vient p us abondamment
que fur les autres au fecours de la mélodie,
& qu’on y remplit plus facilement, par l’enchaîne-
mènt & la fucceflion dès ac coid s, les vides pendant
lefquels l’invention fe repofe.
Mais ce qui ne doit être que fiipplément & fecours,
eft pour un grand nombiede foi-difant improvifateurs,
le f:n d même de leurs prétendue^ fantaifies. C es inftrumens
offrent une fource inépmfable de combinal-
fons & de renverfemens d’harmonie : il efta ifé de
s y tracer des routes de modulation r euves & auda-
cieufes en apparence ; & tel tient le clavier pendant
une heure, qui paroiffunt créer toujours, n’a pas
produit une feule idée nouvelle. MaisV eft à qùoi les
Vrais connoiffeurs ne fe laifient pas prendre.
Ici encore, comme dans prefque toutes les autres
F A R 547
f opérations de l’art mufical, fe fait fentir la différence
entre l’école Allemande & l’Italienne. En g én é ral,
un Allemand qui irnprovife, qui fe livre à fes fantâ-
fies9 femble ne pas trouver affez de touches à faire parlera
la fois. Il remplit contint ellement toute l ’harmonie
des accords les plus recherchés & le plus dlffon .ns ;
il combine les fufpenfions^ lesfuppofitions; il module
a v e c hardieffe, avec fo rc e ; il f ra .p e , il affaiffe b
clavier; il épuife tous les je u x , vous les moyens de
furprife que l’inftrument lui peut fournir. C ’eft un
torrent, c’eft un débordement d’harmonie. Il ne vous
laiffe pas refpirer , & ne refpire pas lui-même. Un
Italien au contraire, après avoir parcouru , &-pour
ainfi dire caieffé les touches , en fait j- illir une phrafe
de chant ; il en tire une fécondé, de celle-ci une troi-
fième; il reprend la première, puis les autres tour-à-
tou r, il les parcourt avecaifance, il les enchaîne d ms
d s modulatioi s faciles & naturelles. Des batteries
légères ou des a cords dont il a grand foin d orer quelques
notes, occupent agréablement l’o r d l e , fans la
. diftraire de la partie du chant; tout à coup cette marche
I paifibie eft troublée ; à des phraft s d >uces ou brillantes,
fuccèdent' des -traits fc mbres ou déchirans.
A u njilieu du défordre qui paroît naître, on reconnoît
cependa nt quelque trace, quelque fouvenir des premières
intentions. Elle*reviennent, elles reparoiffent
. peu à peu. L e trouble ceffe, & l’improvifateur de
retour, en quelque forte , au lieu d'où il éroit parti,
termine au regret de ceux qui l’écoutent, fa fantaifie,
qu’il ne pourroit recommencer; mais à laquelle il en
peut faire fuccéder une autre, qui née d’une première
idée toute différente , & conduite avec le même art,
par de tout autres chemins, caufera le même étonnement
& le même plaifir. (-M. Ginguené.)
1 * Je crois que l’article de Rouffeau eft de fa part une
purt fantaifie. Je n’ai vu nulle.part ailleurs la preuve
de cette diftinélion qu’il établit entre (es mots fantaifie
& caprice. On s’amufoit autrefois à faire beaucoup de
caprices fur le v iolon en improvifant, & ces ca:rices
étoienteomme le dit R ouffeau, une réunion de tr .its
difficiles & bizarres qui ne formoient point une pièce
régulière. O n écrivoit quelquefois ces boutades, &
nous avons encore les caprices de quelques violons célèbres
comme Locatelli & c. Mais on ne fe rappelle pas
que ces maîtres compofaffent-d’autres morceaux plus
ou moins réguliers & appellés fantaifies. On ne voit
pas le rapport qu’il pouiroit y avoir entre ce mot &
la régularité. On irnprovife encore aujourd’hui fur le
violon , le clavecin & l’orgue ; les voix improvifent
dans «les chapelles & forment des fugues & d’au-res
morceauxde contrepoint; rien de toutcelanes’appelle
fantaifie. Les Italiens donnent ce nom aux traits d’un
chant original, que les hommes de talent répandent
dans leurs compofitions. ( M. Framery. )
F A R S IA , epiflola fa fit a , épitrefarfie. On lit dans
une ordonnance d’Eudes de S u lly , évêque de Paris de
j l’an 1198, fur les réjouiffances des fêtes de N< ël:
I « Mïjfafimilitèram ceterish.riso'dinatècelebrabïturab
Z Z L ij