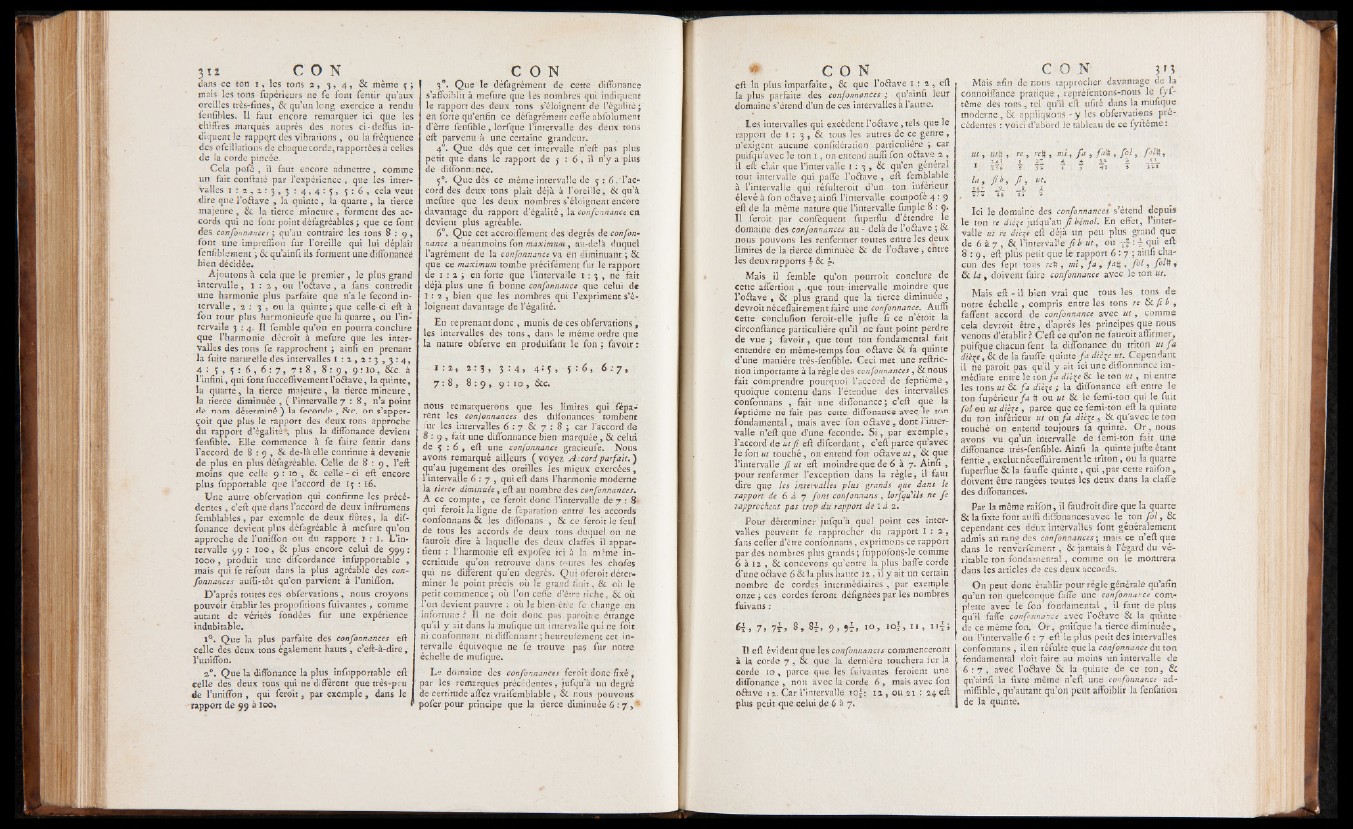
312 C O N
dans ce ton i , les tons 2 , 3 , 4 , & même 5 ;
mais les tons fupérieurs ne fe font fentir qu’aux
oreilles très-fines, & qu’un long exercice a rendu
fenfibles. Il faut encore remarquer ici que les
chiffres marqués auprès des notes ci-deflùs indiquent
le rapport des vibrations , ou la fréquence
des ofcillations de chaque corde, rapportées à celles
de la corde pincée.
Cela pofé , il faut encore admettre, comme
un fait conftaté par l’expérience , que les intervalles
1 : 2 5 2 : 3 , 3 : 4 , 4 : 5 , 5 : 6 , cela veut
dire que l ’oâave , la quinte, la quarte, la tierce
majeure, & la tierce mineure, forment des accords
qui ne font point défagréables ; que ce font
des conformances ; qu’au contraire les tons 8 : 9 ,
font une impreflion fur l’oreille qui lui déplaît
fenfiblement ; & qu’ainfi ils forinent une diflonancé
bien décidée.
Ajoutons à cela que le premier , le plus grand
intervalle, 1 : 2 , ou l’oâave , a fans contredit
une harmonie plus parfaite que n’a le fécond intervalle
, 2 : 3 , ou la quinte; que celle-ci eft à
fon tour plus harmonieufe que la quarte, ou l’intervalle
3 : 4. Il femble qu’on en pourra conclure
que l’harmonie décroît à mefure que les intervalles
des tons fe rapprochent ; ainfi en prenant
la fuite naturelle des intervalles 1 : 2 , 2 : 3 5 3 : 4 ,
4 : 5, 5: 6 , 6 : 7 , 7 : 8 , 8 : 9 , 9 : 1 0 , &c. à
l ’infini, qui font fucceflivement l’o â a v e , la quinte,
la quarte, la tierce majeure, la tierce mineure,
la tierce diminuée , ( l’intervalle 7 : 8 , n’a point
de nom déterminé ) la fécondé , &c. on s’apper-
çoit que plus le rapport des deux tons approche
du rapport d’égalité*, plus la diflonancé devient
fenfible. Elle commence à fe faire fentir dans !
l’accord de 8 : 9 , 8c de-là elle continue à devenir i
de plus en plus défagréable. Celle de 8 : 9 , l’eft ;
moins que celle 9 : 10 , & celle - ci eft encore j
plus fupportable que l’accord de 15 : 16.
Une autre observation qui confirme les précé- 1
dentes , c’eft que dans l’accord de deux inftrumens
femblables, par exemple de deux flûtes, la dif-
fonance devient plus défagréable à mefure qu’on
approche de Tuniflon ou du rapport 1 : 1. L’intervalle
99 : 100, & plus encore celui de 999 :
1000, produit une difcordance infupportable ,
mais qui fe réfout dans la plus agréable des con-
fonnances aufli-tôt qu’on parvient à l’uniflbn.
D ’après toutes ces obfervations , nous croyons
pouvoir établir les propofitions fuivantes , comme
autant de vérités fondées fur une expérience
indubitable.
iQ. Que la plus parfaite des confonnances eft
celle des deux tons également hauts , c’eft-à-dire,
l ’uniflon.
20. Que la diflonancé la plus infupportable eft
celle des deux tons qui ne different que très-peu
de l’uniflon , qui feroit, par exemple, dans le
rapport de 99 à 200« 1
C O N
30. Que le défagrément de cette diflonancé
s’affoiblit à mefure que les nombres qui indiquent
le rapport des deux tons s’éloignent de l’égalité ;
en forte qu’enfin ce défagrément cefle absolument
d’être fenfible, lorfque l’intervalle des deux tons
eft parvenu à une certaine grandeur.
4°. Que dès que cet intervalle n’eft pas plus
petit que dans le rapport de 5 : 6 , il n’ÿ a 'plus
de diflbnmnce.
50. Que dès ce même intervalle de 5 : 6, l’accord
des deux tons plaît déjà à l’oreille , & qu’à
mefure que les deux nombres s’éloignent encore
davantage du rapport d’égalité , la confonnance en
devient plus agréable.
6°. Que cet accroiflement des degrés de confond
nance a néanmoins fon maximum , au-delà duquel
l’agrément de la confonnance va en diminuant ; &
que ce maximum tombe précifément fur le rapport
de 1 : 2 ; en forte que l’intervalle 1 : 3 , ne fait
déjà plus une fi bonne confonnance que celui de
1 1 2 , bien que les nombres qui l’expriment s’éloignent
davantage de l’égalité.
En reprenant donc , munis de ces obfervations ,
les intervalles des tons , dans le même ordre que
la nature obferve en produifant le fon ; fa voir :
1 : 2 , 2 : 3 , 3 : 4 , 4 : 5 , 5 : 6 , 6 : 7 ,
7 : 8 , 8 : 9 , 9 : 1 0 , &c.
nous remarquerons que les limites qui féparent
les confonnances des diflonances tombent
îur les intervalles 6 : 7 & 7 : 8 ; car l’accord de
8 : 9 , fait une diflonnance bien marquée, & celui
de 5 : 6 , eft une confonnance gracieufe. Nous
avons remarqué ailleurs ( voyez Accord parfait. )
qu’au jugement des oreilles les miçux exercées ,
l’intervalle 6 : 7 , qui eft dans l’harmonie moderne
la tierce diminuée, eft au nombre des confonnances.
A ce compte, ce feroit donc l’intervalle de 7 : 8i|
qui feroit îa ligne de féparation entré les accords
confonnans & les difionans , & ce feroit le feul
de tous les accords de deux tons duquel on ne
fauroit dire à laquelle des deux clafles il appartient
: l’harmonie eft expofée ici à la même incertitude
qu’on retrouve dans toutes les chofes
qui ne different qu’en degrés. Qui oferoit déterminer
le point précis où le grand finit, & où le
petit commence ; où l’on cefle d’être riche, & où
l’on devient pauvre : où le bien-être fe change en
infortuné ? Il ne doit donc pas paroître étrange
qu’il y ait dans la mufique un intervalle qui ne foit
ni confonnant ni diflennanr ; heureufement cet intervalle
équivoque ne fe trouve pas fur notre
échelle de mufique.
Le domaine des confonnances feroit donc fixé ,
par les remarques précédentes, jufqu’à un degré
de certitude afl'ez vraifemblable, & nous pouvons
pofer pour principe que la tierce diminuée 6. : 7 , ^
c o N
eft la plus imparfaite, 8c que l’oâave 1 : 2 , eft
la plus parfaite des confonnances ; qu’ainfi leur
domaine s’étend d’un de ces intervalles à l’autre.
Les intervalles qui excèdent l’oâave ,tels que le
rapport de 1 : 3 , & tous les autres de ce genre,
11’exigent aucune confidération particulière ;, car
puifqu’avec le ton 1 , on entend aufli fon oâave 2 ,
il eft clair que l’intervalle 1 : 3 , & qu’en général
tout intervalle qui pafîe l’oâave , eft femblable
à l’intervalle qui réfulteroit d’un ton inférieur
élevé à fon oâ av e; ainfi l’intervalle compofé 4 : 9
eft de la même nature que l’intervalle fimple 8 : 9.
Il feroit par conféqùent fuperflu d’étendre le
domaine des confonnances au - delà de l’oâave ; 8c
nous pouvons les renfermer toutes entre les deux
limites de la tierce diminuée 8c de l’o â a v e , entre
les deux rapports j 8c £.
Mais il femble qu’on pourroit conclure de
cette aflertion , .que tout-intervalle moindre que
l ’oâave , & plus grand que la tierce diminuée ,
devroit néceflairement faire une confonnance. Aufli
cette conclufion feroit-elle jufte fi ce n’étoit la
circonftance particulière qu’il ne faut point perdre
de vue ; favoir, que tout ton fondamental fait
entendre en même-temps fon oâave 8c fa quinte
d’une manière très-fennble. Ceci met une reftric-
tion importante à la règle des confonnances , 8c nous
fait comprendre pourquoi l’accord de feptième ,
quoique contenu dans l’étendue des intervalles
confonnans , fait Une diflonancé ; c’eft que la
feptième ne fait pas cette diflonancé avec le ton
fondamental, mais avec fon o â a v e , dont l'intervalle
n’eft que d’une fécondé. S i , par exemple,
l’accord de ut f i eft difeordant, c’eft parce qu’avec
le fon ut touché, on entend fon oâave u t, 8c que
l’intervalle f i ut eft moindre que de 6 à 7. Ainfi ,
pour renfermer l’exception dans la règle, il faut
dire que les intervalles plus grands que dans le
rapport de 6 à y font confonnans , lorfquils ne fe
rapprochent pas trop du rapport d e là 2. .
Pour déterminer jufqu’à quel point ces intervalles
peuvent fe rapprocher du rapport 1 : 2 ,
fans cefler d’être confonnans, exprimons ce rapport
par des nombres plus grands; fuppofons-le comme
6 à 12 , & concevons qu’entre la plus bafle corde
d’une oâave 6 &1a plus haute i a , il y ait un certain
nombre de cordes intermédiaires ,/par exemple
onze ; ces cordes feront défignéês par les nombres
fuivans :
H y 7» 8 , S£, 9 , 1 0 , io£ , 1 1 , n | ;
Il eft évident que les confonnancts commenceront
à la corde 7 , ot que la dernière touchera fur la
corde 10, parce que les fuivantes feroient une
diflonancé , non avec la corde 6 , mais avec fon
oâave 12.Car l’intervalle io | : 12 , ou 21 : 24 eft
plus petit que celui de 6 à 7.
C O N 313
Mais afin de nous rapprocher davantage de la
connoiflance pratique, repréfentons-nous le fyf-
tême des tons, tel qu’il eft ufité dans la mufique
moderne , 8c appliquons - y les obfervations précédentes
: voici d’abord le tableau de ce fyftême :
u t , ut# , re , re# , mi, fa , fa# , f o l , fol# ,
1 '• ,%Tï J J v T T 4S T ï ï ï
la , f i b, f i , ut.
I<T 9_ S. i
Î 7Ô 16 1» *
Ici le domaine des confonnances s’étend depuis
le ton re dièçe jufqu’au f i bçrnol. En effet, l’intervalle
ut re dièçe eft déjà un peu plus grand que
de 6 à 7 , & l’intervalle f i b ut, ou ~ qui eft
8 : 9 , eft plus petit que le rapport 6 : 7 ; ainfi chacun
des fept tons re# , mi, f a , fa# , f o l , fol# ,
& la , doivent faire confonnance avec le ton ut.
Mais eft - il bien vrai que tous les tons de
notre échelle , compris entre les tons re 8c fi b ,
faflent accord de confànnance avec u t , comme
cela devroit être, d’après les principes que nous
venons d’établir ? C ’eft ce qu’on ne fauroit affirmer,
puifque chacun fent la diflonancé du triton ut fa
dièçe,8c de la fauffe quinte fa diè^e ut. Cependant
il ne paroît pas qu’il y ait ici une diflonnance immédiate
entre le ton fa dic^e 8c le ton u t , ni entre
les tons ut 8c fa die\e ; la diflonancé eft entre le
ton fupérieur fa ou ut 8c le femi-ton qui le fuit
fo l où ut die\e , parce que ce femi-ton eft la quinte
du ton inférieur Ki ou fa dieçe 9 & qu’avec le ton
touché on entend toujours fa quinte. O r , nous
avons vu qu’un intervalle de femi-ton fait une
diflonancé très-fenfible. Ainfi la quinte jufte étant
fentie , exclut néceflairement le triton, ou la quarte
fuperflue & la faufle quinte, qui ,par cette raifon,
doivent être rangées toutes les deux dans la clafle
des diflonances.
Par la même raifon, il faudroitdire que la quarte
& lafixte font aufli diflonances avec le ton f o l , &
cependant ces de'ux intervalles font généralement
admis au rang des confonnances ; mais ce n’eft que
dans le renverfement, & jamais à l’égard du véritable
ton fondamental, comme on le montrera
dans les articles de ces deux accords.
On peut donc établir pour règle générale qu’afin
qu’ un ton quelconque fafle une confonnance complexe
avec le fon fondamental , il faut de plus
qu’il fafle confonnance avec l’oâave & la quinte
de ce même fon. O r , puifque îa tierce diminuée,
ou l’intervalle 6 : 7 eft le plus petit des intervalles
confonnans , il en réfulte que la confonnance du ton
fondamental doit faire au moins un intervalle de
6 : 7 , avec l’oâave & la quinte de ce ton, &
qu’ainfi la fixte même n’eft une confonnance ad -
miflible, qu’autant qu’on peut affoiblir la fenfation
de la quinte.