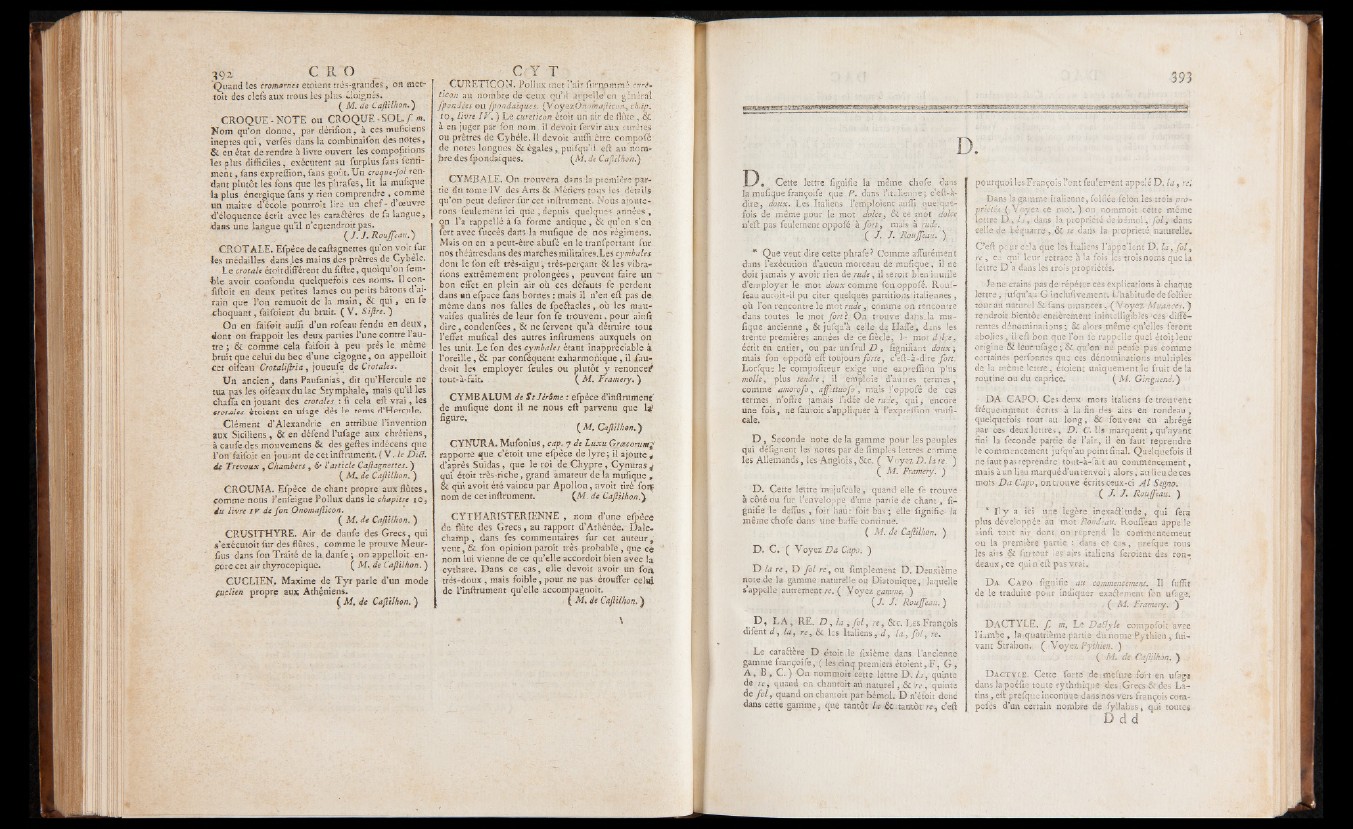
Î92 C R O
Quand les cramâmes etoient très-grandes, on met-
•foit des clefs aux trous les plus éloignés.
( M. de Caflilhon.)
C R O Q U E -N O T E ou C RO Q U E -SOL. f m.
Nom qu’on donne, par dérifion, à çes muficiens
ineptes qui, verfés dans la combi.naifon des notes,
& en état de rendre à livre ouvert lès comportions
les plus difficiles , exécutent au furplus fans fenti-
ment, fans exprefîion, fans goût. Un croque-fol rendant
plutôt les fons que les phrafes, lit la mufique
la plus énergique fans y rien comprendre , comme
un maître d’école pourront lire un chef- d’oeuvre
tl’éloquence écrit avec les cara&ères de fa langue,
dans une langue qu’il n’eqtendroit pas.
( J . J . R a t i fia i t . )
C RO TA LE . Efpèce de caftagnettes quon voir fur
les médailles dans .les mains des prêtres de Cybèle.
Le crotale étoit différent du fiftre, quoiqu’on fem-
ble avoir confondu quelquefois ces noms. Il con-
fiftoit en deux petites lames ou petits bâtons d airain
que l’on remuoit de la main, èç. q u i, en f@
-çhoquant, faifoient du bruit. ( V . Siftre. )
C'a en faifoit auffi d’un rofeau fendu en deux,
dont on frappoit les deux parties l’une contre l’autre
; & comme cela faifoit à peu près le même
bruit que celui du bec d’une cigogne, on appelloit
cet oifeau Crotaliflria, joueufe de Crotales.
Un ancien , dans Paufanias, dit qu’Hercule ne
tua pas les oifeauxdu laç Stymphale, mais qu’il les
chaffa en jouant des crotales_ : fi cela eft v ra i, les
crotales ètoient en ufage dès le tems d’Hercule.
Clément d’Alexandrie en attribue l’invention
aux Siciliens , & en défend l’ufage aux chrétiens,
à caufe-des mouvemens & des geftes indécens que
l’on faifoit en jouant de cet infiniment. ( V. le D'iS.
de Trévoux , Chambers , 6* l* article Caflagnettes. )
( M. de Caflilhon. )
CROUMA. Efpèce de chant propre aux flûtes,
Comme nous l’enfeigne Pollux dans le chapitre io ,
du livre i v de fon Onomajlicon.
( M. de Caflilhon, )
CRUSITHYRE. Air de danfe des Grecs, qui
s ’exécutoit fur des flûtes, comme le prouve Meur-
fius dans fon Traité de la danfe ; on appelloit encore
cet air thyrocopique. ( M. de Caflilhon. )
CUCLIEN. Maxime de T y r parle d’un mode
cuplien propre aux Athéniens.
( M. de Caflilhon. |
C Y T
CURETICON. Pollux met l’air furpommé curé-
tic on au nombre de ceux qu’ il appelle en générai
fpondèes ou fpondaïques. (V oyQzOnornajVicon, chip.
10., livre IV. ) Le cureticon étoit un air de flûte , 8C
à en juger par fon nom il devoit fervir aux curète.s
ou prêtres de Cybèle. Il devoit auffi être compofé
de notes longues & égales, puifqu’il efi au nombre
des fpondaïqués. ^ (M. de Caflilhon.')
CYMBALE. On trouvera dans la première partie
du tome IV des Arts 8c Métiers tous les détails
qu’on peut defireriiir cet infiniment. Nous ajouterons
feulement ici que; depuis quelques années ,
on l’a rappelle à fa forme antique , 8c qu’on s’en
fort avec fuccès dans la mufique de nos régimens.
Mais on en a peut-être abufé en le tranfportant fur
nos théâtresdans des marches militaires. Les cymbales
dont le fon eft très-aigu', très-perçant 8c les vibrations
extrêmement prolongées, peuvent faire un
bon effet en plein air où ces défauts fe perdent
dans un efpace fans bornes : mais il n’en efi pas de
même dans nos falles de fpeâacles, où les mau-
vaifes qualités de leur fon fo trouvent, pour ainfi
dire, condenfées, 8c ne fervent qu’à détruire tout
l’effet mufical des autres inftrumens auxquels on
les unit. L e fon des cymbales étant inappréciable k
l’oreille, 8c par .conféquent exharmonique, il iau-
droit les employer foules ou plutôt y renonce»*
tout-à-fait, ( M. Framery. )
CYMB ALUM de S t Jérôme : efpèce d’ihflrument
de mufique dont il ne nous eft parvenu que 1<?
figure,
( M, Caflilhon. )
CYNURA. Mufonius, cap. y de Lüxu Gmcorunty
rapporte que c’étoit une efpèce de lyre ; il ajoute *
d’après Suidas, que le roi de Chypre , Cynuras ^
qui étoit très-riche, grand amateur delà mufique,
& qui avoit été vaincu par Apollon, avoit tiré foiï
nom de cet infiniment. (M. de Caflilhon.)
CYTHARISTERIENNE , nom d’une efpèce
de flûte des Grecs, au rapport d’Athénée. Dale-
champ, dans fos commentaires fur cet auteurL'
veut, & fon opinion par.oît très probable, que ce
| nom lui vienne de ce qu’elle accordoit bien avec la
cythare. Dans ce cas, elle devoit avoir un fon
très-doux, mais foible, pour ne pas- étouffer celui
de l’inftrument qu’eifo accompagnoit. ( M. de Caflilhon. )
D
D . Cette lettre fignifie la même chofe dans
la mufique françoife que P. flans l’itdienne; c’eft-à-
flire, doux. Les Italiens l’emploient auffi. quelquefois
de même pour le mot dçlce,, 8c ce mot doice
n’eft pas feulement oppofé à fort, mais a rude. ,
( J. J. Rouffeau. )
* Que veut dire cette phrafe? Comme affurément
dans l’exécution d’aucun morceau de mufique, il ne
doit jamais y avoir rien &Q rude, il seroit bien inutile
d’employer le mot doux comme fon oppofé. Rouffeau
auroit-il pu citer quelques partitions italiennes ,
où l’on rencontre le mot r u d e comme on rencontre
dans toutes le mot fort} On trouve dans.la mufique
ancienne , & jufqu’à celle te HafTe, dans les
trente premières années de ce fiècle, le mot d\lçe,
écrit en entier, ou par un feul Z) , lignifiant doux;
mais fon oppofé efi toujours forte 9 c’eft-à-dire fort.
Lorfque le compofitéiir exige une exprefîion plus
molle, plus tendre ; il emploie d’autres termes,
comme atnorqfo, afftt'tuofo’, mais l’oDpofé de ces
termes n’offre jamais l’idée de rude, qui, encôre
une fois, ne fautoit s’appliquer à l’expreffion müfi-
cale.
D , Seconde noté de la gamme pour les peuples
qui défignent les notes par de fimples lettres comme
les Allemands, les Anglois, 8cc. ( Vo yezD.lare. )
( M . F r a m é y . )
D. Çette lettre majufcùlè, quand elle fe trouvé
à côté ou fur l’enveloppe d’une partie de chant, fignifie
le deffus , foit haut fôit bas ; elle fignifie- la
même chofe dans une baffe continue.
( M. de Caflilhon. )
D. C . ( Voyez Da Càpo. )
D la re , D fol re\ ou fimplemént D. Deuxième
note.de la gamme naturelle ou Diatonique, laquelle
s’appelle autrement « . ( Voyez gamme, )
( J. J. Rouffeau. )
D , L A , RE. D , la t fo l y re, &c. Les François
difent d , U , re, & les Italiens,.</, 'la , fo l, re.
Le càraélere D étoit le fixième dans l’anclennè
gamme françoife, ( les cinq premiers étoient, F , G ,
A , B , C. ) On nommoit'cette lettre D. l.z,;quitte
de re., quand on chantoit au naturel, 8c 're , quinte
de f o l , quand on chantoit par bémol. D n’étoit donc
dans cette gamme, que tantôt la> 8t.tantôt re, cefi
pourquoi les François l’ont feulement appelé D. la , re'.
Dans la gamme il aiienne, fol Béé félon les trois propriétés
f\^y;ez ce mor. ) on aommoit cette même
lettre D , l.i , dans la propriété* de bémol, fol-, dans
celle de béquarre, 8c re dans la propriété naturelle.
C ’efi pour cela que les Italiens l’âppe'Ie-nt D. la. fo l,
re , ce qui leur retrace à la fois les trois noms que la
lettre D a dans les trois propriétés!
Je ne crains pas de répéter ces explications à chaque
lettre, jufquaa G inclufivement. L’habitude de folfier
tour âu naturèl 8c fans muances , (N o y e i Muances. )
rendroit bientôr entièrement inintelligibles - ces différentes
dénominations ; & alors .même -qu’elles feront
abolies, il efi bon que l’on fe rappelle quel étoitleur
origine 8c leur ufage ; 8c qu’on ne penfo pas comme
certaines personnes que ces dénominations multiples
de la même lettre, étoient uniquement.le fruit delà
routine ou du caprice. ( M. Ginguené. )
DA CAPO. Ces deux mots italiens fe trouvent
fréquemment écrits à la fin des airs en rondeau,
quelquefois tout. au long,. 8c foüvent en abrégé
par ces deux lettres , D. C. Ils marquent, qii’àyant
fini la fécondé partie de l’air-, il én faut reprendre
le commencement jufqu’au point final. Quelquefois il
ne faut pas reprendre tout-à-fait au commencement,
mais à un lieu marqué d’un renvoi ; alors, au lieu de ces
mots Da Capo, on trouve écrits ceux-ci A l Segno.
( J. J, Rouffeau. )
* Il y a ici pce légère inexa&itude, qui fora
plus développée au mot Rondeau. Rouffeau appelle
ainfi tout air dont, on reprend lë commencemeut
ou la première partie : dans cç cas, prefque tous
les airs & furtout les airs italiens feroient des ron-,
deatix, ce qui n’eft pas y rai, , . /
Da C apo fignifie au commencement. Il fuffit
de le traduire pour indiquer exaéiement fon ufage.
- ( M. Frameiy. )
DA C TY LE , f . m, Le DaElyle compofoit avec
flambe , la quatrième partie du nome Pythien, fui-
vant Strabon, ( Voyez Pythien. )
( M . de Caflilhon. )
D ac tyle. Cette forte de mèfùrè fort en ufage
dans lapoéfie toute rythmique des :Grecs 8c des Latins
, eft prefque inconnue dans nos vers françois com-
pofés d’un certain nombre dé fyllabes, qui toutes