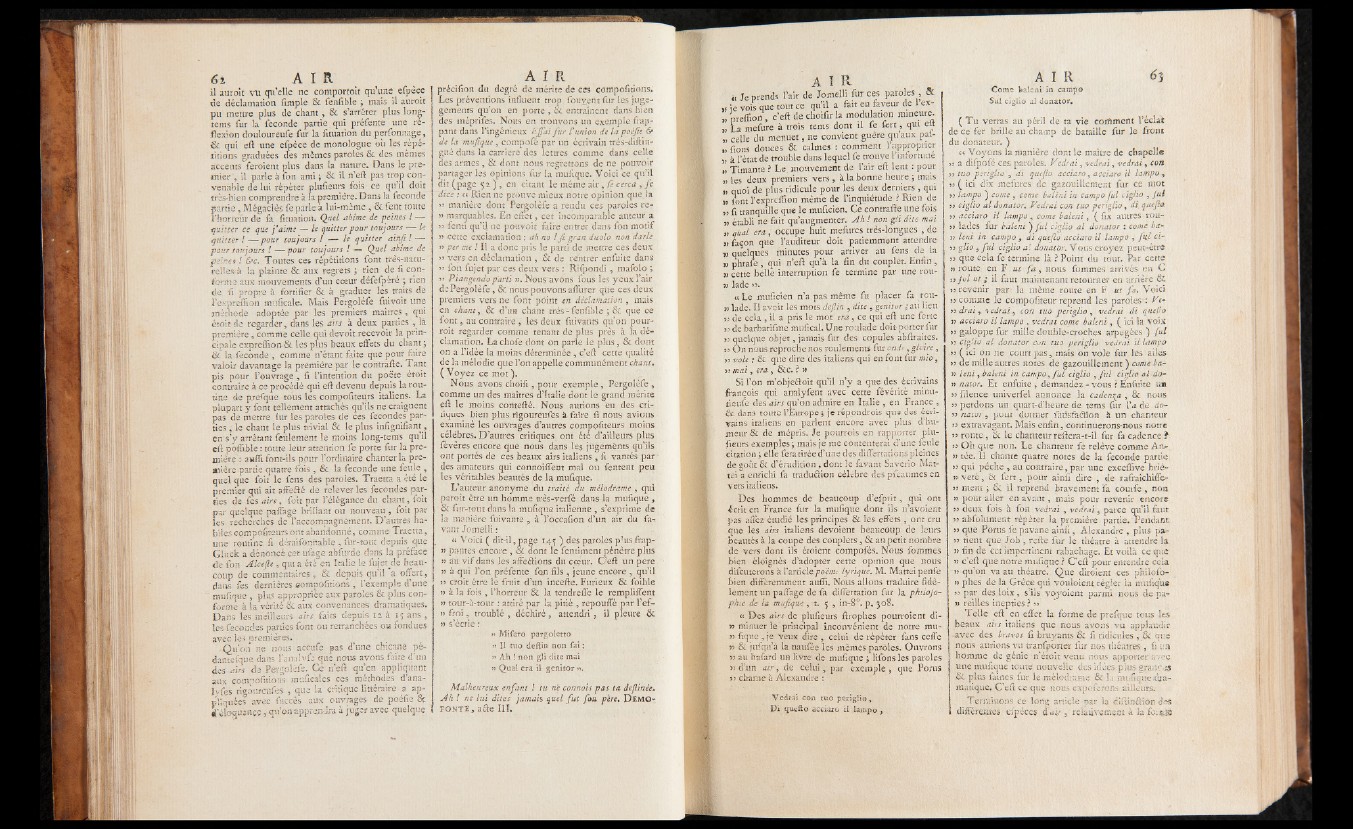
6 i A I R
il auroît vu qu’elle ne comportait qu’une efpèce
de déclamation {impie & fenfible ; mais il auroit
pu mettre plus de chant, & s’arrêter plus long-
tems fur la fécondé partie qui préfente une réflexion
douloureufe fur la fituation du perfonnage,
& qui eft une efpèce de monologue où les répétitions
graduées des mêmes paroles & des mêmes
accents feroient plus dans la nature. Dans le premier
, il parle à fou ami ; & il n’eft pas trop convenable
de lui répéter plufieurs fois ce qu’il doit
très-bien comprendre à la première. Dans la fécondé
partie, Mégaclès fe parle à lui-même, & fent toute
l ’horreur de fa fituation. Quel abîme de peines ! —
■ quitter ce que j'aime — le quitter pour toujours • le
quitter ! — pour toujours ! — le quitter a in fil—
pour toujours ! — pour toujours ! — Quel abîme de
peines ! &c. Toutes ces répétitions font très-naturelles
à la plainte & aux regrets ; rien de fi conforme
aux mouvements d’un coeur défefpéré ; rien
de fi propre à fortifier & à graduer les traits de
l ’expreflion muficale. Mais Pergolèfe fuivoit une
méthode adoptée par les premiers maîtres , qui
étoit de regarder, dans les airs à deux parties , là
première, comme celle qui devoit recevoir la principale
expre{fion-& les plus beaux effets du chant;
oc la fécondé , comme n’étant faite que pour faire
valoir davantage la première par le contrafte. Tant
pis pour l’ouvrage , fi l’intention du poète était
contraire à ce procédé qui efi devenu depuis la routine
de prefque tous les compofiteurs italiens. La
plupart y font tellement attachés qu’ils ne craignent
pas de mettre fur les paroles de ces fécondés parties
, le chant le plus trivial & le plus infignifiant,
en s’y arrêtant feùlement le moins long-tems qu’il
efi poflible : toute leur attention fe porte fur la première':
aufll font-ils pour l’ordinaire chanter la première
partie quatre fois , & la fécondé une feule ,
quel que foit le fens des paroles. Traetta a été le
premier qui ait affeâé de relever les fécondés parties
de fes airs, foit par l’élégance du chant, foit
par quelque pafiage brillant ou nouveau , foit par
les recherches de l’accompagnement. D ’autres habiles
compofiteurs ont abandonné, comme Traetta,
une routine fi déraiforjnable , fur-tout depuis que
Gluck a dénoncé cet ufage abfurde dans la préface
<le fon Alcefle , qui a été en Italie le fujet de beaucoup
de commentaires , & depuis qu’il ‘a offert,
dans fes dernières eompofitions , l’exemple d’une
mufiaue , plus appropriée aux paroles & plus conforme
à la vérité & aux convenances dramatiques.
Dans les meilleurs airs faits depuis 12 à 15 ans ,
les fécondés parties font ou retranchées ou fondues
avec'les premières.
Q u ’on ne nous accufe pas d’une chicane pe-
dantefque dans l’analvfe que nous avons faite d’un
des <drs de Pergolèfe. Ce n’eft qu’en appliquant
aux çomnofifions muficales ces méthodes d’ana-
lyfes rigoureilfes , que la critique littéraire a appliquées
avec fuccês aux ouvrages de poéfie 8c
d'éloqusnce, qu’on apprendra a juger avec quelque I
A I R
précifion du degré de mérite de ces çompofitions.
Les préventions influent trop fouyent fur les juge-
gements qu’on en porte , & entraînent dans bien
des mèprifes. Nous en trouvons un exemple frappant
dans l’ingénieux Effai fur tunion de la poéfie &
de la mufique , compofé par un écrivain très-difiin-
gué dans la carrière des lettres comme dans celle
des armes , 8c dont nous regrettons de ne pouvoir
partager les opinions fur la mufique. Voici ce qu’il
dit (page 52 ) , en citant le même air , Ce cerca , fe
dice : a Rien ne prouve mieux notre opinion que la
>3 manière dont Pergolèfe a rendu ces paroles re-
» marquables. En effet, cet incomparable auteur a
33 fenti qu’il ne pouvoif faire entrer dans fon motif
3> cette exclamation : ah no ! f i gran duolo non darle
v per me ! Il a donc pris le parti de mettre ces deux
33 vers en déclamation , .8c de rentrer enfuite dans
33 fon fujet par ces deux vers : Rifpondi , mafolo ;
J3 Piangendoparti ». Nous avôns fous les yeux l’air
de Pergolèfe, 8c nous pouvons affurer que ces deux
premiers vers ne font point en déclamation , mais
en chant, 8c d’un chant très - fenfible ; 8c que oe
fo n t, au contraire , les deux fuivants qu’on pour-
roit regarder comme tenant de plus près à la déclamation.
La chofe dont on parle le plus, 8c dont
on a l’idée la moins déterminée , c’eft cette qualité
de la mélodie que l’on appelle communément chant.
( V oyez ce mot ).
Nous avons choifi , pour exemple, Pergolèfe ,
comme un des maîtres d’Italie dont le grand mérite
efi le moins contefté. Nous aurions eu des critiques
bien plus rigoureufes à faire fi nous avions
examiné les ouvrages d’autres compofiteurs moins
célèbres. D ’autres critiques ont été d’ailleurs plus
févères encore que nous dans les jugements qu’ils
ont portés de ces beaux airs italiens , fi vantés par-
des amateurs qui connoiffent mal ou fentent peu
les véritables beautés de la mufique.
L’auteur anonyme du traité du mélodrame , qui
paroît être un homme très-verfé dans la mufique ,
8c fur-tout dans la mufique italienne , s’exprime de
la manière fuivante , à l’occafion d’un air du fa-<
vaut Jomelli :
« Voici ( dit-il,page 14 5 ) des paroles phisfrap-
3j pantes encore , oc dont le fentiment pénètre plus
33 au v if dans les affeâions du coeur. C ’efi un pere
3.3 à qui l’on préfente fan fils , jeune encore , qu’il
33 croit être le fruit d’un incefte. Furieux 8c foible
J3 à la fois , l’horreur 8c la tendreffe le rempliffent
3) tour-à-tour : attiré par la pitié , repouffé par Fef-
» froi, troublé , déchiré, attendri, il pleure 8c
3j s’écrié :
» Mifefo pargoletto
» II tuo deftin non fai :
» Ah ! non gli dite mai
*» Quai era il genitor >».
Malheurçux enfant ! tu ne comtois pas ta definie.
Ah ! ne lui dites jamais quel fut fou père, D emo-
FONTE, a&e III.
A I R
i, Je prends l’air de Jomelli fur ces paroles , &
« je vois que tout ce qu’il a fait en faveur de 1 ex-
„ preffion, c eft de choifir la modulation mineure.
,, La mefure à trois tems dont il fe fe r t, qui eft
„ celle du menuet, ne convient guère .qu aux pal-
„ fions douces & calmes : comment l’appropner
» à l’état de trouble dans lequel fe trouve l’infortuné
„ limante ? Le. mouvement de l’air eft lent : pour
« les deux premiers vers , à la bonne heure ; mais
ti quoi de plus ridicule pour les deux derniers , qui
« font l’exprcftïon même de l’inquiétude ? Rien de
>j fi tranquille que le muficien. Ce contrafte une fois
» établi ne-fait qu’augmenter. Ah ! non gli dite mai
» quai era, occupe huit mefures très-longues , de
jj façon que l’auditeur doit patiemment attendre
» quelques minutes pour arriver au fens de la
» phrafe , qui n’eft qu’à la fin du couplet. Enfin ,
» cette belle interruption fe termine par une ton-
» lade 33.
te Le muficien n’a pas même fu placer fa rcu-
« lade. Il a voit les mots defiin , dite , genitor ; au lieu
>3 de cela , il a pris le mot era , ce qui eft une forte
>3 de barbarifme mufical. Une roulade doit-porter fur
>3 quelque objet, jamais fur des copules abftraites.
33 On nous reproche nos roulements fur onde, gloire ,
33 vole : 8c que dire des italiens qui en font fur mio,
>3 mai 9 çra , 8cc. ? »
Si l’on m’obje&oit qu’il n’v a que des écrivains
françois qui analyfent avec cette févérité minu-
tieufe des airs qu’on admire en Italie , en France ,
& dans toute l’Europe ; je répondrois que des écrivains
italiens en parlent encore avec plus d'humeur
8c de mépris. Je pourrois en rapporter plufieurs
exemples ; mais je me contenterai d’une feule
citation ; elle fera tirée d’une des differtations pleines
de goût 8c d’érudition , dont le favant Saverio Mattéi
a enrichi fa tradu&ion célèbre des pfeaumes en
vers italiens.
Des hommes de beaucoup d’efprit, qui ont
écrit en France fur la mufique dont ils n’avoient
pas affez étudié les principes 8c les effets , ont cru
que les airs italiens dévoient beaucoup de leurs
beautés à la coupe des couplets , 8c au petit nombre
de vers dont ils étaient compofés. Nous femmes
bien éloignés d’adopter cette opinion que nous
difeuterons à l’article po'ènit lyrique. M. Mattéi penfe
bien différemment aufîi. Nous allons traduire fidèlement
un paffage de fa differtation fur la phiiojo-
. phle de la mufique , t. 5 , in-8°. p. 3,08.
« Des airs de plufieurs ftrophes pourroient di-
>3 minuer le principal inconvénient de notre mu-
3j fique , je veux dire , celui de répéter fans ceffe
13 8c jufqu’à la naufée les mêmes paroles. Ouvrons
i3 au hafaîd un livre de mufique ; lifons les paroles
» d’un air, de celui, par exemple , que Porus
i3 chante à Alexandre :
Vedrai con tuo periglio ,
Di quçfto acciaro il lampo,
A I R 63
Corne baleni in camp©
Sul ciglio al donator«
( T u verras au péril de ta vie coiftment l’éclat
de ce fer brille au champ de bataille fur le front
du donateur. )
et Voyons la manière dont le maître de chapelle
33 a difpofé ces paroles. V e d r a i , v e d ra i, v e d r a i, con
33 tuo periglio , dï queflo a c c iaro, acciaro il lampo ,
33 ( ici dix mefures de gazouillement fur ce mot
33 lampo ) corne , corne baiera in campo fu i ciglio , f u i
33 ciglio a l donator. Vedrai con tuo p e r ig lio , d i queflo.
33 acciaro i l lampo , corne b a le n i, ( fix autres rou-
39 lades fur baleni ) f u i ciglio a l donator : corne b a t
33 leni in campo 9 d i queflo acciaro i l lampo , f u i ci-
33 glio , f u i ciglio a l donatbr. Vous croyez peut-être
33 que cela fe termine là ? Point du tout. Par cette
3» route, en F u t f a , nous fommes arrivés en G
33 j o l u t ; il faut maintenant retourner en arrière &
33 revenir par la même route en F ut f s . Voici
33 comme le compofiteur reprend les paroles : Vendrai
y \edraï,y con tuo periglio y vedrai di queflo
33 acciaro il lampo , vedrai corne baleni , ( ici la voix
33 galoppe fur mille double-croches arpégées ) fui
33 ciglio al donator Con tuo periglio vedrai il lampo
»3 ( ici on ne court pas, mais on vole fur les ailes
33 de mille autres notes de gazouillement ) conte ba-
>3 leni y baleni in campo y fui ciglio , fui ciglio al do-
33 nator. Et enfuite , demandez - vous ? Enfuite un
>3 filence univerfel annonce la cadença , & nous
33 perdons un quart-d’heure de tems fur Va de do-
33 nator y pour donner fadsfaéfion à un chanteur
33 extravagant. Mais enfin, continuerons-nous notre
33 route, 8c le chanteur refiera-t-il fur fa cadence J
33 Oh que non. Le chanteur fe relève comme  iv
» tée. 11 chante quatre notes de la fécondé partie
33 qui pèche , au contraire , par une excefiive brié-
»3 y e tê , & fe r t , pour ainfî dire , de rafraîchifle-
33 ment ; 8c il reprend bravement fa côurfe , non
>3 pour aller en avant, mais pour revenir encore
33 deux fois à fon vedrai , vedrai, parce qu’il faut
33 abfolument répéter la première partie. Pendant
33 que Porus fe. pavane ainfi , Alexandre , plus pa.-
33 tient que Job , refie fur le théâtre à attendre la
33 fin de cet impertinent rabachage. Et voilà ce que
33 c’efi que notre mufique ? C ’efi pour entendre cela
33 qu’on va au théâtre. Que diroient ces philofo-
» phes de là Grèce qui vouloient régler la mufique
33 par des lo ix , s’ils voyoient parmi nous de pa-
3> reilies inepties ? 33
Telle efi en effet la forme de prefque tous les
beaux airs italiens que nous avons vu applaudir
-avec des bravos fi bruyants 8c fi ridicules , 8c que
nous aurions vu tranfporter fur nos théâtres , fi ua
homme de génie n’étoit venu nous apporter avec
une mufique toute nouvelle des idées plus grand ts
8c plus faines fur le mélodrame 8c la mufique .dramatique.
C ’efi ce que nous expoferons ailleurs.
Terrninons ce long article par la diftinéKon des
I différentes efpèccs d W , relativement à la fo:*.ie