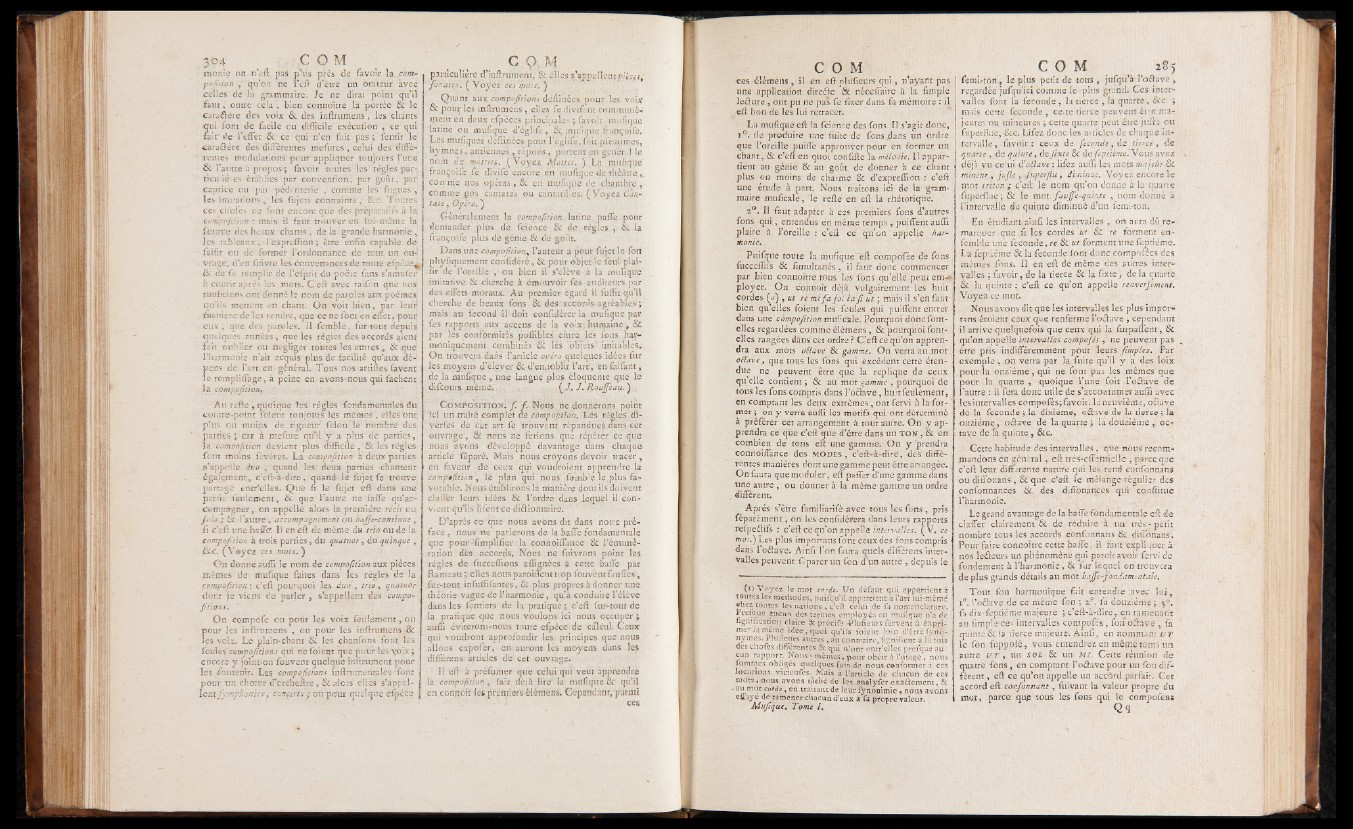
3 9 4 C O M
jiionie on n’eft pas plus, près de favoir la çom-
pofitïon , qu’on ne l ’eft d’être un orateur avec
-celles de la grammaire. Je ne dirai point qu’il
f a u to u t r e cela , bien connoître lâ portée & le
cara&ère des voix & des inftrumens, .les chants
•qui, font de facile ou difficile exécution , ce qui
fait’ de l’e ffet-& ce qui n’en fait pas; fentir le
•caraélère des différentes mefures, celui des" différentes
modulations pour appliquer toujours l’une
& l’autre à propos^ favoir toutes lés règles par-
ticuières établies par convention, par goût, par
.caprice ou par pédanterie , comme les fugues,
les imitations les fujets- contraints , 8cc. Toutes
çes chofes ne font encore que des préparatifs à la
.compofition : mais il faut trouver en foi-même la;
fource des beaux chants, de la ; grande harmonie ,
les tableaux , il’expreffion ; être enfin capable de
faifir ou de former l’ordonnance de tout un gu-'
vrage, d’en fuivre les convenances de toute efpècë*,
& de Te remplir de l’ëfpnt du poète fans s’amufer
.à courir après les mots. C ’eft avec raifon qne nos’ :
muficiens ont donné le nom de parples aux poèmes. ;
qu’ils mettent en chant. On voit bien, par leur-
manière de les rendre, que ce ne font en effet, pour; ,
.eux , que des paroles. 11 femble, fur-tout depuis
quelques années, que les règles des accords aient ;
fait oublier ou négliger toutes les autres _, & que j
l ’harmonie n’ait acquis plus de facilité qu’aux dépens
: de l’art en général. Tous nos artiftes favent
le rempliffage, à peine en avons-nous qui fâchent
la compçfition,
Au refie, quoique les règles fondamentales du ;
contre-point foient toujours les mêmes , elles ont
plus ou moins de rigueur feion Te nombre des j
parties ; car à meftirè qu’il y a plus de parties,
la comnofiiioh devient plus difficile , 8c les règles
font moins févères. La compofition à deux parties
s’appelle duo , quand les deux parties chantent
.également , c’effi-à-dire, quand- le fujet fe trouve
partagé entr telles. Que fi le fujet eft dans une
partie feulement, & que l’autre ne faffe qu’accompagner,
on appelle alors la première récit ou
jolo ; & l’autre , accompagnement ou baffe-continue ,
fi c’efi une baffe’. Il en eft de même du trio ou de la
compofition à trois parties, du quatuor, du quinque ,
& c . (V o y e z ces mots. )
On donne, auffi le nom de compofition aux pièces
mêmes de mufique faites dans lés règles de la
compofition: c’eft pourquoi les duo', trio, quatuor
dont je viens de parler, s’appellent des çompo-\
fitions.
On compofe ou pour les voix feulement , oïi
pour les inftrumens , ou pour les inftrumens &
les voix. L.e plain-chant .& les chardons font les
feules compositions qui né foient que pour les voix j
encore y joint-on fouvent quelque infiniment pour
les -foutenir. Les compofitions infirumentaiesrfont
pour un choeur d’crcheftre , & alors elles s’appel-
leni fymphontes9 concerts ; ou pour quelque efpècç
C Q..M
particulière d’infirument, & elles s’appellen t />/e c«?
fonates. ( Voyez ces rpdis. ) . '
Quant aux compofitions défiinées pour les voiÿ
& pour les infirumens , elles fe divifent communé-
ment en deux efpèces principales ; favoir. mufique
latine ou mufique d’églife , & mufique françoife.
Les mufiques deftipées pour Téglife, foit-pfeaumes,
hymnes, antiennes , répons , portent en général le
nom dé motrets. (V o y e z Mottet. ) La mufique
françoife fe divife encore, en mufique de théâtre,,
comme nos opéras , & en mufique de chambre ,
comme pos cantates ou cantatilies. (V o y e z Cantate
, Opéra. )
Généralement la compofition, latine paffe pour
demander plùs ' dé fcience & de règles , & la
françoife plus de génie & de goût.
Dans une compofition, l’auteur a pour fu jet le fort
phyfiquement confidéré, & pour objet-le feul plai-
fir de l’oreille , ou bien il s’élève à la mulique
imitative & cherche à émouvôir fès-auditeurs par
des effets moraux. Au premier égard il fuffit qu’il
cherche de beaux fons 8t d«$raccords-agréables*;
mais au fécond il'doit confidérer la mufique par
fes rapports aux açcens de l.a voix-, hurpaine , &
par lés conformités pofiibles entre lés fons, harmoniquement
combinés & lès ’ôSjéts' imitables.’
On trouvera dans l’article opéra quelques idées fur
les moyens d’élever & d’ennoblir l’arc, en fàifant,
de la mufique , une langue plus éloquente que le
difcQurs .même; . .. ,, r : (./. J. Rouffeau. ) .
C om pos ition , jfi ƒ. Nous ne donnerons point
ici un traité complet de compofition. Lés règles di-
verfes de çét art fe trouvent répandues dans cèt
ouvrage , Ôc nous'ne ferions que répéter ce que
nous avons développé davantage dans çhaquô
article féparé. Mais nous croyons devoir tracer,
en fayeûr de ceux qui voudroient apprendre la
compofition', le plan qui nous femb'e le,plus favorable.
Nous établirons la manière dont ils 'doivent
çlafièr leurs idées & l’ordre dans lequel il convient
qu’ils lifent ce diéfionnaire.
D’après ce-'due nous avons dit dans notre préface
, nous rte-parlerons de la baffe fondamentale
que pour Simplifier la connoiffance 8c l'énumération
des accords. Nous ne fuivrons point les
règles de fucceffions affignées à cette baffe par
Rameau; elles nousparoiffenttrop fouvênt faillies,
fur-tout in fuffi fautes, & plus- propres à donner une
théorie vague de L’harmonie, qu’à conduire l’élève
dans les fentiers de la pratique ; c’eft fur-tout de
la pratique que nous voulons ici nous occuper ;
auffi éviterons-nous toute efpêce de calcul. Ceux
qiir voudront approfondir les principes que nous
.allons expofer, en auront, lès moyens dans les
différfeRS articles dé cet ouvrage.
Il efi à préfumer que çëlui qui veut apprendre
la compofition, fait, déjà lire la mufique &' qu’il
en. çpnnôît les premiers élémens. Cependant, parmi
ces.
C O M
ces élémens , il en eft plufieurs qui, n’ayant pas
Une application direéle j& néceflaire à la fimple
le&ure , ont pu ne pas fe fixer dans fa mémoire : il
efi bon de les lui retracer.
La mufique eft la fcience des fons. Î1 s’agit donc,
i Q. de produire Une fuite de fons ,dans un ordre
que l’oreille puiffe approuver pour en former un
chant c’eft en quoi confifte la mélodie. 11 appartient
au génie & au goût de donner à ce chant
plus ou moins de charme & d’expreffion : c’eft
une étude à part. Nous traitons ici de la grammaire
muficale, le refte en eft la rhétorique.
2.0. Il faut adapter à ces premiers fons d’autres
fons q u i, entendus en même temps , puiffent auffi
plaire à l’oreille : c’eft ce qu’on appelle harmonie.
Puifque toute la mufique eft compofée de fons ,
fucceffifs 8c fimultanés , il faut donc commencer
par bien connoître tous les fons qu’elle peut em-*
ployer. On connoît déjà vulgairement les huit
cordes (a) , ut re mi fa fo l la f i ut ; mais il s’en faut
bien qu’elles foient les feules qui puiffent entrer
dans une càmpofition muficale. Pourquoi donc font-
elles regardées comme élémens, 8c pourquoi font-
elles rangées dans cet ordre? C ’eft ce qu’on apprendra
aux mots oflave 8c gamme. On verra au mot
oElave, que tous les fons qui excèdent cette étendue
ne peuvent être que la répliqué de ceux
qu’elle contient ; 8c au mot gamme , pourquoi de
tous les fons compris dans l’oêlave, huit feulement,
en comptant les deux extrêmes, ont fervi à la former
; on y verra auffi les motifs qui ont déterminé
à préférer cet arrangement à tout autre. On y apprendra
ce q'ue c’eft que d’être dans un TON, 8c en
combien de tons eft une gamme. On y prendra
connoiffance des m o d e s , c’eft-à-dire, des différentes
manières dont une gamme peut être arrangée.
On faura que moduler, eft paffer d’uné gamme dans
une autre , ou donner à la même gamme un ordre
différent.
Après s’être familiarifé avec tous les fons, pris
féparément, on les confidéfera dans leurs rapports
refpeélifs : c’eft ce qu’on appelle intervalles. (V . ce
mot.) Les plus importans font ceux des fons compris
dans l ’oélave. Ain fi l’on faura quels diftérens intervalles
peuvent féparer un fon d’un autre, depuis le
(i) V o y e z le mot corde. Un défaut qui appartient à
toutes les méthodes, puifqu’il appartient a l’art lui-même
chez toutes les nations , c’eft celui de fa nomenclature.
F reloue aucun des termes employés en mufique n’a de
iigmncatipn claire & précife -Flufieurs fervent à èxpri-
mer-la même idée,, quoi qu’ils foient loin d’etre fynd-
nymes.-Plufîeurs autres , au contraire, lignifient à la fois
des chofes différentes 5c qui n’ont entr'eilçs.prefque au cun
rapport. Nous- mêmes, pour obéir à l’ufage , nous
fommes obligés quelques fois de nous conformer à ces
locutions vicieufes. Mais à l’article de chacun de ces
mo'ts, nous avons tâché de’ les analyfer exactement, &
-au mot corde, en traitant de leur fynonimie, nous avons
eflaye dé ramener chacun d’eux à fa propre valeur.
Mu f i q u e , Tome I .
C O M î S j
femi-tôn , le plus petit de tous , jufqu’à l’o&ave,
regardée jufqu’ici comme le plus grand. Ces intervalles
font la fécondé , la tierce , la quarte, &c. ;
mais cette fécondé , ceite tierce peuvent être majeures
ou mineures ; cette quarte peut être jufte ou
ftiperfiue, & c. Lifez doncles .articles de chaque in^
tervalle, favoir : ceux de fécondé, de tierce , de
quarte , de quinte, dt fixte & de feptième. Vous avez
déjà vu celui d’ ofiave : lifez auffi les mots majeàr 8c
mineur , jufie , fuperflu, diminué. Voyez encore le
mot triton ■; c’eft le nom qu’on donne à la quarte
fuperflue ; & le mot fauffe-quinte , nom donné à
l ’intervalle de quinte diminué d’un femi-ton.
En étudianfc.ainfi les intervalles , on aura dû re--
marquer que fi les . cordes ut & re forment en-
femble une fécondé, re 8c ut forment une feptième.
La/ep.îième & la fécondé font donc compofées des
mêmes fons. 11 en eft de même des a litres intervalles
; favoir, de la tierce 8c la fixte, de la quarte
& la quinte; c’eft ce qu’on appelle tenverfement.
Voyez ce mot.
Nous avons dit que les intervalles les plus importans
étoient ceux que renfermé I’o&ave ; cependant
il arrive quelquefois que ceux qui la furpafient, &
qu’on appelle intervalle r compofés , ne peuvent pas
être pris indifféremment pour leurs fimples. Par
exemple, on verra par la fuite qu’il y a des loix
pour la onzième, qui né font pas les mêmes que
pour la quarte , quoique l’une foit l’oâave de
l ’autre : il fera donc utile de s’accoutumer auffi avec
les intervalles compofés; favoir, la neuvième, oéiaye
de la fécondé ; la dixième, oétave de là tierce ; la
onzième, o&ave de la quarte ; la douzième , octave
de fa quinte, &c.
Cette habitude des intervalles, que nous recommandons
en général, eft très-teffentielle , parce que
c’eft leur différente nature qui les rend confonnans
ou difionans, 8c que cteft le mélange régulier des
confonnances &. des diffonances qui conftitue
l’harmonie.
Le grand avantage de la baffe fondamentale eft de
claffer clairement 8c de ■ réduire- à un très-petit
nombre tous les accords confonnans 8c difionans.
Pour faire connoître cette baffe, il faut expliquer à
nos leêleurs un phénomène qui paroît avoir fervi de
fondement à l’harmonie, 8c fur lequel on trouvera
de plus grands détails au mot baffe-fondamentale.
Tout fon harmonique fait entendre avec lu j,
1°. l’oétave de ce même fon ; o f. fa douzième ; 30.
fa dix-feptième majeure ; c’eft-à-dire, en ramenant
au fimple-ceintervalles compofés, fon oftave , fa
quinte 8c fa tierce majeure. Ainfi, en nomman: u t
le fon fuppofé, vous entendrez en mêmetems un
autre u t , un s o i & un m i . Cette réunion de
quatre fons, en comptant l’oâave pour un fon différent
, eft ce qu’on appelle un accôrd parfait. Cet
accord eft confonnant , fuivant la valeur propre du
mot, parce que tous les fons qui le compofea*