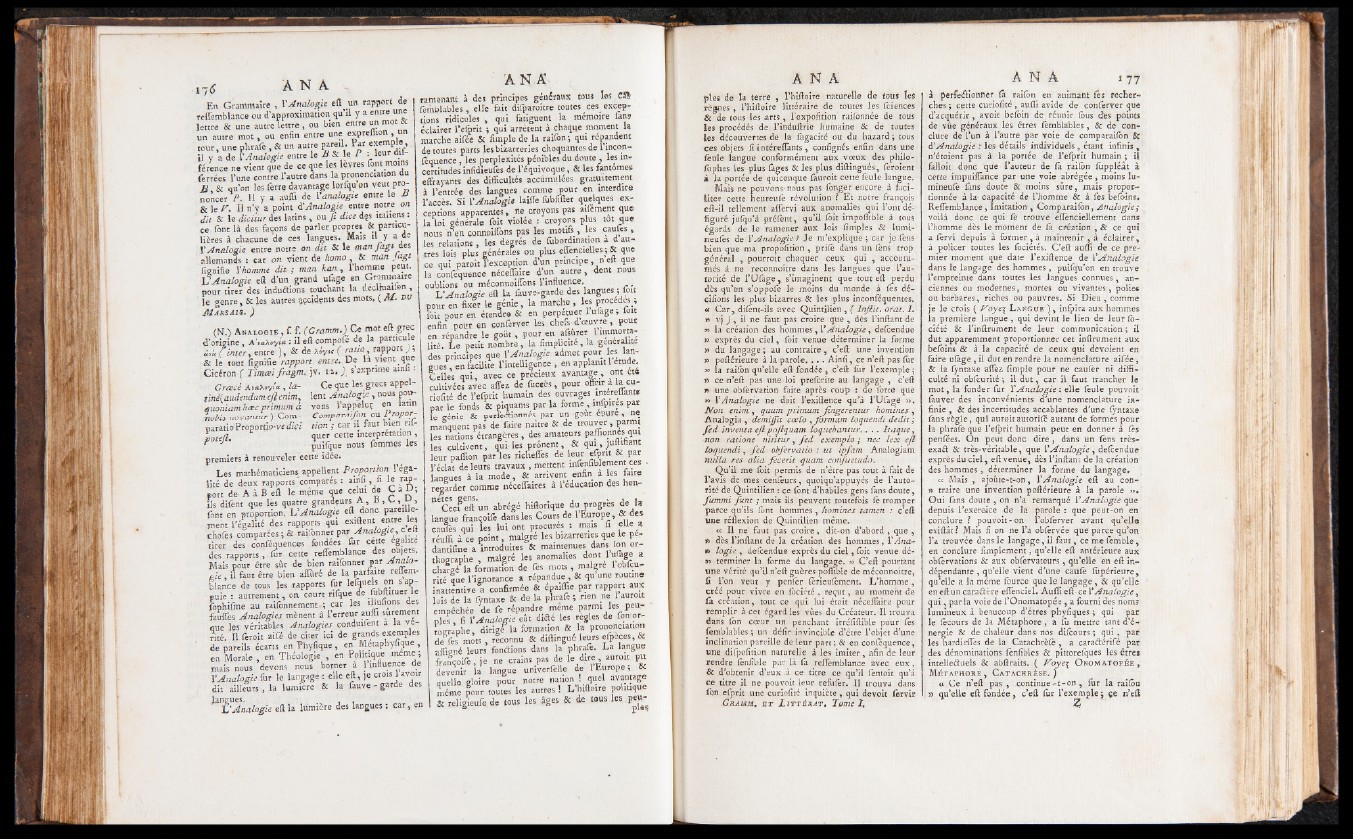
l l $
A N A
En Grammaire , l ’Analogie eft un rapport de
reffembiance ou d’approximation qu’il y a entre une
lettre & une autre lettre , ou bien entre un mot St
un autre m ot, ou enfin entre une exprefiion, un
tour, une phrafe , & un autre pareil. Far exemple,
il v ’a de l'Analogie entre le B & lq P : leur différence
ne vient que de ce que les levres font mom
ferrées l ’une contre l’autre dans la prononciation du
B & qu’on les ferre davantage lorlqu’pn veut prononcer
/>, Il y a au® de l'analogie entre le B
& le F . Il n’y a point S Analogie entre notre on
dit St le dicitur des latins , ou Ji dice dçs italiens :
ce font là des façons de parler propres 8ç particulières
à chacune de ces langues. Mais il y a de
VAnalogie entre notre on dit St le pian Jagt des
allemands i car on vient de homo , & man Jagt
lignifie l'homme dit ; man k m , l’homme peut.
V Analogie eft d’un grand ufage en Grammaire
pour tirer des induétions touchant la decltnailon ,
le genre, St les autres accidents des mots, ( Al- ou
J U a r s a i s , )
(N.) A nalo gie , fi f. f Gramm. ) Ce mot eft grec
d’origine, A'»«A«yi* ; il eft compofe de la particule
iia t in te r , entre ) , & de À«'y« ( CPtloX raPPort ) >
& le tout lignifie rapport entre. De la vient que
Cicéron ( Ttmeei fragm, jv. », s’exprime m h :
Grâce A »«A,-/*, la- Ce que les grecs appel-
xinèlaudendumeftenim, lent Analogie, nous pott-
auoniam hæc prïmum à vons l’appelep en latin
nobis novantur ) Com- Comparaffon ou Ijopor
paratioProportio-veififi tian ; car il faut bien nl-
loteft. quer cette interprétation,
r puilque nous (oittmes les
premiers à renouveler cette idée.
Les mathématiciens appellent Proportion 1 égalité
de deux rapports comparés : ainfa, il le rap
port de A à B eft le même que celui de L a U ,
ils difent que lès quatre grandeurs A , B , G , u ,
font en proportion, V A n a lo g ie eft donc pareillement
l’égalité des rapports qui extftent entre les
chofes comparées ; St raifonner par A n a lo g ie , c etl
tirer des cpnféquences fcndées lûr cette égalité
des rapports , fur cette reffembiance des objets.
Mais pour être sûr de bien raifonner par A n a lo gie
il faut être bien alluré de la parfaite reffembiance
de tous les rapports fur lefquels on s appuie
: autrement, on court rifque de fubftttuerle
fophifme au raifonnement.; car les iFtmons des
fauffes Analogies mènent à l ’erreur auffi sûrement
que les véritables Analogies condutfent a la vérité.
Il liroit aifé de citer ici de grands exemples
de pareils écarts en Phyfique , en Metaphyfijue ,
en-Morale , en Théologie , en Politique meme;
jnais nous devons nous borner à 1 mBuence de
VA n a log ie (m le largage : elle eft, ]e crois 1 avoir
dit ailleurs ,, la lumière & la fauve - garde des
langues. m , ,
' t ’Analogie eft la lumière des langues : car, en
A N A.
ramenant à des principes généraux tous les CSS
femblables , elle fait difparoître toutes ces exceptions
ridicules , qui fatiguent la mémoire fans
éclairer l’elprit ; qui arrêtent à^chaqqe moment la
marche aifée St fimple de la raifon ; qui répandent
de toutes parts les bizarreries choquantes de l’tncon-
féquence, les perplexités pénibles du doute , les incertitudes
infidieulës de l’équivoque, St les fantômes
effrayants des difficultés accumulées gratuitement
à l’entréç des langues comme pour en interdire
l’accès. Si l'Analogie laiffe fubfifter quelques exceptions
apparentes, ne croyons pas alternent que
la loi générale foit violée : croyons plus tôt que
nous V en csmnpiffot« pas les motifs , les caufes ,
les relations, les degrés de fubordmation a d autres
lois plus générales ou plus effenctelles ; & que
ce qui parpît l’exception d’un principe, n ett que
la conféquence ncceffaire d’un autre , dont nous
oublions ou méconnoiffpns l'influence,
L 'Analogie eft la fauve-garde des langues ; foit
pour en fixer le génie, la marche , les procédés ,
fait pour en étendra & en perpétuer 1 ufage; lott
enfin pour en çonferver les chefs-d oeuvre, pour
en répandre le goût , pouf en afsurer 1 immorta- -
lité. Le petit nombre, la (implicite, la généralité
des principes que l'Analogie admet pour les langues,
en facilite l’intelligence , en applantt 1 etude.
Celles qui, avec ce précieux avantage , ont été
cultivées avec affez de fuceès, pour offrir a la cu-
riofité de l’efprit humain des ouvrages mteretlant»
par le fonds & piquants par la forme vinfpires par
le eénie & perfeftionnés par un rgout épuré, ne
manquent pas de faire naître & de trouver , jsarmt
les nations étrangères , des amateurs paffipnnes: qui
les cultivent, qui les prônent, & qur, jufttfiant
leur paffion par les richeffes de leur efprtt &^par
l’éclat de leurs travaux , mettent infenfiblement ces
langues à la mode, & arrivent enfin à les latre
regarder comme néceffaites à l’eduçation des honnétes
gens. MB . ' i-
Ceci eft un abrégé htftorique du progrès de la
langue françoife dans les Cours de l’Europe, & des
cauTes qui les lui ont procures ; mats fi elle a
réuffi à ce point, malgré les bizarreries que le pe-
dantifine a introduites St maintenues dans Ion orthographe
, malgré les anomalies dont 1 ufage a
chargé* la formation de fes mots , malgré 1 obfcu-
rité que l’ignorance a répandue , & qu une routine
inattentive a confirmée & épaiffie par rapport aux
lois de la fyntaxe & de la phrafe ; vien ne 1 auroit
empêchée de fe répandre meme parnu les peuples,
fi l'Analogie eût dide les réglés de fon or-
tographe, dirigé la formation & la prononciation
de fés mots, reconnu & difttngué leurs efpeces, &
affigné leurs fondions dans la phrafe. La langue
francohe, je ne crains pas de le dire auroit pu
devenir la langue univerfeUe de 1 Europe, &
quelle gloire pour notre natton ! quel avantage
même pour toutes les autres ! L ’htftotre politique
St religieufe de tous les âge? St de tous les peu-
A N A
Iptes de la terre , l’hiftoire naturelle de tous les
règnes , l’hiftoire littéraire de toutes les feiences
& de tous les arts , l ’expofition raifonnée de tous
les procédés de l ’induftrie humaine & de toutes
les découvertes de la fegacité ou du hazard ; tous
ces objets fi intérefïànts, confîgnés enfin dans une
feule langue conformément aux voeux des philo-
fephes les plus feges & les plus diftingués, feroient
à la portée de quiconque feuroit cette feule langue.
Mais ne pouvons-nous pas fenger encore à faciliter
cette heureufe révolution ? Et notre françois
eft-il tellement affervi aux anomalies qui l’ont défiguré
jufqu’à préfent, qu’il feit impoffible à tous
égards dé le ramener aux lois Amples & lumi-
neufes de Y Analogie ? Je m’explique ; car je fens
bien que ma propofîtion , prife dans un fens trop
général , pourroit choquer ceux qui , accoutumés
à ne reconnoître dans les langues que l’autorité
de l’CJfege, s’imaginent que tout eft perdu
dès qu’on s’oppofe le mpins du monde à fes décrions
les plus bizarres & les plus inconfêquentes.
« Car, difent-ils avec Quintilien , ( lnjlit. orat. I.
» vj ) , il ne faut pas croire que, dès l’inftant de
» la création des hommes, V Analogie, defeendue
» exprès du c ie l, feit venue déterminer la forme
» du langage ; au contraire, c’eft une invention
» poftérieure à la parole. . . . Ainfî, ce n’eft pas fer
*> la raifen qu’elle eft fondée, c’eft fer l’exemple ;
» ce n’eft pas une loi preferite au langage , c’eft
» une obfervation faite après coup : de fetté que
n T Analogie ne doit l’exiftence qu’à l ’Ufege
Non enim , quum primum fingerentur homines ,
Analogia , demiJJ'a coelo , formant loquendi dédit ;
fe d inventa ejlpojlquam loquebantur. . . . Inique,
non ratione nititur yfed exemploi nec lex ejl
loquendi, fed obfervatio : ut ipfam Analogiam
nulla res alia fecerit quant confuetudo.
Qu’il me feit permis de n’être pas tout à fait de
l ’avis de mes cenfeurs, quoiqu’appuyés de l’autorité
de Quintilien : ce fent d’habiles gens (ans doute,
fummi funt ; mais ils peuvent toutefois fe tromper
parce qu’ils fent hommes , homines tamen : c’eft
une réflexion de Quintilien même.
« Il ne faut pas croire, dit-on d’abord , que ,
» dès l’inftant de la création des hommes, 1 'Ana-
» logie , defeendue exprès du c ie l, feit venue dé-
sï terminer la forme du langage. » C ’eft pourtant
une vérité qu’il n’eft guères pomble de méconnoître,
G. l’on veut y penfer ferieufement. L ’homme,
créé ÿour vivre en feciété , reçut, au moment de
£à création, tout ce qui lui étoit néceflàire pour
remplir à cet égard les vues du Créateur. Il trouva
dans fon coeur un penchant irréiîftible pour fes
femblables ; un défie invincible d’être l’objet d’une
inclination pareille de leur part; & en conféquence,
une dilpofition naturelle à les imiter, afin de leur
rendre fenfible par là fe reffembiance avec eux ,
& d’obtenir d’eux .à ce titre ce qu’il fentoit qu’à
ce titre il ne pouvoit leur refufer. Il trouva dans
fon efprit une curiofité inquiète, qui devoit fervir
tGRAMM, e t L i t t é r a t , T pm c ƒ,
À N A 177
à perfeâiotiner fe raifon en animant fes recherches
; cette curiofité , auffi avide de çonferver que
d’acquérir, avoit befoin de réunir fous des points
de vüe généraux les êtres femblables, & de conclure
de l’un à l’autre par voie de comparaifon &
d'Analogie : les détails individuels, étant infinis ,
n’étoient pas à la portée de l ’efprit humain ; il
falloit donc que l’auteur de fe raifon fùppléât à
cette impuiffence par une voie abrégée , moins lu-
mineufe fens doute & moins sûre, mais proportionnée
à la capacité de l’homme & à fes befoins#
Relfemhlance, Imitation , Comparaifon, Analogie;
voilà donc ce qui fe trouve effenciellement dans
l’homme dès le moment de fe création , & ce qui
a fervi depuis à former, à maintenir , à éclairer,
à policer toutes les fociétés. C’eft aüfïi de ce premier
moment que date l’exiftence de Y Analogie
dans le langage des hommes , puifqu’on en trouve
l’empreinte dans toutes les langues connues, anciennes
ou modernes, mortes ou vivantes, polie«
ou barbares, riches ou pauvres. Si Dieu, comme
je le cfois ( Foye^ L angue ) , infpira aux hommes
la première langue , qui devint le lien de leur fo-
ciété & l’inftrument de leur communication ; il
dut apparemment proportionner cet inftrument aux
befoins & à la capacité de ceux qui dévoient en
faire ufege, il dut en rendre la nomenclature aifée,
& la fyntaxe affez fimple pour ne caufèr ni difficulté
ni obfeurité ; il dut, car il faut trancher le
mot, la fonder fer Y Analogie : elle feule pouvoit
feuver des inconvénients d’une nomenclature infinie
, & des incertitudes accablantes d’une fyntaxe
fens règle, qui auroitautorife autant de formes pour
la phrafe que l’efprit humain peut en donner à fes
penfées. On peut donc dire, dans un fens très-
exaét & très-véritable, que l’Analogie, defeendue
exprès du ciel, eft venue, dès l ’inftant de la création
des hommes, déterminer la forme du langage*
ce Mais , ajoute-t-on, Y Analogie eft au con-
» traire une invention poftérieure à la parole »•
Oui fens doute, on n’a remarqué Y Analogie que
depuis l’exereice de la parole : que peut-on en
conclure ? pouvoit-on î’obferver avant qu’elle
exiftât ? Mais fi on ne l’a obfervée que parce qu’on
l’a trouvée dans le langage, il faut, ce me femble,
en conclure Amplement, qu’elle eft antérieure aux
obfervations & aux obfervateurs , qu’elle en eft indépendante
, qu’elle vient d’une caufe fûpérieure,
qu’elle a la même fource que le langage , & qu’elle
en eft un caraétère effenciel. Auffi eft-ce Y Analogie,
qui, parla voie de l’Onomatopée , a fourni des noms
lumineux à beaucoup d’êtres phyfiques ; qui par
le fecours de la Métaphore , a fu mettre tant d’é nergie
& de chaleur dans nos tlifoours ; q u i, par
les hardieffes de la Catachrèfe , a caradérifé par
des dénominations fenfibles & pittorefques les êtres
intelle&uels & abftraits. ( J^oyei^ O nomatopée ,
Mé t apho re , C ata ch r èse. )
« Ce n’eft pas , continue-t-on , fer la raifon
. » qu’elle eft fondée, c’eft fur l’exemplej çe n’eft