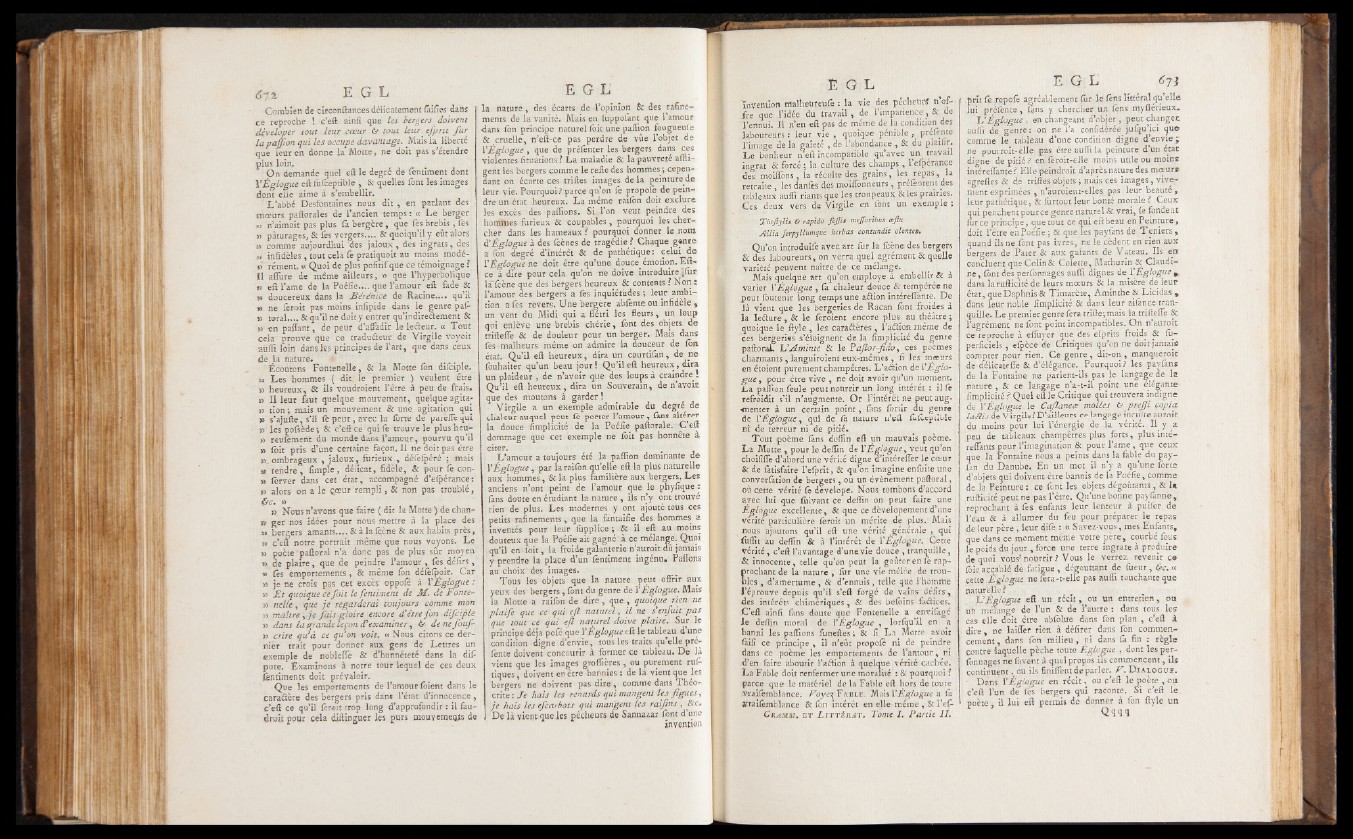
6 7z E G L
Combien de circonftances délicatement failles dans
ce reproche ! c’eft ainfî que les bergers doivent
d&veloper tout leur coeur 6* tout leur efprit fur
lapafjion qui les occupe davantage. Mais la liberté
que leur en donne la Motte, ne doit pas s'étendre
plus loin.
On demande quel eft le degré de fentiment dont
YÉglogue eft fufceptible , & quelles font les images
dont elle aime à s’embellir.
L ’abbé Desfbntaines nous dit , en parlant des
moeurs paftorales de l’ancien temps : c< Le berger
« n’aimoit pas plus fà bergère, que fès brebis , lès
» pâturages, & fès vergers.,.. & quoiqu’il y eût alors
» comme aujourdhui 'des jaloux , des ingrats, des
s» infidèles , tout cela fè pratiquoit au moins^ modé-
» rément. « Quoi de plus pofitif que ce témoignage ?
Il afliire de même ailleurs, » que l’hyperbolique
» eft l’ame de la Poéfîe,... que l’amour eft fade &
» doucereux dans la Bérénice de Racine...» qu’il
» ne feroit pas moins infipide dans le genre paf-
» toral,... &. qu’il ne doity entrer qu’in direftement &
» en pallant, de peur d’affadir le fedeur. « Tout
cela prouve que ce tradudeur de Virgile voyoit
aùfli loin dans les principes de l'art, que dans ceux
île la nature* i-
' Écoutons Fontenelle, & la Motte fôn difciple.
a» Les hommes ( dit le premier ) veulent être
» heureux, & ils voudroient l’être à peu de frais.
» Il leur faut quelque mouvement, quelque agita-
» tion; mais un mouvement & une agitation qui
» s’ajufte, s’il fè peut, avec la forte de pareflëqui
» les pofsède; & c’eft ce qui fe trouve le plus heu-
» reniement du monde dan« l’amour, pourvu qu’il
» foit pris d’une certaine façon. 11 ne doit pas être
» ombrageux , jaloux, furieux , défefpéré ; mais
» tendre, fimple, délicat, fidèle, & pour fè con-
» fèrver dans cet état, accompagné d’efpérance:
» alors on a le çoeur rempli, & non pas troublé,
&c. »
». Nous n’avons que faire ( dit la Motte ) de chan-
» ger nos idées pour nous mettre à la place des
as bergers amants.... &àlafcène & aux habits près,
» c’eft notre portrait ihême que nous voyons. Le
» poète paftoral n’a donc pas de plus sur moyen
» de plaire, que de peindre l’amour , fès défîrs ,
» fès emportements, & même fôn défèfpoir. Car
» je ne crois pas cet excès oppofé à YÉglogue :
» jEt quoique ce foit le fentiment de M. de Fonte-
» nelle, que je regarderai toujôurs comme mon
» maître yje fais gloire encore d’être fon difciple
» dans la grande leçon d’examiner , 6* de ne fouf-
» crire qu’à ce qu’on voit. « Nous citons ce dernier
trait pour donner aux gens de Lettres un
exemple de nobleftè & d’honnêteté dans la dif
pute. Examinons à notre tour lequel de ces deux
fèntiments doit prévaloir.
Que les emportements de l’amour fôient dans le
caractère des bergers pris dans l’état d’innocence,
c’eft ce qu’il ferait trop long d’approfondir : il faudrait
pour cela diftinguer les purs mouYcme&ts de j
E G L
la nature, des écarts de l’opinion & des rafine-
ments de la vanité.-Mais en füppofant que l’amour
dans fôn principe naturel foit une paflion fougueufe
& cruelle, n’eft-ce pas perdre de vue l’objet de
Y É g l o g u e , que de préfènter les bergers dans ces
violentes fituations ? La maladie & la pauvreté affligent
les bergers comme lereftedes hommes■ ; cependant
on écarte ces triftes images de la peinture de
leur vie. Pourquoi? parce qu’on fe propofe de pein-i
dre un état heureux. La même raifôn doit exclure
les excès des pallions. Si l’on veut peindre des
hommes furieux & coupables, pourquoi les chercher
dans les hameaux ? pourquoi donner le nom
d’É g lo g u e à des fcènes de tragédie ? Chaque genre
a fon degré d’intérêt & de pathétique: celui de
Y É g lo g u e ne doit être qu’une douce émotion. Eft-
ce à dire pour cela qu’on ne doive introduire |fuc
lzffcène que des bergers heureux & contents ? Non s
l’amour des bergers a fès inquiétudes ; leur ambition
a fès revers. Une bergère abfènte ou infidèle ,
un vent du Midi qui a flétri les fleurs, un loup
qui enlève une brebis chérie, font des objets de
trifteffè & de douleur pour un berger. Mais dans
fès-malheurs même on admire la douceur de fôn
état. Qu’il eft heureux, dira un courtifan, de lie
fôuhaiter qu’un beau jour ! Qu’il eft heureux, dira
un plaideur , de n’avoir que des loups à craindre !
Qu’il eft heureux, dira un Souverain, de n’avoic
que des moutons à garder !
Virgile a un exemple admirable du degré de
chaleur auquel peut fè porter l’amour , fans altérer
la douce fîmplicité de la Poéfîe paftorale. C’eft
dommage que cet exemple ne fôit pas honnete a.
citer. H .
L ’amour a toujours été la paflion dominante de
YÉglogue, par la raifôn qu’elle eft la plus naturelle
aux hommes, & la plus familière aux bergers. Les
anciens n’ont peint de l’amour que le phyfique :
fans doute en étudiant la nature , ils n’y ont trouvé
rien de plus. Les modernes y ont ajouté tous ces
petits rafinements, que la fantaifie des hommes a
inventés pour leur fùpplice ; & il eft au moins
douteux que la Pôèfie ait gagné a ce mélange. Quoi
qu’il en foit, la Froide galanterie n’aurait dû jamais
y- prendre la place d’un fèntiment ingénu. Paffons
au choix des images.
Tous les objets que la nature peut offrir aux
yeux des bergers, font du genre de YÉglogue. Mais
la Motte a raifôn de dire, que, quoique rien ne
plaife que ce qui eft naturel, il ne s'enfuit pas
que tout ce qui eft naturel doive plaire. Sur le
principe déjà pofé que YÉglogue eft le tableau d une
condition digne d’envie, tous les traits qu elle pre-
fènte doivent concourir à former ce tableau. De la
vient que les images groflieres, ou purement ruf-
tiques, doivent en être bannies : de là vient que les
bergers ne doivent pas dire, comme dans Théo-
crite : Je hais les renards qui mangent les figues,
je hais les efcarbots qui mangent les raifins , Sic.
De là vient que les pêcheurs de Sannazar font d’une
invention
Ë G L
invention malheuteufè : la vie des pêcheur n’offre
que l’idée du travail, de l’impatience , & de
l ’ennui. Il n’en eft pas de même de la condition des
laboureurs : leur vie , quoique pénible , préfènte
l’image de la gaieté , de l’abondance , & du plaifîr.
Le bonheur n’eft incompatible qu’avec un travail
ingrat & forcé; la culture des champs , 1 efperance
des moiffons , la récolte des grains, les repas, la
retraite , les danfès des moifîônneurs, préfèntent des
tableaux aufli riants que les troupeaux & les prairies.
Ces deux vers de Virgile en font un exemple ;
Thefiylis & rapido fejfis mejforibus afin
A llia ferpyllumque herbus contundit dentés.
Qu’on introduife avec art fur la fcène des bergers
& des laboureurs, on verra quel agrément & quelle
variété peuvent naître de ce mélange.
Mais quelque art qu’on employé à embellir & à
varier Y É g lo g u e , fà chaleur douce & temperee ne
peut fôutenir long temps une adion intéreffante. De
là vient que les bergeries de Racan font froides à
la ledure, & le feraient encore plus au théâtre ;
quoique le ftyle , les caradères , l ’adion même de
ces bergeries s’éloignent de la fîmplicité du genre
paftoral. U A m in t e & le P a jlo r - f id o , ces poèmes
charmants , languiraient eux-mêmes , fi les moeurs
en étoient purement champêtres. L ’adion de Y E g lo ~
g u e , pour être vive , ne doit avoir qu’un moment.
La paflion feule peut nourrir un long intérêt : il fe
refroidit s’il n’augmente. Or l’intérêt ne peut augmenter
à un certain point, fans fôrtir du genre
de Y É g lo g u e y qui de fa nature n’eft fufceptible
ni de terreur ni de pitié.
Tout poème fans deflin eft un mauvais poème.
La Motte , pour le deffin de YÉg’oguey veut qu’on
choififïè d’abord une vérité digne d’intérefîèr le coeur
& de fàtisfalre l’efprit, & qu*ôn imagine enfuite une
converfàtion de bergers, ou un évènement paftoral,
où cette vérité fè dcvelope. Nous tombons d’accord
avec lui que fui vaut ce deflin on peut faire une
Éfilogue excellente, & que ce dèvelopement d’une
vérité particulière fèroit un mérite de plus. Mais
nous ajoutons qu’il eft une vérité générale , qui
fuit au deflin & à l’intérêt de YÉglogue. Cette
vérité, c’eft l’avantage d’une vie douce , tranquille,
St innocente, telle qu’on peut la goûter en fè rap-
rochant de la nature , fur une vie mélce de trou-
les , d’amertume , & d’ennuis , telle que l’homme
l’éprouve depuis qu’il s’eft forgé de vains défîrs,
des intérêts chimériques, & des belôins fadices. ■
C’eft ainfî fans doute que Fontenelle a envifàgé
le deflin moral de YÉglogue , lorfqu’il en a
banni les pallions funeftes; & fi La Motte avoit
làifî ce principe , il n’eût propofe ni de peindre
dans ce poème les emportements de l’amour, ri
d’en faire aboutir l’adion à quelque vérité cachée.
La Fable doit renfermer une moralité : & pourquoi f
parce que le matériel de la Fable eft hors de toute
vraifèmblance. Voyex F a b l e . Mais YÉglogue a fà
yraifèmblance & fôn intérêt en elle même , & l’ef-
Cramm. e t Littérat, Tome I. Partie IL
E G L <?7J
prit fe repofè agréablement fur le fefls littéral qu’elle
lui préfente , fgns y chercher un fèns myfterieux*
L ’Ê g lo g u e , en changeant d’objet, peut changer,
aufli de genre:-on ne l’a confîdérée jufqu’ici que
comme le tableau d’une condition digne d’envie y
ne pourrait-elle pas être aufli la peinture d’un état
digne de pitié? en fèroit-elle moins utile ou moins:
intéreffante f Elle peindrait d’après nature des moeurs
agreftes & de triftes objets ; mais ces images, vivement
exprimées , n’auraient-elles pas leur beaute,
leur pathétique, & fiirtout leur bonté morale ? Ceux
qui penchent pour ce genre naturel & vrai, fe fondent
fur ce principe, que tout ce qui eft beau en Peinture,
doit l’être en Poefie ; & que les payfàns de Teniers ,
quand ils ne font pas ivres, ne le cèdent en rien aux
bergers de Pater & aux galants de Vateau. Ils en
concluent que Colin & Colette, Mathurin & Claudine,
font des perfônnages aufli dignes de Y É g lo g u e
dans larufHcité de leurs moeurs & la misère de leur
état, que Daphnis & Timarète, Aminthe & Licidas *
dans leur noble fîmplicité & dans leur aifânce tranquille.
Le premier genre fera trifte;mais la trifteffè &
l’agrément ne font point incompatibles. On n’aurait
ce reproche à efluyer que des efprits froids & fu-
perficiels , efpèce de Critiques qu’on ne doit jamais
compter pour rien. Ce genre, dit-on, manqueroit
de delicateiïè & d’élégance. Pourquoi? les payfàns
de la Fontaine ne parlent-ils pas le langage de la
nature, & ce langage n’a-t-il point une élégante
fîmplicité ? Quel eft le Critique qui trouvera indigne
de Y É g lo g u e le C afian eæ m o lle s t? p r e ft i co p ia
la c lis de Virgile? D’ailleurs ce langage inculte aurait
du moins pour lui l’energie de la vérité. Il y a
peu de tableaux champêtres plus forts, plus inté-
reffants pour l’imagination & pour l’ame, que ceux
que la Fontaine nous a peints dans la fable du pay-
fan du Danube. En un mot il n’y a qu’une forte
d’objets qui doivent être bannis de la Poéfîe, comme
de la Peinture : ce font les objets dégoûtants, & la
rufticité peut ne pas l’être. Qu’une bonne payfànnë s
reprochant à fès enfants leur lenteur à puifèr de
l’eau & à allumer du feu pour préparer le repas
de leur père , leur difè : ce Savez-vous, mes Enfants,
que dans ce moment même votre père, courbé fous
le poids du jour , force une terre ingrate à produire
de quoi vous? nourrir ? Vous le- verrez revenir ce
fôir accablé de fatigue , dégouttant de fueur, & c . «
cette É g lo g u e ne fera-t-elle pas aufli touchante que
naturelle'? ^
VÉglogue eft un r é cit, ou un entretien, ou
uti mélange de l’un & de l’autre : dans tous lés
cas elle doit être abfôlue dans fon plan , c’eft à
dire, ne laiflèr rien à délirer dans fôn commencement,
dans fôn milieu, ni dans fà fin : règle
contre laquelle pèche toute Églogue , dont les per-
fbnnages ne fàvent à quel propos ils commencent, ils
continuent, ou ils finiffent de parler. V . D ia lo g u e .
Dans YÉglogue en récit, ou c’eft le poète , ou
c’eft l’un de fes bergers qui raconte. Si c’eft le
poète il lui eft permis de donner à fon ftyle un
Q < m