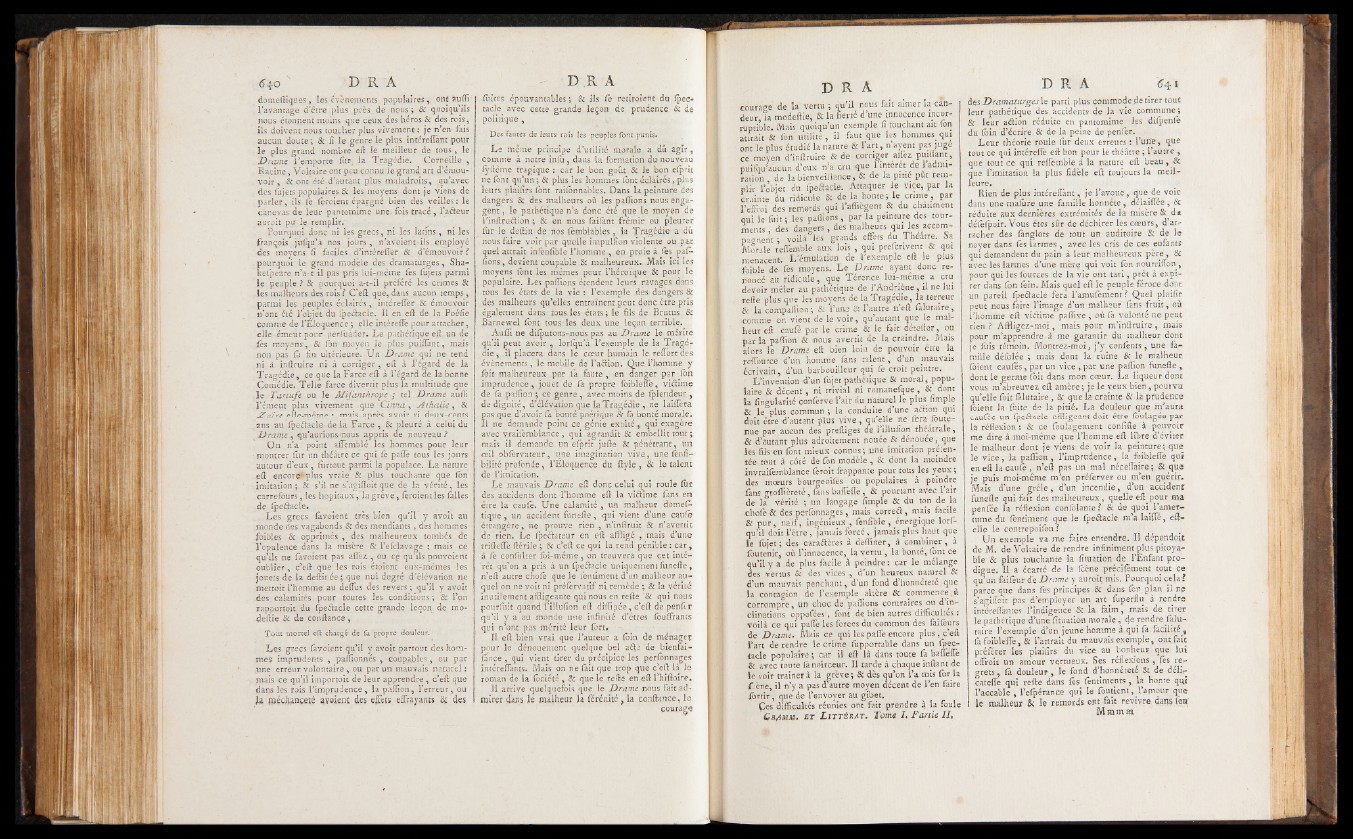
domefliques , les évènements populaires, ont àuffi
l ’avantage d’être plus près de nous ; & quoiqu’ils
nous étonnent moins que ceux des héros & des rois ,
ils doivent nous toucher plus vivement : je n’en lais
aucun doute ; & fî le genre le plus intéreflànt pour
le plus grand nombre eft le meilleur de tous , le
Drame l ’emporte firr. la Tragédie. Corneille ,
Racine, Voltaire ont peu connu le grand art d’émouvoir
, & ont été d’autant plus maladroits, qu’avec
des (ùjets populaires & les moyêns dont je viens de
parler, ils. Ce (croient épargné bien des veilles : le
canevas de leur pantomime une. fois tracé, fadeur
auroit puf le remplir.
Pourquoi donc ni les grecs, ni les latins , ni les
françois jufqu’à nos jours, n’a voient-ils employé'
des moyens 5 faciles d’intéreffer & d’émouvoir ?
pourquoi le grand modèle des dramaturges, Shakespeare
n’a-1 il pas pris lui-même lès fujets parmi
le peuple ? & pourquoi a-t-il préféré les crimes &
les malheurs des rois l C’eft. que, dans aucun temps,
parmi les peuples éclairés, intéreffer & émouvoir
n’ont été l’objet du Ipedacle. Il en eft de la Poéfîe
comme de l ’Éloquence ; elle intéreflè pour attacher,
elle émeüt pour perfuàder. Le pathétique eft un de
fês .moyens, & Ion moyen le plus puifïànt, mais;
non pas (à fin ultérieure. Un Drame qui ne tend
ni à inftruire ni à corriger, eft à l ’égard de la
Tragédie, ce que la Farce eft à l’égard de la bonne
Comédie. Telle farce divertit plus la multitude que
le Tartufe ou le Mifanthrope ; tel Drame aufii
l ’émeut plus vivement que Cinna, Athalie, &
Adiré elle-même : mais après avoir ri deux-cents
ans au fpeétacle d e là Farce, & pleuré à celui du
Drame , qu’aurions-nous appris de nouveau ?
On n’a point affemblé les hommes pour leur
montrer fiir un théâtre ce qui (è paflè tous les jours
autour d’eu x , fur tout parmi la populace. La nature
efl encore*plus vraie & plus touchante que (on
imitation ; & s’il ne s’agifloit que de la vérité, les
carrefours, les hôpitaux, la grève, (croient les (ailes
de fpeâaçle.
Les grecs fàvoient très bien qu’il y avoit au
monde des vagabonds & des mendiants , des hommes
foibles & opprimés , des malheureux tombés de
l ’opulence dans la misère & l’efclavage : mais ce
qu’ils ne (avoient pas allez, ou c§ qu’ils pouvoient
oublier , c’eft que les rois étoient eux-mêmes les
jouets de la deftinée ; que nui degré d’élévation ne
mettoit l’homme au deflùs des revers ; qu’il y avoit
des calamités pour toutes les conditions ; & l’on
rapportoit du fpeétacle cette grande leçon^ de mo-
deftie & de confiance,
Tout mortel eft charge de fa propre douleur.'
Les grecs (avoient qu’il y avoit partout des hommes
imprudents , pamonnés , coupables, ou par
une erreur volontaire, ou par un mauvais naturel :
mais ce qu’il importoit de leur apprendre , c’eft que
dai|.les rois l’imprudence, la paffion, l’erreur, ou
la méchanceté avoient des effets effrayants & des
(lûtes épouvantables ; & ils Ce retiraient du (pec^
tacle avec cette grande leçon de. prudence & de
politique ,
Des fautes de leurs rois les peuples font punis.
Le meme principe d’utilité morale a dû agir,
comme à notre in(u, dans la formation du nouveau
(yftême tragique : car le bon goût & le bon efprit
ne (ont qu’un ; & plus les hommes (ont éclairés, plus
leurs plaflîrs (ont raifonnables. Dans la peinture des
dangers & des malheurs où les pallions nous engagent
, le pathétique n’a donc été que le moyen de
l’inflruétion ; & en nous faifànt frémir ou pleurer
fur le deftin de nos (èmblables la Tragédie a dû
nous faire voir par quelle impulfîon violente ou par
quel attrait infènfîble l’homme , en proie à lès parlions
, devient coupable & malheureux. Mais ici les
moyens font les mêmes pour l’héroique & pour le
populaire. Les pallions étendent leurs ravages dans
tous les états de la vie : l’exemple des dangers &
des malheurs qu’elles entraînent peut donc être pris
également dans tous les états; le fils de Brutus &
Barnewel (ont tous les deux une leçon terrible.
Aulïi ne dilputons-nous pas au Drame le mérite
qu’il peut avoir , lorlqu’à l’exemple de la Tragédie
, il placera dans le coeur humain le reftbrt des
évènements, le mobile de l’aélion. Que l’homme y
(bit malheureux par la faute , en danger par (bn
imprudence, jouet de fa propre foibleffe, viétime
de là paffion ; ce genre , avec moins de fplendeur ,
de dignité, d’élévation que la Tragédie , ne 1 aillera
pas que d’avoir là bonté poétique & là bonté morale.
Il ne demande point ce génie exalté, qui exagère
avec vrailèmblance , qui agrandit & embellit tout ;
mais il demande un efprit jufte & pénétrant, un
oeil obfèrvateur, une imagination viv e, une lènli-
bilité profonde, l’Eloquence du ftyle , & le talent
de l’imitation.
Le mauvais Drame eft donc celui qui roule firr
des accidents dont l’homme eft la viétime (àns en
être la caùle. Une calamité , un malheur domestique
, un accident funefte, qui vient d’une caufè
étrangère, ne prouve r ien , n’inftruit & n’avertit
de rien. Le fpeétateur en eft affligé , mais d’une
triftelïè ftérile ; & c’eft ce qui la,rend pénible : car,
à Ce confulter loi-même, on trouvera que cet intérêt
qu’on a pris à un fpedacle uniquement funefte,
n’eft autre choie que le Sentiment d’un malheur auquel
on ne voit ni préfèrvatif ni remède ; & la vérité
inutilement affligeante qui nous en refte & qui nous
pourluit quand rillulion eft dilflpée, c’eft de penftr
qu’il y a au monde une infinité d’êtres (buffrants
qui n’ont pas mérité leur fort.;
II eft bien vrai que l ’auteur a loin 4e ménager
pour le dénouement quelque bel ai^e de bienfai-
lance , qui vient tirer du précipice les perlônnages
intéreffants. Mais on ne fait que trop que c’eft là le
roman de la (ociété , & que le refte en eft l’hiftoire.
Il arrive quelquefois que le Drame nous fait ad-r
mirer dans le malheur la férénité ? la confiance, le
courage
courage de la vertu ; qu il nous fait aimer la candeur,
la modeftie, & la fierté d’une innocence îpcor-
ruptible. Mais quoiqu’un exemple lî touchant ait Son
attrait & fon utilité, il faut que les hommes qui
ont le plus étudié la nature & l’art, n’ayent pas juge
ce moyen d’inftruire & de corriger aifez puillant,
puifqu-aucun d’eux n’a cru que l’interet de 1 admiration
, de la bienveillance, & de la pitié put remplir
l’objet du fpedacle. Attaquer le vice, par la
crainte du ridicule & de la honte; le crime , par
l ’effroi des remords qui l’alïiègent & du chaument-
qui le fuit ; les pallions , par la peinture des tourments
des dangers , des malheurs qui les accompagnent
; voilà les grands effets du Théâtre. Sa
Morale relïèmble aux lois , qui preferivent & qui
menacent. L ’émulation de l’exemple eft le plus
foible de fes moyens. Le Drame ayant donc renoncé
au ridicule, que Térence lui-même a cru
devoir mêler au pathétique de l’Andriène, il ne lui
relie plus que les moyens de la Tragédie, la terreur
& la c.ompaffion; & l’une & l’autre n eft làlutaire,
comme on vient de le voir, qu’au tant que le malheur
eft caufé par le crime & le fait détefter, ou
par la paffion & nous avertit de la craindre. Mais
alors le Drame eft bien loin de pouvoir être la
reflburce d’un homme làns talent, d’un mauvais
écrivain, d’un barbouilleur qui (è croit peintre.
L’invention d’un fujet pathétique & moral, populaire
& décent, ni trivial ni roman efqife, & dont
la Angularité conferve l’air du naturel le plus lîmple
& le plus commun ; la conduite d’une aétion qui
doit être d’autant plus vive , qu’elle ne fera Soutenue
par aucun des preftiges de i’illulion théâtrale,
& d’autant plus adroitement nouée & dénouée^que
les filsoen font mieux connus; jjne imitation prélen-
tée tout à côté de fon modèle, & dont la moindre
invraifèmblance ferait frappante pour tous les yeux ;
des moeurs bourgeoifes ou populaires a peindre
(àns groffièreté, làns balle lie , & pourtant avec 1 air
de la vérité ; un langage lîmple & du ton de la
.choie & des perlbnnages, mais correét, mais facile
& pur, na ïf, ingénieux , (ènfîble , énergique lorf-
qu’il doit l’être , jamais forcé, jamais plus haut que
le fùjet ; des caraétères à deffiner, à combiner, à
(butenir, où l’innocence, la vertu, la bonté, Ibnt ce
qu’il y a Ae plus façile à peindre : car le mélange
des vertus & des vices , d’un heureux naturel &
d’un mauvais penchant, d’un fond d’honnêteté que
Sa contagion de l’exemple altère & commence.»
corrompre, un choc de pallions contraires ou d’inclinations
oppofées, font de bien autres difficultés :
voilà ce qui paffe les forces du'commun des faifèurs
de Drame. Mais ce qui les paffe encore plus , c’eft
l’art de rendre le crime (upportable dans un (pec-
lacle populaire ; car il eft là dans toute (à baflèffe
& avec toute là noirceur. Il tarde à chaque inftant de
le voir traînera la grève; & dès qu’on l’a mis (ùr la
foène, il n’y a pas d’autre moyen décent de l’en faire
fortir, que de l’envoyer au gibet.
Çes difficultés réunies ont fait prendre à la foule
e t L ïttérat. Tome I. Partie IL
des Dramaturgesle parti plus commode 4e tirer tout
leur pathétique des accidents de la vie commune;
& leur aélion réduite en pantomime les dilpenle
du loin d’écrire & de la peine de penlèr.
Leur théorie roule lur deux erreurs : l’uriO, que
tout ce qui intéreflè eft bon pour le théâtre ; l’autre ,
que^ tout ce qui relïèmble à la nature eft beau, &
que l’imitation la plus fidèle eft toujours la meilleure.
-■
Rien de plus intérelïànt, je l’avoue, que de voir
dans une malure une famille honnête, délaiffée , 8c
réduite aux dernières extrémités de la misère & da.
délèlpoir. Vous êtes sûr de déchirer les coeurs, d’arracher
des (ànglots de tout un auditoire & de le
noyer dans (ès larmes , avec les cris de ces enfants
qui demandent du pain à leur malheureux père , &
avec les larmes d’une mère qui voit (on nourriflbn ,
pour qui les fburces de la vie ont tari, prêt à expirer
dans fon fèin. Mais quel eft le peuple féroce dont
un pareil (peâacle fera l ’amufement ? Quel plaifîc
peut nous faire l’image d’un malheur fans fruit, où
l’homme eft viéiime paffive, où fa volonté ne peut
rien .? Affligez-moi , mais pour m’inftruire , mais
pour m’apprendre à me garantir du malheur dont
je (üis témoin. Montrez-moi, j’y confènts, une famille
défblée ; mais dont la ruine & le malheur
foient caufés, par un vice ,.par une paffion funefte ,
dont le germe (bit dans mon coeur. La liqueur dont
vous m’abreuvez eft amère ; je le veux bien, pourvu
qu’elle (oit falutaire , & que la crainte & la prudence
(oient la fuite de la pitié. La douleur que m’aura
caufée un (peâacle affligeant doit être fbulagée par
la réflexion : & ce (bulagement confifte à pouvoir
me dire à moi-même que l’homme eft libre d’éviter
le malheur dont je viens de voir la peinture; que
le v ic e , la paffion, l’imprudence, la foibleffe qui
en eft la caufe , n’eft pas un mal néçeflàire ; & que
je puis moi-même m’en préfèrver ou m’en guérir.
Mais d’une grêle, d’un incendie, d’un accident
funefte qui fait des malheureux, quelle eft pour ma
penfée la réflexion confblante ? & de quoi l ’amertume
du (èntiment que le (pedacle in’a laiffé, eft-
ellç le contrepoifbn ?
Un exemple va me faire entendre. Il dépendoifc
de M. de Voltaire de rendre infiniment plus pitoyable
& plus touchante la (îtuation de l’Enfant prodigue.
Il a écarté de la (cène precïfément tout ce
qu’un faifèr.r de Drame y auroit mis, Pourquoi cela-?
parce que dans (ès principes & dans fon plan il ne
s’agilïbit pas d’employer un art fuperflu à rendre
intereffantes l’indigence & la faim, mais de tirer
le pathétique d’une fîtuatipn morale, de rendre Salutaire
l’exemple d’un jeune homme a qui (à facilite s
fa foibleffe, & l’attrait du mauvais exemple, ont fait
préférer iles plaifirs du vice au bonheur que lui
offrait un amour vertueux. Ses reflexions , (ès regrets,
(à douleur, le fond d honnêteté & de delir»
cateffe qui refte dans fes (èntiments , la honte qui
l’accable , l’efpérance qui le Soutient, l’amour que
le malheur & le remords ont fait revivre dans fon;
Mmmra