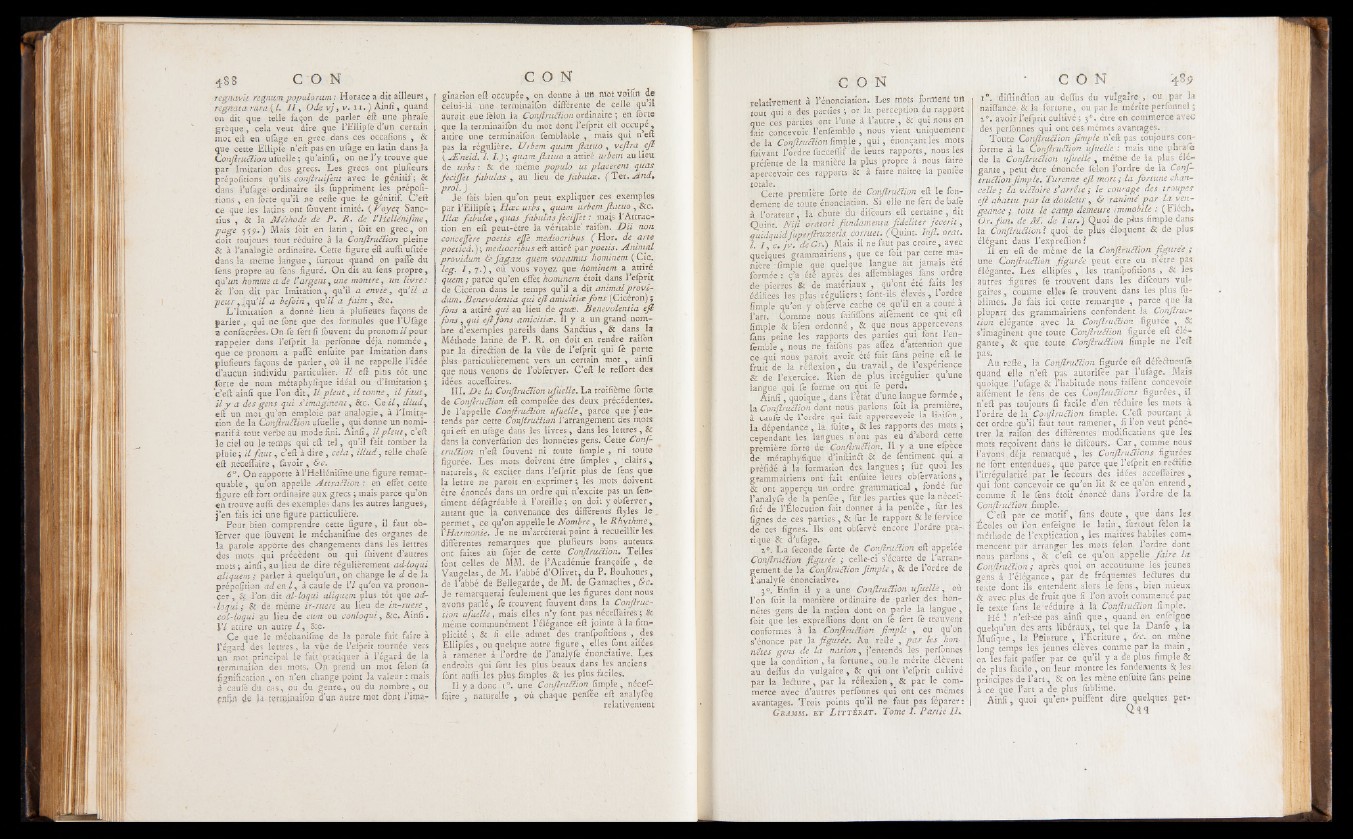
regnavit regnum populo rum: Horace a dit ailleurs,
regnata rura( l. II, Ode v j, v. 11. ) Ainfî , quand
on dit que telle façon de parler eft une phrafo
grèque , cela veut dire que l’Ellipfe d’un certain
mot eft en ufoge en grec dans ces occafîons , &
que cette Ellipfè n’eft pas en ufoge en latin dans la
Confirucîion ufuelie ; qu’ainfî, on ne l’y trouve que
par Imitation des grecs. Les grecs ont plusieurs
prépofîtions qu’ils confiruifent avec le génitif; &
dans l’ufogè ordinaire ils fuppriment les prépofî-
tions , en forte qu’il ne refte que le génitif. C’eft
ce que les latins ont fouvent imité. ( Poye^ Sanc-
lius , & la Méthode de P. R. de V Hcllénifme,
page 5$9.) Mais foit en latin, foit en g r e c, on
doit toujours tout réduire à la Confirucîion pleine
& à l’analogie ordinaire. Cette figure e'ft aufii ufitée
dans la même langue, fortout quand on paffe du
fens propre au fons figuré. On dit au fons propre,
qu’«/2 homme a de L’argent, une montre, un livre :
& l’on dit par Imitation, qu’il a envie, qu’il a
peur, .-[qu’i/ a befoin, qu’z7 a faim , &c.
L ’Imitation a donné lieu à plufîeurs façons de
parler , qui ne font que des formules que l ’Ufàge
a confocrées. On fo .fort fi fouvent du pronom il pour
rappeler dans l’efprit la perfonne déjà nommée,
que ce pronom a paffé enfiiite par Imitation dans
plufieurs façons de parler, où il ne rappelle l’idée
d’aucun individu particulier. Il eft plus tôt une
forte de nom métaphy.fique idéal ou d’imitation ;
c ’eft ainfî que l’on dit, I l pleut, il tonne, il faut,
il y a des gens qui s’imaginent, &c. Ce i f illud,
eft un mot qu’o'n emploie par analogie, à l’Imitation,
de la Confirucîion ufuelie, qui donne un nominatif
à tout verbe au mode fini. Ainfî, il pleut, c’eft
le ciel ou le temps qui eft t e l, qu’il fait tomber la
pluie; il faut, c’eft à dire , cela \ illud, telle chofo
eft néceffaire , fàvoir g &c.
6 °. On rapporte à l’Hellénifme une figure remarquable
, qu’on appelle Attraction : en effet cette
figure eft fort ordinaire aux grecs ; mais parce qu’on
en trouve aufîi des exemples dans les autres langues-,
j’en fais ici une figure particulière.
Pour bien comprendre cette figure, il faut observer
que fouvent le méchanifine des organes de
la parole apporte des changements dans les lettres
des mots qui précèdent ou qui foivent d’autres
mots ; ainfî, au Jieu de dire régulièrement ad-loqui
aliquemy parler à quelqu’un, on change le d de la
prépofition ad en / , à caufe de 17 qu’on va pronon-
ç e r , & l’on dit al-loqui aliquem plus tôt que ad-
-loqui y 8c de meme ir-ruere au lieu de in-ruere,
çoL-loqifi au lieu de cum ou. conlo.qui, &ç. Ainfî .
17 attire un autre l , &c.
Ce que le méchanifine de la parole fait faire à
l’égard des lettres, la vue de l’efprit tournée vers
un mot principal Je fait ^pratiquer à l’égard de la
terminaifon des mots, On prend un mot folon fa
fitmification , on n’en change point la valeur : mais
à caufè du cas , ou du genre, ou' dû nombre , ou
çnfin de }a tçrmjnaifon d’un autre mot dont l’imaginatïon
eft occupée, on donne à un mot voififl de
celui-là une terminaifon différente de celle au il
auroit eue folon la Confirucîion ordinaire ; en. forte
que la terminaifon du mot dont l’efprit eft occupe ,
attire une terminaifon fomblable , mais qui n’eft
pas la régulière. Uibem quam ftatuo , vefira efi
(. Æne'ui. L. I.) ; quam fiatuo a attiré urhem au lieu
de urhs : 8c de même populo ut placèrent quas
feciffet fabulas , au lieu de fabulæ. ( Ter. And*
Je fais bien qu’on peut expliquer ces exemples
par l’Ellipfo ; Hoec urbs, quam urbem fiatuo , & c.
ILLce fabulez y quas fabulas fecijfet : mais l ’Attraction
en eft peut-être la véritable’ raifon. DU non
concejfere poetis ejfe mediocribus ( Hor. de arte
poëtica. ) ; mediocribus eft attiré par poetis. Animal
providum & fagaoc qitem vocamus hominem ( Cic.
leg. / , 7 .) , ou vous voyez que hominem a attiré
quem y parce qu’en effet hominem étoit dans l’efprit
de Cicéron dans le temps qu’il a dit animai providum.
JBenevolentia qui efi amicitice fons (Cicéron) ;
fons a attiré qui au lieu de quee. Benevolentia efi
fions, qui efi fons amicitice. Il y a un grand nombre
d’exemples pareils dans Sanétius, & dans la
Méthode latine de P. R. on doit en rendre raifon
par la diredion de la Vue de l’efprit qui fo porte
plus particulièrement vers un certain mót , ainfî
que nous venons de l’obforver. C’eft le reffort des
idées a c c e f f o i r e s .
III. De la Confirucîion ufuelie. La tcoifîème forte,
de Confirucîion eft compofëe des deux précédentes.
Je l’appelle Confirucîion ufuelie, parce que j’entends
par cette Confirucîion l’arrangement des mots
qui eft en ufoge dans les livres , dans les lettres , &
dans la converfâtion des honnêtes gens. Cette Conf-
trucîion n’eft fouvent ni toute fimple , ni toute
figurée. Les mots doivent être fimples , clairs,
naturels, & exciter dans l’efprit plus de fons que
la lettre ne paroît envexprimer; les mots doivent
être énoncés dans un ordre qui n’excite pas un fon-
timent défàgréable à l’oreille ;. on doit y obferver ,
autant que la convenance des différents ftyles le
permet, ce qu’on appelle le Nombre, le Rhythme ,
ŸHarmonie. Je ne m’arrêterai point à recueillir les
différentes remarques que plufieurs bons auteurs
ont faites au fujet de cette Confirucîion. Telles
font celles de MM. de J’Académie françoifo , de
Vaugelas, dç M. l’abbé d’Olivet, du P, Bouhours,
de l ’abbé de Bellegarcje, de M. de Gamaches, &ç.
Je remarquerai feulement que les figures dont nous
avons parlé, Ce trouvent fouvent dans la Confiruç-
tion ufuelie, mais elles n’y font pas néceftairës ; &
même communément l’élégance eft jointe a la fim-
plicité ; & fi elle admet des tranfpofîtions , _ des
Ellipfos, pu quelque autre figure , elles font aifees
à ramener à l’ordre de l’analyfo enonciative. Les
endroits qui font les plus beaux dans les anciens
font aufli les plus fimples & les plus faciles.
Il y a donc i°. une Confimctïon fimple, nécefo
fifire , naturelle , où çhaque penfée eft analyfée
relativement
relativement à l’énonciation. Les mots forment utl
tout qui a des parties ; ot la perception du rapport
que ces parties ont l’une à l’autre , &" qui nous en
fait concevoir lienfemble , nous vient uniquement
de la Coiiftruclion fimple , q u i, énonçant les mots
fuivant l’ordre fîicceflïf de leurs rapports, nous les
préfente de la manière la plus propre à nous faire
apercevoir ces rapports & à faire naître la penfée
Cette première forte de Confirucîion efl le fondement
de toute énonciation. St elle ne fort de bafè
à l’orateur, la chute du difeours efl certaine, dit
Quint. Nifi oratori fiendamenta fidditer jecerit,
qiddquidfiiperfirùxeris. corruet. ('Quint. Infi. ornt.
I. I, c. jv. de Gr.) Mais il ne faut pas croire, avec
quelques grammairiens, que ce foit par cette manière
-fimple que quelque langue ait jamais été
formée: c’a été après des. aifemblages,fans-ordre
de pierres & de matériaux , qu’ont été faits les
édifices les plus réguliers; font.ils élevés, l’ordre
fimple qu’on y obfèrve cache ce qu’il en a coûté a
l’art. Comme nous faififfons aifément ce qui efl
fimple & bien ordonné , & que nous appercevons
fans peine les rapports des parties qui font 1 en-
iemble , nous ne faifons pas allez d’attemion que
ce qui nous paroît avoir etc-fait fons peine eft le
fruit de la réflexion, du travail, de 1 expérience
& de l’exercice. Rien de plus irrégulier qu’une
langue qui fo forme ou qui fo perd.
Ainfî , quoique , dans l’état d’une, langue formée,
la Confirucîion dont nous parlons foit la première,
à caufo de l’ordre qui fait appercevoir la liaifon,
la dépendance , la fuite, & les rapports des mots ;
cependant les langues n’ont pas eu d’abord cette
première forte de Confiruéîion. Il y a une efpèce
de métaphyfique d’inftinâ: & de fontiment qui a
préfidé à la formation des langues ; fur quoi les
grammairiens ont fait enfiiite leurs obforvations,
& ont apperçu un ordre grammatical , fondé^ f u r
l’analyfo de la penfoe , fiir les parties que la n e c e f -
fité de l’Élocution fait donner à la penfée , fur les
lignes de ces parties , & f u r le rapport & le forvice
de ces lignes. Ils ont obforvé encore l’ordre p r a r .
tique & d’ufoge.
î °. La foconde forte de Confirucîion eft appelée
Confirucîion figurée ,* celle-ci s’écarte de 1 arrangement
de la Confirucîion fimple, & de 1 ordre de
l’analyfo énonciative.
3°. Enfin il y a une Confirucîion ufuelie, où
l’on fuit la manière ordinaire de parler des honnêtes
gens de la nation dont on parle la langue,
foit que les expreffions dont on fo fort fo trouvent
conformes à la Confirucîion fimple , ou qu’on
s’énonce par la figurée, Au refte , par les honnêtes
gens de la nation, j’entends les perfonnes
que la condition , la fortune, ou.le mérite élèvent
au deiïus du vulgaire , & qui ont l’efprit cultivé
par la leéture , par la réflexion, & par le commerce
avec d’autres perfonnes qui ont ces mêmes
avantages. Trois points qu’il ne faut pas féparer:
Cramm. et L ittérat. Tome I. Partie IL
i° . diftinétioîl au defius du vulgaire , ou par la
naiflance; & la fortune, ou par le mérite perfonnel ;
x°. avoir i’efprit cultivé; 30* être eh commerce avec
des perfonnes qui ont ces, mêmes avantages.
Toute Confirucîion fimple n’eft pas toujours conforme
à la Confirucîion ufuelie : mais une phrafo
de la Confirucîion ufuelie , même de la plus ele-
gante, peut être énoncée folon l’ordre de la Conf-
trucîion fimple. Turenne efi mort y la fortune chancelle
y la victoire s’arrête y le courage des troupes
efi abattu par la douleur, & ranimé par la vengeance
y tout le camp demeure immobile : (Fiéch.
Or. fun. de M. de Tur.) Quoi de plus fimple dans
la Confirucîion l quoi de plus éloquent & de plus
élégant dans l’expreflion ?
11 en eft de même de la Confirucîion figurée y
une Confirucîion figurée peut être ou n’être pas
élégante. Les ellipfes , les tranfpofîtions , & les
autres figures fo trouvent dans les difeours vulgaires
, comme • elles fo trouvent dans les plus fii-
blimes. Je fais ici cette remarque , parce que la
plupart des grammairiens confondent la Confiruc-
tion élégante avec la Confirucîion figurée ^ &
s’imaginent que toute Confirucîion figurée eft élégante,
& que toute Confirucîion fimple ne l’efï
pas.A
u refte, la Confirucîion figurée eft défeâueufo
quand elle n’eft pas autorifée par l’ufoge. Mais
quoique l’ufàge & l’habitude nous faflènt concevoir
aifément le fons de ces Confirucîions figurées, il
n’eft pas toujours fi facile d’en réduire les mots à
l’ordre de la Confirucîion fimple. C’eft pourtant à
cet ordre q'u’il faut tout ramener, fi l’on veut pénétrer
la raifon des différentes modifications que les
mots reçoivent dans le difeours.- Car, comme nous
l’avons. déjà remarqué , les ConflruBions figurées
ne font entendues, que parce que l’efprit en reéfifie
l’irrégularité par le focours des idées accefloires ,
qui font concevoir ce qu’on lit & ce qu’on entend,
comme fi le fons étoit énoncé dans l’ordre de la
Confirucîion fimple.
C’eft par ce mo tif, fons doute, que dans les
Écoles où l’on enfoigne le latin, fortout folon la
méthode de l’explication , les maîtres habiles commencent
par arranger les mots folon 1 ordre dont
nous parlons , & c’eft ce qu’on ‘appelle faire la
Confirucîion y après quoi on accoutume les jeunes
gens à l’élégance, par de fréquentes leéhires du
texte dont ils entendent alors le fons, bien mieux
& avec plus de fruit que fi l’on avoit commencé pan
le texte fons le réduire à la Confirucîion fimple.
Hé ! n’eft-ce pas ainfî que , quand on enfoigne
quelqu’un des arts libéraux, tel que la Danfo , la
Mufîque, la Peinture , l’Écriture , &c. on mène
long temps les jeunes élèves comme par la main ,
on les fait pafler par ce qu’il y a de plus fimple &
de plus facile, on leur montre les fondements & les
principes de l’art, & on les mène enfuite fons peine
à ce que l’art a de plus foblime.^
Ainfî, quoi qu’en« puilfent dire quelques per-
Q q q