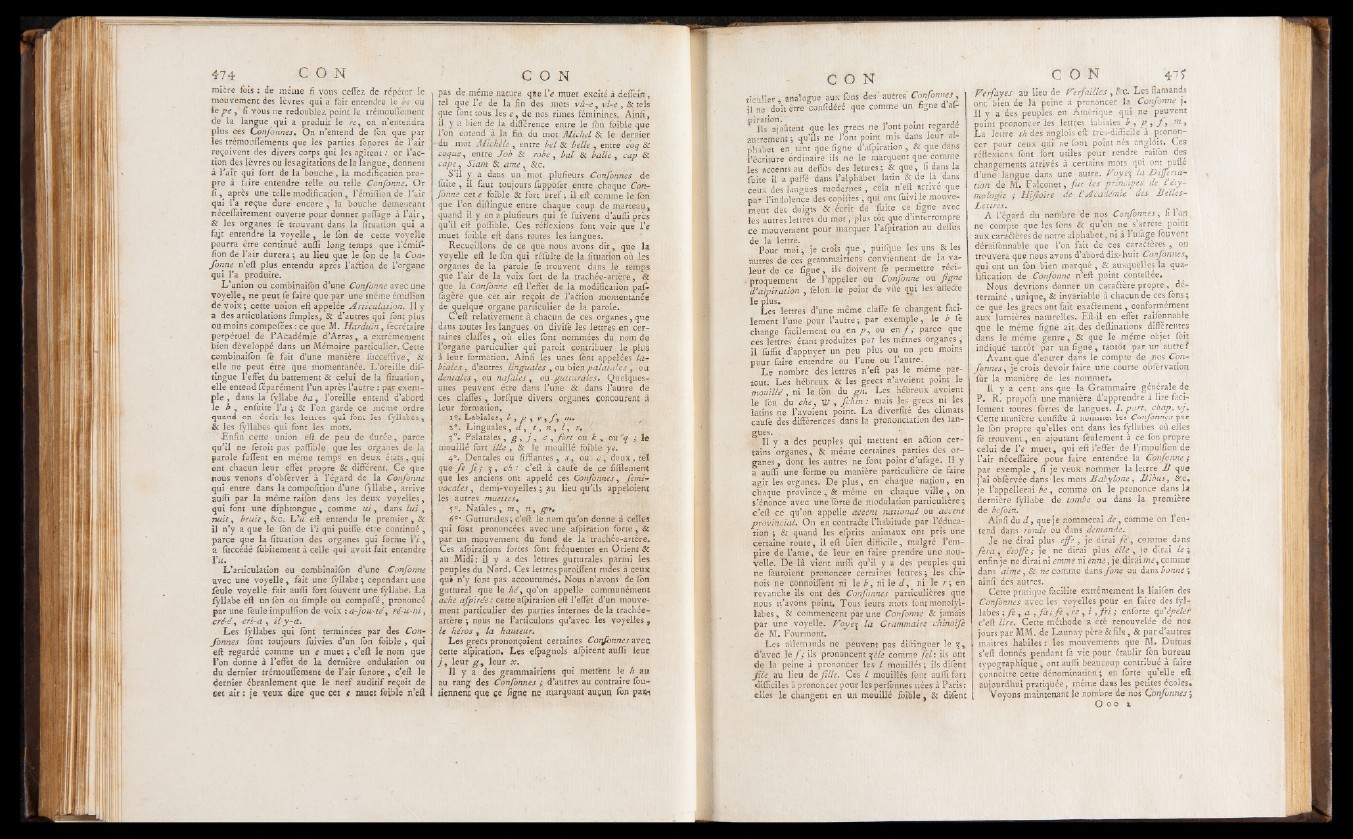
mière fois : de même fi vous c e f l e z de répéter le
mouvement des lèvres qui a fait entendre le be ou
le pe, fi vous ne redoublez point le trémoufiement
de la langue qui a produit le rey on n ’ e n t e n d r a
plus oes Confonnes• On n’entend de f o n que par
les trémouflèments que les parties fonores de l’air
reçoivent des divers corps qui les agitent : or l’action
des lèvres ou les agitations de la Tangue, donnent
à l’air qui fort de la bouche , la modification propre
a faire entendre telle ou telle Conforme. Or
fi , après une telle modification, l’émiffion de l ’air
qui l’a reçue dure encore , la bouche demeurant
nécefïairement ouyerte pour donner paffàge à l’air,
& les organes fe trouvant dans la fituation qui a
fajt entendre la voyelle , le fon de cette voyelle
pourra être continué auffi long temps que i’emif-
lion de l’air durera ; au lieu que le fon de la Con-
fonne n’eft plus entendu après l’aCtion de l’organe
qui l’a produite.
L’union ou combinaifon d’une Confonne avec une
voyelle, ne peut le faire que par une même émiffion
de voix; cette union eft appelée Articulation. Il y
a des articulations fîmples, & d’autres qui font plus
ou moins compofees : ce que M. Harduin, fecrétaire
perpétuel de l’Académie d’Arras, a extrêmement
bien développé dans un Mémoire particulier. Cette
combinaifon fo fait d’une manière foçceffive, &
elle ne peut être que momentanée. L’oreille distingue
l’effet du battement & celui de la fituation,
elle entend Séparément l’un après l’autre : par exemple
, dans la fÿllabe ba, l’oreille entend d’abord
le b , enfoite Va ; & l’on garde ce même ordre
quand on écrit les lettres qui font les fÿllabés,
& les fÿllabés qui font les mots.
1 -Enfin cette - union eft de peu de durée, parce
qu’il ne foroit pas poffible que les organes de la
parole fuflènt en même temps en deux états, qui
ont chacun leur effet propre & différent. Ce que
nous venons d’obforver à l’égard de la Confonne
qui entre dans la compofition d’une fÿllabe, arrive
auffi par la même raifon dans les deux voyelles,
qui font une diphtongue, comme ui, dans lui ,
TW.it ^ bruit, &c. L’zi eft entendu le premier , &
il n’y a que le fôn de l’i qui puiffè être continué ,
parce que la fituation des organes qui forme l’i ,
a fiiccedé fiibitement à celle qui avoit fait entendre
Vu.L
’articulation ou combinaifon d’une Conforme
avec une voyelle, fait une fÿllabe ; cependant une
foule voyelle fait auffi fort fouvent une fÿllabe. La
fÿllabe eft un fon ou fîmple ou compofé, prononcé
par Une foule impulfion de voix : a-jou~te\ ré-u-ni,
eré-é, cri-a , il-y-a.
Les fÿllabés qui font terminées par des Conformes
font toujours fuiviés d’un fon fbible , qui
eft regardé comme un t muet ; c’eft le nom que
l ’on donne à l’effet de la dernière ondulation ou
du dernier trémouffement de l’air fonore , c’eft le
dernier ébranlement que le nerf auditif reçoit de
cet air ; je veux dire que cet * muet faible neft
pas de même nature que Ve muet excité à deflein ,
tel que Ve de la fin des mots vu-e, vi-e , & tels
que font tous les e, de nos rimes féminines. Ainfî,
il y a bien de la différence entre le fon foible que
l’on entend à la fin du mot Michel & le dernier
■du mot Michèle, entre bel & belle , entre coq &
coque, entre Job & robe, bal & balle , cap &
cape, Siam & ame, &c.
S’il y a dans un 'mot plufieurs Confonnes de
fuite, il faut toujours foppofer entre chaque Conforme
cet e foible & fort bref ; il eft comme le fon
que l’on difiingue entre chaque coup de marteau%
quand il y en a plufieurs qui fo fuivent d’auffi près
qu’il eft poffible. Ces réflexions font voir que Ve
muet foible eft dans toutes les langues.
Recueillons de ce que nous avons d it, que la
Yoyelle eft le fon qui réfolte de la fituation ou les
organes de la parole fo trouvent dans le temps
que l’air de la voix fort de la trachée-artère, &
que la Confonne eft l’effet de la modification pafo
fagère que cet air reçoit de l’aCüori momentanée
de quelque organe particulier de la parole.
C’eft relativement à chacun de ces organes , que
dans toutes les langues on divifo les lettres en certaines
claffès, où elles font nommées du nom de
l’orgarie particulier qui paroit contribuer le plus
à leur formation. Ainfî les unes font appelées /æ-
biales , d’autres linguales , ou bien palatales , ou
dentales , ou nafales, ou gutturales. Quelques-
unes peuvent être dans l’une & dans l’autre de
ces claffes , lorfque divers organes concourent à
leur formation.
i £. Labiales, b , p , v , ƒ*, m.
z°. Linguales, </, t, ■«, / , r. f-
3°. Palatales, g , j , c , fort ou k , ou'q ,* le
mouillé fort ille , & le mouillé foible ye.
4°. Dentales ou fifflantes , s , o u . c , doux , tel
que fi Jî ; ch: c’eft à caufo de ce fifflement
que lés anciens ont appelé ces Confonnes, fim i-
vocales, demi-voyelles ; au fieu qu’ils appeloient
les autres muettes•
5°. Nafales, m, « , grt.
6°’ Gutturales ; c’eft le nom qu’on donne à celles
qui font prononcées avec une afpiration forte , &
par un mouvement du fond de la trachée-artère.
Ces afpirations fortes font fréquentes en Orient &
au Midi: il y a des lettres gutturales parmi les
peuples du Nord. Ces lettres paroiffent rudes à ceux
qui n’y font pas accoutumés. Nous n’avoris de fon
guttural que le he\ qu’on appelle communément
ache afpirée : cette afpiration eft l’effet d’un mouvement
particulier des parties internes de là trachée-
artère ; nous ne l’articulons qu’avec les voyelles f
le héros, la hauteur.
Les grecs prononçoient certaines Cordonnes avec
cette afpiration. Les efpagnols afpirent auffi leur
y , leur g , leur x.
Il y a des grammairiens qui mettent le h au
au rang des Confonnes ; d’autres au cpntraire fou-
tienpent que çe figne ne marquant auçup fon pa^i
ticulier , analogue aux ions des' autres' Confonnes ,
il ne doit être eonfidéré que comme un figne d af-
piration. .
Ils ajoutent que les grecs ne 1 ont point regarde
autrement ; qu’ils ne l’ont point mis dans leur alphabet
en tant que figne d’afpiration , & que dans
l’écriture ôrdinairë ils ne le marquent que Comme
les accents au deffits des lettres ; & que, fi dans la
fuite il a paffé dans l’alphabet latin & de là dans
ceux des langues modernes , cela neft arrive que
par l’indolence des copiftes , qui ont fùivile mouvement
des doigts & écrit de fuite ce^ ligne avec
les autres lettres du mot, plus tôt que d’interrompre
ce mouvement pour marquer l’afpiration au deffus
de la lettre.
Pour moi, je crois que , puifque les uns & les
autres de ces grammairiens conviennent de la valeur
de ce figne, ils doivent fo permettre réci-
• proquement de l’appeler ou Confonne ou figne
d’alpiratiôn , félon le point de vue qui les afféde
le plus. .
Les lettres d’une même clafTe fo changent facilement
l’une pour l’autre ; par exemple, le b fo
change facilement ou en p , ou en f ; parce que
ces lettres étant produites par les mêmes organes ,
il foffit d’appuyer un peu plus ou un peu moins
pour faire entendre ou l’une ou l’autre. |
Le nombre des lettres n’eft pas le même partout.
Les hébreux & les grecs n’avoient point le
mouillé, ni le fon du gn. Les hébreux avoient
le fon du che, W , fehin : mais les grecs m les
latins ne l’avoient point. La diverfîte des climats
caufo des différences dans la prononciation des langues.
?» ‘
Il y a des peuples qui mettent en adion certains
organes, & même certaines^ parties des organes
, dont les autres ne font point d’ufâge. Il y
a auffi une forme ou manière particulière de faire
agir les, organes. De plus, en chaque nation, en
chaque province, & même en chaque v ille , on
s’énonce avec une forte de modulation particulière ;
c ’eft ce qu’on appelle accent national ou accent
provincial. On en contrade l’habitude par l’éducation
; & quand les efprits animaux ont pris une
certaine route, il eft bien difficile, malgré l’empire
de l’ame, de leur en faire prendre une nouvelle.
De là vient auffi qu’il y a des peuples qui
ne fàuroient prononcer certaines lettres ; les chinois
ne cônnoifTent ni le b, ni le </, ni le r ; en
revanche ils ont des Confonnes particulières que
nous rç’avons point. Tous leurs mots font monofÿl-
labes, & commencent par une Confonne & jamais
par une voyelle. Voyé^ la Grammaire chinoife
de M. Fourmont.
Les allemands ne peuvent pas diftinguer le
d’avec le f; ils prononcent \èle comme fel : ils ont
d.e la peine à prononcer les l mouillés; ils difont
file au fieu de fille. Ces l mouillés font auffi fort
difficiles à prononcer pour les perfonnes nées à Paris:
elles le changent en un mouillé foible, & difont
Verfayes au lieu de Verfailles , &c. Les flamands
ont bien de la peine à prononcer k Confonne j.
Il y a des peuples en Amérique qui ne peuvent
point prononcer les lettres labiales b , p ^ f , m *
La lettre ,th des anglois eft très-difficile à prononcer
pour ceux qui ne font-, point nés angldis. Ces
réflexions font fort utiles pour rendre raifon des
changements arrivés à certains mots qui ont paffé
d’une langue' dans une autre. Voye\ lu Diffenation
de M . Falconet, fur les principes, de Véiy-
mplogie i Hifloire de VAcadémie des Belles-
Lettres. \ :Vi, ' ,
A l’égard du norhbre de nos Confonnes■, filmt
ne compte que les fons & qu’on ne s arrête point
aux caraôères de notre alphabet, ni à l’ufâge fouvent
déraifonnablê que l’on fait de ces caractères , on
trouvera que nous avons d’abord dix-huit Confonnes,
qui ont un fon bien marqué , & auxquelles la qualification
de Confonne n’eft point conteftée.
Nous devrions donner un caractère propre, déterminé
j unique, & invariable à chacun de ces fons ;
ce que les grecs ont fait exactement, conformément
aux lumières naturelles. Eft-il en effet raifonnable
que le même figne ait,des deftinations différentes
dans le même genre, & que le même objet foit
indiqué tantôt par un figne, tantôt par un autre ?
Avant que d’entrer dans le compte de nos Con-
fi&nnes, je crois devoir faire une courte obforvation
fur la manière de les nommer.
Il y a cent ans que la Grammaire générale de
P. R. propofà une manière d’apprendre à lire facilement
toutes fortes de langues. I. part. chap. vj.
Cette manière confîfte à nommer les Confonnes par
le fon propre qu’elles ont dans les fÿllabés ou elles
fo trouvent, en ajoutant feulement à ce fon propre
celui de Ve muet, qui eft l’effet de l’jmpulfion de"
l’air nécefiaire pour faire entendre la Confonne ;
par exemple, fi je veux nommer la letrre B que
j’ai obfèrvée dans‘les mots Babylone , Bibus., &c.
je l’appellerai be , comme on le prononce dans la
dernière fÿllabe de tombe ou dans la première
de befoin.
Ainfî du d , que je nommerai de, comme on l’entend
dans ronde ou dans demande.
Je ne dirai plus effe , je dirai fe\ comme dans
fera, étoffe; je ne dirai plus elle , je dirai le ;
enfin je ne dirai ni emme ni enne, je dirai me, comme
dans aime, & «e comme dan s folie ou dans bonne ;
ainfî des autres.
Cette pratique facilite extrêmement la liaifon des
Confonnes avec les voyelles pour en faire des fÿllabés
; ƒ<?, a t fa; fi sre , i fri ; enforte qu’épeler
c’eft lire. Cette méthode a été renouvelée de nos
jours par MM. de Launay père & fils, 6c par d’autres
î maîtres habileè : les mouvements que M. Dumas
: s’eft donnés pendant fa vie pour établir fon bureau
typographique , ont auffi beaucoup contribué à faire
connoître cette dénomination ; en forte qu’elle eft
aujourdhui pratiquée, même datas les petites écoles.
Voyons maintenant Je nombre de nos Confonnes ;
O o o z