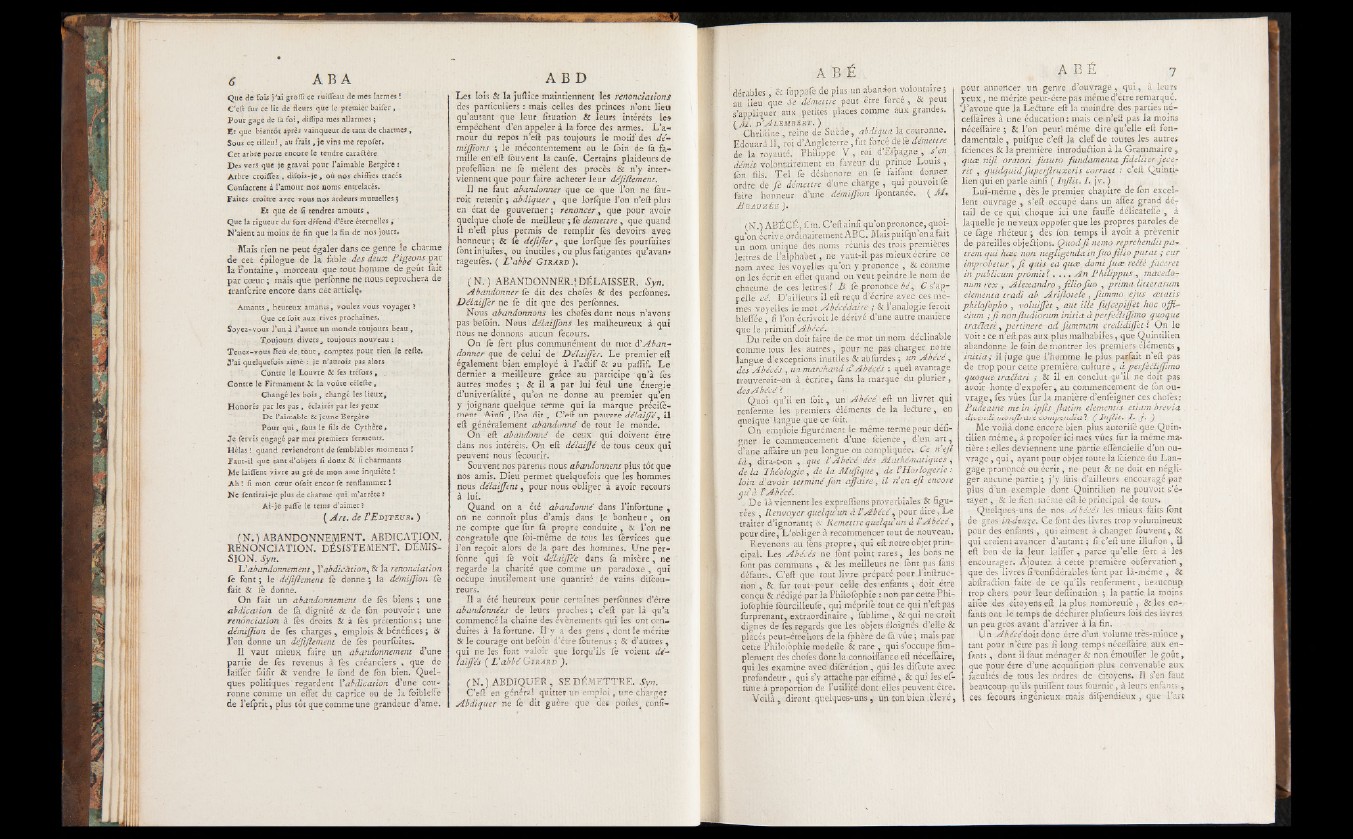
6 A B A
Que de fois j'ai groflî ce ruifleati de mes larmes !
Ce.ft fur ce lie de fleurs que le premier baifer ,
Pour gage de fa foi, diflïpa mes aliarmes ;
Et que bientôc après vainqueur de tant de charmes ,
Sous ce tilleul, au frais, je vins me repofer.
Cet arbre porte encore le tendre cara&ère
Des vers que je gravai pour l’aimable Bergère :
Arbre croiflcz , difois-je, où nos chiffres tracés
Confacrent à l’amour nos noms entrelacés.
Faites croître avec vous nos ardeurs mutuelles 5
Et que de fi tendres amours ,
Que la rigueur du fort défend d’être éternelles j
N ’aient au moins de fin que la fin de nos jours.
Mais rien ne peut égaler dans ce genre le charme
de cet épilogue, de la fable des d eux Pigeons par
la Fontaine, .morceau que tout homme de goût fait
par coeur ; mais que perfônne ne nous reprochera de
tranferire encore dans cet artielq.
Amants , heureux amants, voulez vous voyager ï
Que ce foit aux. rives prochaines. '
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau ,
Toujours, divers, toujours nouveau :
Tenez-vous fieu de. tout, comptez pour; rien ,1c relie.
J’ai quelquefois aimé- : je n’aurois pas alors
Contre le Louvre 5c fes tréfors, .
Contre le Firmament 5c la voûte célefte f
Changé les bois , change les lieux j
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable 8c jeune Bergère
Pour qui, fous le fils de Cy chère;
Je feirvis engagé par mes premiers ferments.
Hélas ï quand reviendront de femblables moments I
Faut-il que tant d’objets fi doux & fi charmants
Me Liftent vivre au gré de mon ame inquiète !
Ah I fi mon coeur ofoit encor fe renflammer !
Ne fentirai-je plus de charme qui m’arrête î
Ai-je paffé le teins d’aimer î
( A r t . de V E d it e u r , )
(N .) ABANDONNEMENT. ABDICATION.
R ENON CIATION. DÉSISTEMENT. DÉMISSION.
Syn.
U abandonnement, Y abdication, & la renonciation
fe font ; le déjijlement fè donne ; la démijjion fè
fait & fè donne.
On fait un abandonnement de fès biens ; une
abdication de fa dignité & de fôn pouvoir ; une
renonciation à fès droits & à fès prétentions ; une
démijjion de fès charges, emplois & bénéfices ; &
l ’on donne un déjijlement de fès pourfùites.
Il vaut mieux faire un abandonnement d’une
partie de fès revenus à fès créanciers , que de
laifîer fàifir & vendre le fond de fôn bien. Quelques
politiques regardent Y abdication d’une couronne
comme un effet du caprice ou de la foibleîîe
de l ’efprit, plus tôt que comme une grandeur d’aine.
A B D
Les lois & la juftice maintiennent les renonciations
des particuliers : mais celles des princes n’ont lieu
qu’autant que leur fituation & leurs intérêts le»
empêchent d’en appeler à la force des armes. L ’amour
du repos n’eft pas toujours le motif des dé-
mijjions ; le mécontentement ou le foin de fa famille
en efl fou vent la caufè. Certains plaideurs de
profeffïon ne fè mêlent des procès & n’y interviennent
que pour faire acheter leur déjiflement.
Il ne faut abandonner que ce que l’on ne fàu-
roit retenir ; abdiquer , que lorfque l’on n’eft plus
en état de gouverner; renoncer, que pour avoir
quelque chofe de meilleur ; fè demettre, que quand
il n’eft plus permis de remplir fès devoirs avec
honneur; & fe déjijler, que lorfque fès pourfùites
fôntinjuftes, ou inutiles , ou plus fatigantes qu’avan*
tageufès. ( U abbé G ira rd );
(N . ) ABANDONNER.'DÉLAISSER. Syn.
Abandonner fè dit des chofès & des perfônnes.
DélaiJJer ne fè dit que des perfônnes.
Nous abandonnons les chofès dont nous n’avons
pas befôin. Nous délaiffons les malheureux à qui
nous ne donnons aucun fecours.
On fè fèrt plus communément du mot & Abandonner
que de celui de DélaiJJer. Le premier eft
également bien employé à l’ad if & au paflif. Le
dernier a meilleure grâce au participe qu’à fès
autres modes ; & il a par lui fèul une énergie
d’univerfàlité, qu’on ne donne au premier qu en
y joignant quelque terme qui la marque precife-
. ment. Airifî , l’on dit , C ’eft un pauvre délaiffé, il
eft généralement abandonné de tout le monde.
On eft abandonné de ceux qui doivent être
dans nos intérêts. On eft délaiffé de tous ceux qui
peuvent nous fècourir.
Souvent nos parents nous abandonnent plus tôt que
nos amis. Dieu permet quelquefois que les hommes
nous délaijjent, pour nous obliger à avoir recours
à lui.
Quand on a été abandonné dans l’infortune ,
on ne connoît plus d’amis dans le bonheur , on
lie compte que fur fà propre conduite, & l’on ne
congratule que foi-même de tous les fervices que
l’on reçoit alors de la part des hommes. Une perfbnne
qui fè voit délaijfée dans fà misère, ne
regarde la charité que comme un paradoxe , qui
occupe inutilement une quantité de vains difeou-
reurs.
Il a été heureux pour certaines perfônnes d’être
abandonnées de leurs proches ; c’eft par là qu’a
commencé la chaîne des évènements qui les ont conduites
à la fortune. ITy a des gens , dont le mérite
& le courage ont befôin d’être fourenus ; & d’autres ,
qui ne les font valoir que lorqu’ils fè voient dé-
laijfés ( U abbé G ir a rd ) .
(N .) ABDIQUER, SE DÉMETTRE. Syn.
C ’eft en général quitter un emploi, une charge:
Abdiquer ne fè dit guère que de* poftes( confi-
A B É A BÉ 7
durables, & fuppofe de plus un abandon volontaire ;
au lieu que Se demeure peut être forcé , & peut
s’appliquer aux petites places comme aux grandes.
(M . d A lembert. )
ChrilHne, reine de Suède, abdiqua la couronne.
Edouard II, roi d’Angleterre, fut force dé Ce demeure
de la royauté. Philippe V , roi d’Efpagpe , s’en
démit volontairement en faveur du prince L ouis ,
lôn fils. T e l le déshonore en le failànt donner
ordre de f e démettre d’une charge , qui_pmivoit.fi
a /h>mtiïinn fDontan.ee. ( if/.
(N.) ABÉCÉ, f. m. C ’eft ainfî qu’on prononce, quoiqu’on
écrive.ordinairement ABC. Mais pu ifqu’on a fait
un nom unique des noms réunis des trois premières
lettres de l’alphabet, ne vaut-il pas mieux écrire ce
nom avec les voyelles qu’on y prononce , & comme
on les écrit en effet quand on veut peindre le nom de
chacune de ees lettres ? B fè prononce |||; C s’appelle
cé. D’ailleurs il eft reçu d’écrire avec ces mêmes
voyelles le mot Abécédaire ; & 1 analogie fèroit
bleffée, fi l’orr écrivoit le dérivé d’une autre manière
que le primitif Abécé. ._ ■ . ■ _
Du refte on doit faire de ce mot un nom déclinable
comme tous les autres , pour ne pas charger notre
langue d’exceptions inutiles & abfùrdes un A bé cé ,
des Abécés, , un marchand dé Abécés quel avantage
trouveroit-on à écrire, fans la marque du plurier,
des A b é cé ? ^ .
Quoi qu’il en foit, un Abécé eft un livret qui
renferme les premiers éléments de la leéture, en
quelque' langue que ce foit.
On emploie figurément le même terme pour défi-
gner le commencement d’une fcience, d’un art,
d’une affaire un peu longue ou.compliquée;.: Ce n’ejl
là,, dira-.t-on , . que VAbécé’ des Mathématiques ,
de la Théologie, de la Mujzque, de VHorlogerie :
loin d[avoir terminé fon affaire, i l n en ejl encore
qu\ïVAbécé... . . .
. De là viennent les expreflions proverbiales & figurées
, Renvoyer quelquun à VAbécé, pour dire, Le
traiter d’ignorant; & Remettre quelquun à VAbece,
pour dire, L ’obliger à recommencer tout de nouveau.
Revenons au fens propre i, qui eft notre objet principal.
Les Abécés ne font point rares, les bons ne
font pas communs , & les meilleurs ne font pas fans
défauts. C ’eft que tout livre .préparé pour l ’inftruc-
tion , & fur tout pour celle des enfants , doit être
conçu & rédigé par la Philofôphie : non par cette Phi-
lofophie fôurcilleufè, qui méprifè tout ce qui n’eft pas
fùrprenant, extraordinaire -, fùblime , & qui ne croit
dignes de fès regards que les objets éloignés d’elle &
placés peut-être hors delà fphère de fà vue ; mais par
cette Philoiôphie modefte & rare , qui s’occupe fim-
plement des chofès dont la connoifïànee eft nécefïàire,
qui les examine avec diferétion, qui les difeute avec
profondeur , qui s’y attache par eftimé , & qui les ef-
time à proportion de l’utilité dont elles peuvent être.
V o ilà , diront quelques-uns, un ton bien .élevé,
pour annoncer un genre d’ouvrage, qui, à leurs
yeux, ne mérite peut-être pas même d’être remarqué.
‘J’avoue que la Le&ure eft la moindre des parties né-
cefîàirës à une éducation: mais ce n’pft pas la moins
nécefïàire ; & 1/on peut] même dire qu’elle eft fondamentale
, puifque c’eft la clef de toutes les autres
fciences & la première introduction à la Grammaire ,
quae nifi oratori Juturo futidamenta fidelïier jece-
rit , quidquid fuperjlruxeris corruet : c’eft Quinti-
lien qui en parle ainfi ( Iiijlit. I. jv. )
Lui-même , dès le premier chapitre de fôn excellent
ouvrage , s’eft occupé dans un afîèz grand dé7
tail de ce qui choque ici une fauffe déiicateffe , à
laquelle je neveux oppofèr que les propres paroles de
ce fàge rhéteur ; dès fôn temps il a voit à prévenir
de pareilles objections. Quodjî nemo reprehenditpa-
trem qui hæc non negligenda in fu o jilio putat ; cur
improbetur Ji. quis ea quæ domi Juæ rectè faceret
in puhlicum prom itl. . . . A n Philippus , macedo-r
num rex , Alexandra yJîlio fuo , prima Huer arum
elementa tradi ab Arijlotele , Jurnmo ejus oetatis
philofopho , voluiffet, aut Me fujàepiffet hoc offi-
cium ; Ji nonJludiorum initia à perj'ecliffimo quoque
traclari, percmere—ad fummam çredidiffet l On le
voit : ce n’eft pas aux plus malhabiles, que Quintilien
abandonne le foin dé montrer les premiers éléments ,
initiai il juge que l ’homme le plus parfait n’eft pas
de trop pour cette' première, çulturé ,• à perj'eclijjîmo
quoque traclari y & il en- conclut qu’il ne doit pas
avoir honte d’exp.ofèr, au commencement de fôn ouvrage,
fès vues fur la manière d’enfèigner ces chofès:
Pudeatne me in ipjis Jlatim elementis etiam brévia
; dicendi monjlrare compendia ? ( ïnjlit. I. j . J
Me voilà donc èncoré bien plus autorife que. Quintilien
même, à propofèr ici mes vues fur la même ma-
j tière : elles deviennent une partie efîèncielle d’un ouvrage
, qui, ayant pour objet toute la fcience du Langage
prononcé ou écrit, ne peut & ne doit en négliger
aucune partie ; j’y fuis d’ailleurs encouragé par
plus d’un exemple dont Quintilien ne pouvoit s’étayer
j & le fien même eft le principal de tous.
Quelques-uns de nos; Abécés les mieux faits font
de gros in-dod\e. Ce font des livres trop volumineux
pour des enfants , qui aiment à changer fôuvent, &
qui croient avancer d’autant ; fi. c’eft une illufiqn , il
eft bon de la leur laifîer, parce qu’elle fèrt à les
encourager. Ajoutez à cette première obfèrvaîion ,
que des livres fi 'confidéràblës font par là-même , &
abftraCfion faite de ce qu’ils renferment, beaucoup,
trop chers pour leur dèftination ; la partie, la moins
ailée des .citoyens eft la plus nombreufè , & les en-•
fahts ont le temps .de déchirer plufieurs fois des livres
un peu gros avant d’arriver à la fin.
Un Abécé font donc être d’un volume très-mince ,
tant pour ri’être pas fi long temps nécefïàire aux enfants
, dont il faut ménager & non émouflèr le goût,
que pour être d’une acquifition plus convenable aux
facultés de tous les ordres de citoyens. Il s’en faut
beaucoup qu’ils puifiènt tous fournir, à leurs enfants,
ces fècours ingénieux mais difpendieux , que l’arc