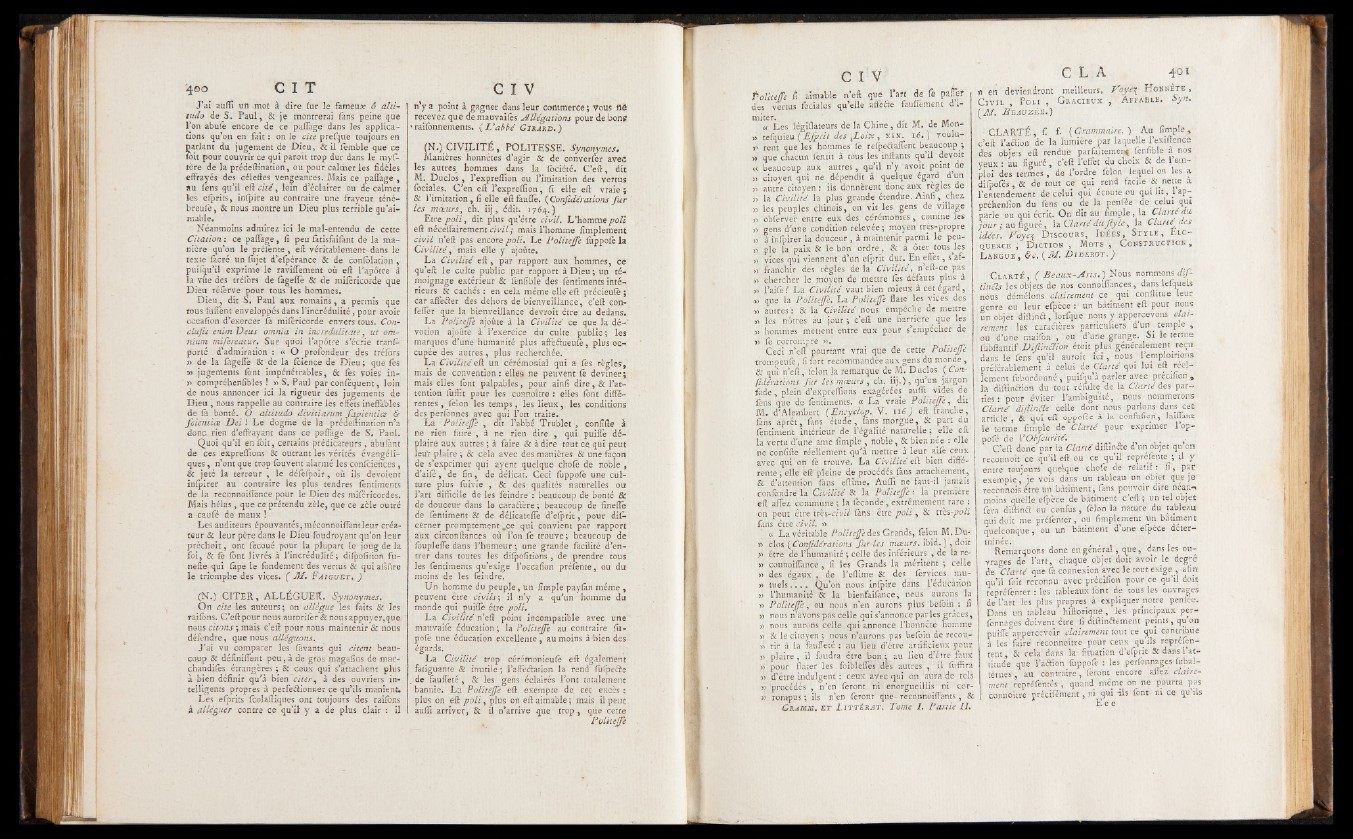
4©o C I T
J’ai auffi un .mot à dire fur le fameux? à ald-
tudo de S. Paul, & je montrerai fans peine que
l ’on abufo encore de ce pafïàge dans les applications
qu’on eir fait : on le cite prefque toujours en
parlant du jugement de Dieu, & il fomble que ce
loit pour couvrir ce qui paroît trop dur dans le mystère
de la prëdeftination, ou pour calmer les fidèles
effrayés des céleftes vengeances. Mais ce pafïàge ,
au fens qu’il eft cité, loin d’éclairer ou de calmer
les efprics, infpire au contraire une frayeur téné-
breufe, & nous montre un Dieu plus terrible qu’aimable.
Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette
Citation : ce pafïàge, fi peu fàtisfaifànt de la manière
qu’on le prélènte , eft véritablement-dans le
texte fàcré un fùjet d’efpérance & de confolation,
puifqu’il exprime'le ravinement où eft l’apôtre à
la vue des trélors de fàgefffe & de mifericorde que
Dieu réforve pour tous les hommesë
Dieu , dit S. Paul aux romains, a permis que
tous biffent enveloppés dans l’incrédulité, pour avoir
occafion d’exercer la mifericorde envers tous. Con-
clujzt enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium
mifereatur. Sur quoi l’apôtre s’écrie transporté
d’admiration : « O profondeur des tréfôrs
» de la fàgeffè & de la fcience de Dieu ; que fes
35 jugements font impénétrables, & fos voies in-
» compréhenfibles ! » S. Paul par confëquent, loin
de nous annoncer ici la rigueur des jugements de
Dieu , nous rappelle au contraire les effets ineffables
de fà bonté. O altitudo divitiarum fapitntioe &
feientioe De l l Le dogme de la prëdeftination n’a
donc rien d’effrayant dans ce pafïàge de S. Paul.
Quoi qu’il en foit, certains prédicateurs , àbufànt
de ces expreffions & outrant les vérités évangéliques
, n’ont que trop fouvent alarmé les confoiences ,
& jeté la terreur , le défofpoir , où ils dévoient
infpirer au contraire les plus tendres fontiments
de la reconnoiffànce pour le Dieu des mifericordes.
Mais hélas , que ce prétendu zèle, que ce zèle outré
a caufé de maux !
Les auditeurs épouvantés, méconnoifïàntleur créateur
& leur père dans le Dieu foudroyant qu’on leur
préchoit, ont focoué pour la plupart le joug de la
foi, & fè font livrés à l’incrédulité; difpofidon fu-
nefte qui fàpe le fondement des vertus & qui afsure
le triomphe des vices. ( M . F a ig u e t , j
(N.) C IT ER , ALLÉGUER. Synonymes.
On cite les auteurs ; on allègue les faits & les
raifons. C ’eft pour nous autorifor & nous appuyer,que
nous citons ; mais c’eft pour nous maintenir & nous
défendre, que nous alléguons.
J’ai vu comparer les lavants qui citent beaucoup
& définifïènt peu, à de gros magafîns de mar-
chandifos étrangères ; & ceux qui s’attachent plus
à bien définir qu’à bien citer, à des ouvriers intelligents
propres à perfectionner ce qu’ils manient.
Les efprits foolaftiques ont toujours des raifons
à alléguer contre ce qu’il y a de plus clair : il
c i v
n’y a point à gagner dans leur commerce ; Vous flë
recevez que demauvaifos Allégations pour de bons?
»raifonnements* (.L’abbé G ir a rd , )
(N.) C IV ILITÉ , POLITESSE. Synonymes•
Manières honnêtes d’agir & de converfer avec
les autres^ hommes dans la fociété. C ’eft, dit
M. Duclos, l ’expreflion ou l’imitation des vertus
fociales. C ’en eft l’expreftion, fi elle eft vraie ;
& l’imitation, fi elle eftfàufïè. ( Confédérations fu r
les moeurs, ch. iij , édit. 1764.)
Etre p o li, dit plus qu’être civil. L ’homme poli
eft néceffàirement civil; mais l’homme fimplement
civil n’eft pas encore poli. Le Politejfe fùppofo la
Civ ilité, mais elle y ajoute.
La Civilité e ft, par rapport aux hommes, ce
qu’eft le culte public par rapport à Dieu; un tén
moignage extérieur & fonfible des fontiments inté-i
rieurs & cachés : en cela même elle eft précieufo ;
car afteder des dehors de bienveillance, c’eft con-
fefïèr que la bienveillance devroit être au dedans.
La Politejfe ajoute à la Civilité ce que la dé-'
votion ajoute à l ’exercice du culte public; les
marques d’ùne humanité plus affèdueufo, plus ec-i
cupée des autres, plus recherchée.
La Civilité eft un cérémonial qui a fos règles,
mais de convention : elles ne peuvent fo deviner;
mais elles font palpables, pour ainfî dire, & l’attention
fiiffit pour les connoître : elles font differentes
, foion les temps, les lieux, les conditions
des perfonnes avec qui l’on traite.
La Politejfe , dit l’abbé Trublet, confîfte a.
ne rien faire -, à ne rien dire , qui puiflè déplaire
aux autres ; à faire & à dire tout ce. qui peut
leur plaire ; & cela avec des manières & une façon
de s’exprimer qui ayent quelque chofo de noble ,
d’aifé, de fin, de délicat. Ceci foppofo une culture
plus fuivie , & des qualités naturelles ou
l’art difficile de les feindre": beaucoup de bonté &
de douceur dans le caradère ; beaucoup de fineffè
de fontiment & de délicateftè d’efprit, pour discerner
promptement'0ce qui convient par rapport
aux circonftances où l’on fo trouve; beaucoup de
foupleffe dans 1-humeur•; une grande facilité d’entrer
dans toutes les difpofitions , de prendre tous
les Sentiments qu’exige l’oecafîon préfonte, ou du
moins de les feindre.
Un homme du peuple, un fîmple payfàn même ,
peuvent être civils; il n’y a qu’un homme du
monde qui puiflè être poli,
La Civilité n’eft point incompatible avec une
mauvaifo éducation ; la Politejfe au contraire fù-
pofo une éducation excellente, au moins à bien des
égards.
La Civilité trop cérémonieufo eft également
fatiguante & inutile ; l’affedation la rend fufpede
. de fauffeté, & les gens éclairés l ’ont totalement
bannie. La Politejfe eft exempte de cét excès :
plus on eft p o li , plus on eft aimable; mais il peut,
auffi arriver, & il n’arrive que trop, que cette
Politejfe
c I V
Politejfe fi aimable n’eft que l’ art de fie palier
des vertus fociales qu’elle affefle fauflëment d’i-
miter.
« Les légiflateurs de la Chine, dit M. de Mon-
» tefquieu ( Ejprit des %L o ix , x ix . i 6i )r voulu-
rent que les hommes fo refpedaffent beaucoup ;
» que chacun Sentit à tous les inftants qu’il devoit
« beaucoup aux autres, qu’il n’y avoit point de
» citoyen qui ne dépendît à quelque égard d un
>•> autre citoyen: iis donnèrent donc aulx règles de
» la Civilité la plus grande étendue. Ainfi, chez
» les peuples chinois, on vit les gens de village
» obSérver entre eux des cérémonies , comme les
» gens d’une condition relevée ; moyen très-propre
» à infpirer la douceur, à maintenir parmi le peu-
», pie la paix & le bon ordre, & à ôter tousses
» vices qui viennent d’un efprit dur. En effet, s’af-
>y franchir des règles de la Civilité ^ n’eft-ce pas
»V chercher le moyen de mettre fos defauts plus à
» l’aiSe? La Civilité vaut bien mieux à cet égard,
» que la Politejfe, La Politejfe flate les vices des
» autres': & la Civilité nous empêche de mettre
» les nôtres au jour; c’eft une barrière que les
»•hommes mettent entre eux pour s’empêcher de
» fo. corrompre ». ■ • .
Ceci n’eft pourtant vrai que de cette Politejfe
trompeufo, fi fort recommandée aux gens du monde,
& qui n’eft, félon là remarque de M. Duclos ( Con-
fidérations fur les moeurs , ch. iij.)? qu’un jargon
fade, plein d’expreffions exagérées auffi vides de
fons que de fontiments. « La vraie Politejfe, dit
M. d’Alembert (Encyclop.^V. 116 ) eft franche,
fans aprêt, fans étude, fàns morgue, & part du
fontiment intérieur de l’égalité naturelle ; d ie eft
la vertu d'une ame fîmple , noble, & bien nee r elle
ne confîfte réellement qu’à mettre à leur dfo ceux
avec qui on fo . trouve. La Civilité eft bien differente
; elle eft pleine de procédés fàns attachement,
& d’attention fàns eftime. Auffi ne faut-il jamais
confondre la Civilité & la Politejfe : la première
eft affez commune ; la féconde, extrêmement rare :
on peut être trhs-rCivil fàns être p o li , & très -poli
fàns être civil. »
« La véritable Politejfe des Grands, félon M. Du-
» „des ( Conjidérations fu r les moeurs, ibid. ) , doit
» être de l’humanité ; celle des inférieurs , de la re-
» connoiffance , fi les Grands la méritent ; celle
» des égaux , de l ’eftime & des forvices mu-
» tuels. . . . Qu’on nous infpire dans l’éducation
» l’humanité & la bienfaifànce, nous aurons la
» Politejfe, oü nous n’en aurons plus befbin : fi
» nous n’avons pas celle qui s’annonce par les grâces,
» nous aurons celle qui annonce l’honncte homme
» & le citoyen ; nous n’aurons pas befoin de recou-
>S rir à la fauffeté : au lieu d’être artificieux pour.
» plaire , il faudra être bon ; au lieu d’être faux
» pour flater les foibleffes des autres , il fuffira
. d’ être indulgent : ceux avec qui on aura de tels
» procédés , n’en foront ni enorgueillis ni cor-
» rompus ; ils n’en foront que- reconnoiffants, &
Gramm, et L it té ra t, Tome I. Partie II,
C L A 401
» en deviendront meilleurs. C Voye\ Honnête, ivil , Poli , Gracieux , Affable. S y n ,
( M . JSe a u z é e . )
C L A R T É , C f. ( Grammaire. ) Au fîmple ,
c’eft l’aâion de la lumière par laquelle l ’exiftence
des objets eft rendue parfaitement fonfible à nos
yeux : au figuré, c’eft l’effet du choix & de 1 emploi
des termes , de l’ordre félon lequel on les a
difpofés, & de tout ce qui rend facile 8^ nette a
l’entendement de celui qui écouté ou qui lit, 1 ap-
préhenfion du fons ou de la penfée de celui qui
parle ou qui écrit. On dit au fîmple, la Clarté du.
jour ,* au figuré, la Clarté du Jlyle, la Clarté des
idées. Voye\ Discours, Idées, Style, Eloquence
, Diction , Mots , Construction,
Langue, &c. ( M , D id e r o t . )
Clarté, ( B e a u x -A n s .) Nous n om m on s^
tincls les objets de 110s connoiffances, dans lefquels
nous démêlons clairement ce_ qui conftitue leur
genre ou leur efpèce : un bâtiment eft pour nous
un objet diftind, lorfque nous y appercevons clai-
: rement les caradères particuliers d’un _ temple ,
ou d’une maifon , ou d’une grange. Si le terme
fûbftantif .Dijlïnction étoit plus généralement^ reçu
dans le fons qu’il auroit ici , nous_ l’epiploirions
préférablement à celui de Clarté qui lui eft réellement
fubordonné, puifqu’à parler avec précifîen ,
la diftindion du tout réfuite de la Clarté des parties
: pour éviter l’ambiguité, nous nommerons
Clarté dijlincle celle dont nous parlons dans cet
article , & qui eft oppofee à la .confufion, laiffant
le terme fîmple d * Clarté pour exprimer l’op-
pofé de YObfcuriié.
C ’eft donc par la Clarté diftinde d’un objet qu on
reconnoît ce qu’il eft ou ce qu il reprefonte ; il y
entre toujours quelque chofe de relatif: fi, par
exemple, je vois dans un tableau un objet que je
reconnois être un bâtiment, fans pouvoir dire nean**«
moins quelle efpèce de bâtiment c’eft ; un tel objet
fora diftind ou confus, félon la nature du tableau
qui doit me préfonter, ou fimplement un bâtiment
quelconque, ou un bâtiment d’une efpèce déter-
minée.- , , ■ • , f
Remarquons donc en general, que, dans les ouvrages
de l’art, chaque objet doit avoir le degré
de Clarté que fà connexion avec le tout exige , afin
qu’il foit reconnu - avec préeifîon pour ce qu’il doit
repréfonter : les tableaux font de tous les ouvrages
de l’art les plus propres à expliquer notre penfée.
Dans un tableau hiftorique, les principaux per-
fonnages doivent être fi diftindement peints, qu’on
puiffe appercevoir clairement tout ce qui contribue
à les faire reconnoître pour ceux qu’ils reprefon-
tent, .& cela dans la fîtuation d’efprit & dans 1 attitude
que l’adion fùppofo : les perfonnages fubal-
ternes , au contraire, foront encore affez clairement
repréfontés’ , quand même on ne pourra pas
connoître précifément, ni qui 'iis f°nt ni ce
E e e