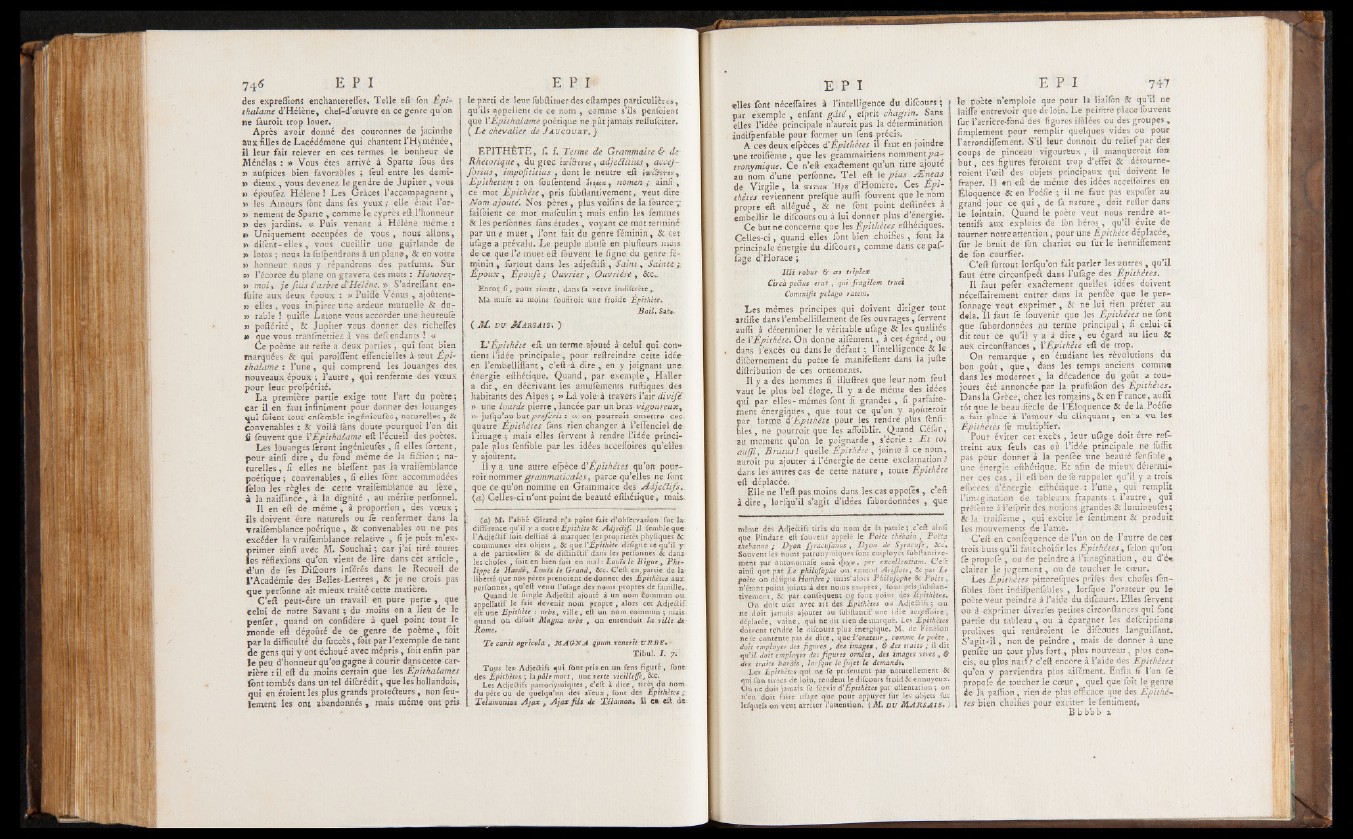
des expreffions enchanterelïès. Telle eft fan Épi-
thalame d’Hélène, chef-d’oeuYre en ce genre qu’on
ne lauroit trop louer.
Après avoir donné des couronnes de jacinthe
aux filles de Lacédémone qui chantent l’Hyménée,
il leur fait relever en ces termes le bonheur de
Ménélas : » Vous êtes arrivé à Sparte fous des
» aulpices bien favorables ; faul entre les. demi-
» dieux., vous devenez le gendre de Jupiter , vous
» époufèz Hélène ! Les Grâces l’accompagnent ,
» les Amours font dans les yeu-x ; elle étoit l’or-
» nement de Sparte , comme le cyprès eft l’honneur
» des jardins. « Puis venant à Hélène même :
*> Uniquement occupées de vous , nous allons,
» dirent-elles , vous cueillir une guirlande de
» lotos ; nous la lulpendrons à un plane, & en votre
» honneur nous y répandrons des parfums. Sur
sa l’écorce du plane on gravera ces mots : Honoreq-
» moi, j e fuis L'arbre d'Hélène. » S’adreflànt en-
itiite aux deux époux : » Puiffe Vénus , ajoûtent-
» elles, vous Înîpirer une ardeur mutuelle & du-
» rable ! puifiè Latone vous accorder une heureulè
» poftérité, & Jupiter vous donner des riehefies
» que vous tran{mettiez à vos deteendants ! «
Ce poème au relie a deux parties , qui font bien
marquées 8e qui paroilîent elfencielles à tout Epi-
thalame : l’une, qui comprend les louanges des
nouveaux époux ; l’autre , qui renferme des voeux
pour leur profpérité.
La première partie exige tout l’art du poète;
ear il en faut infiniment pour donner des louanges
qui faient tout enfemble ingénieufès, naturelles , 8e
convenables 8e voilà fans doute pourquoi l’on dit
fi lôuvent que V É p i thalame eli l’écueil des poetes.
Les louanges feront ingénieulès , lî elles lortent,
pour ainlî dire * du fond même de la fidion ; naturelles,
lî elles ne bleftènt pas la vrailèmblance
poétique ; convenables , lî elles font accommodées
félon les règles de cette vrailèmblance au lèxe,
à la naïlfance-, à la dignité, au mérite perfannel.
Il en eli de même , à proportion, des voeux ;
ils doivent être naturels ou le renfermer dans la
vrailèmblance poétique, 8c convenables ou ne pas
excéder la vrailèmblance relative , lî je puis m’exprimer
ainfî avéc M. Souchai ; car j’ai tiré toutes
les réflexions qu’on vient de lire dans cèt article,
d’un de fes Difaours inférés dans le Recueil -de
l ’Académie des Belles-Lettres, & je ne crois pas
que perlbnne ait mieux traité cette matière.
C’eft peut-être un travail en pure perte , que
celui de notre Savant ; du moins on a lieu de le
penlèr, quand on confidère à quel point tout le
monde eft dégoûté de ce genre de poème, lèit
par la difficulté du luccès, lôit par ^exemple de tant
de gens qui y ont échoué avec mépris , fait enfin par
le peu d’honneur qu’on gagne à courir danscette car»
rière : il eli du moins certain que les Êpithalamçs
font tombés dans un tel difarédit, que les hollandois,
qui en étoient les plus grands protefteurs, non lèu-
lement les ont abandonnés, mais même ont pris
le p'artï de leur fabftituer des eftampés particulier e»,
qu’ils-appellent de ce nom , comme s’ils penloient
que l’hpithalame poétique ne pût jamais relTulciter.
( Le chevalier de J au court. )
E P ITH ÈTE , C. f. Terme de Grammaire & de
Rhétorique , du grec turlS-tro? , adjeclitius , accej-
J'orius, impofititius , dont le neutre eft t-vrlShrov
Epithetum : on loulèntend oyopa, nomen ; ainfî ,
ce mot Épithète y pris fabftantivement, veut dire
Nom ajoute'. Nos pères , plus voifins de la faurce y:
faifaient ce mot mateulin ; mais enfin les femmes
8c les perlônnes lâns études., voyant ce mot terminé
par un e muet, l’ont fait du genre féminin, 8c cet
ulàge a prévalu. Le peuple abulè en plufîeurs mot$^
de ce que Ve muet eft lôuvent le ligne du genre féminin
, fartout dans les adjeftifs , Saint, Sainte &
Époux y Êpoufe ÿ Ouvrier, Ouvrière , 8cc*.
Encor fi, pour rimer, dans fa verve indiferète
Ma» mufe. au moins Couffroit une froide Epithète► .
Bail, Sac».
( M. dw M arsms-, j
L ’Épithète eft un terme ajouté a celui qui, con^
tient l’idée principale-, pour reftreindre cette idée
en l’embellifïànt, c’eft “-à dire, en y joignant une;
" énergie elihétique. Quand, par exemple, Haller
a d it, en décrivant lès amutements ruftiques des
habitants des Alpes ; » Là vole-à travers l’àir divifé
; n une lourde pierre, lancée par un bras vigoureux,
>v juIqu’au but preferit : on pourroit omettre ces,
quatre Épithètes fans rien changer à Pelïèneiel de
l ’image ; mais elles lèrvent à rendre l!idéè principale
plus lènfible. par les idées accefloires qu’elles
y ajoûtent..
II y a une autre elpèce d'Épithètes qu’on pourroit
nommer grammaticales, parce qu’elles ne lônt
que ce qu’on nomme en Grammaire des Adjectifs*,
{a) Celles-ci n’ont point de beauté elihétique, mais-.
(a) M. l’abbé Girard, n’a point fait d’obfervatioiî fur la;
différence qu’il y a entre Epithète & Adjectif. 11 femble que
l’Adjeâif foit- deftiné à marquer les propriétés phyfîques &.
communes des objets ,, & que l’Épithète défigne ce qu’il y,
a- de particulier & de diftinâif dans les perfonnes. & dan»
les chofes , foie en bien foit en mal: Louïs le Bègue , Philippe
le Hardi?,. Louïs le Grand, 8cc. G’cft. eivpartie de. la-
liberté que nos pères prenoient de donner des Épithètes aux.
perfonnes, qu’eft venu l’ufage de»noms propres de famille*..
Quand le fîmgje Adjeâif ajouté à un nom fcommun ou
appellatif le fait devenir nom propre , alors cet Adjeâif
eft une Epithète : urbs, ville, eft un nom commun ; niais,
quand on difoit Magna urbs t on entendait la y die de.
Rome. •
Te canit agricola , MAGNA qiium.veneritVRBE.
Tibul. I . p i
Tous les- Adjeâifs qui fôntpris-en un fens figuré, font
des Epithètes ; la pâle mort, une verte vicillejfe, 8Cc.
Les Adjeâifs patronymiques , c’eft à dire , tirés; du nom
du père ou de quelqu’un des aïeux, font des Epithètes »
Telamanius Ajax , Ajax fils, de Xclamon• Il c*. eft. de.
elles lônt néceiïaires à l’intelltgence du dilcours ;
par exemple , enfant gâte' , elprit chagrin. Sans ,
elles l’idée principale n’auroit pas la détermination
indilpenlàble pour former un lèns précis.
A ces deux elpèces d‘Épithètes il faut en joindre
une troifîème , que les grammairiens nomment pa-- •
tronymique. Ce n’eft exaftement qu’un titre ajouté :
au nom d’une perlônne. T e l eft le plus Æneas |
de Virgile, la kotvi# ’Hpv d’Homere. Ces Épi-.
th£tes reviennent prelque auffi lôuvent que le nom
propre eft allégué, & ne font point deftinéeS à
embellir le difeaurs ou à lui donner plus d’énergie.
Ce but ne concerne que les Épithètes efthetiques.
Celles-ci, quand elles lônt bien choifîes , font la
principale énergie du dilcours, comme dans ce paf-
fage d’Horace ;
I lli robiir & ces triplex
Circa peebus erat , qui fragilem trud
Commijit pelago ratem•
Les mêmes principes qui doivent diriger tout
artifte dans l’embellillement de lès ouvrages , lèrvent
auffi à déterminer le véritable ulage 8c les qualités
de VÉpithète. On donne aifément, à cet égard, ou
dans l’excès ou dans le défaut ; l’intelligence 8c le
dilcernement du poète lè manifeftent dans la jufte
diftributioh de ces ornements.
Il y a des hommes lî illuftres que leur nom lèul
vaut le plus bel éloge. Il y a de meme des idees
qui par elles-mêmes lônt fi grandes , fi parfaite*
ment énergiques, que tout ce qu’on y ajouteront
par forme d'Épithète pour les rendre plus lènfî-
bles , ne pourroit que les affaiblir. Quand Céfar,
au moment qu’on le poignarde , s’écrie : E t toi
auffi, Brutusl quelle Épithète, jointe à ce nom,
auroit pu ajouter à l’énergie de cette exclamation ?
dans les autres cas de cette nature , toute Epithete
eft déplacée. '
Elle ne l’eft pas moins dans les cas oppofés , c’eft à dire, lorlqu’il s’agit d’idées fabordonnées , que
tnême des Adjeâifs tirés du nom de la patrie; c’eft ainfî
que Pindare eft Couvent appelé le Poète thébain, Poïta -
thebanus ; JDyçn fyraeufanus, D.yon de Syracuje, &c.
Souvenc les noms patronymiques font employés fubftantive-
tzient par antonomafe x*ri , per excetlenùnm. C’eft
ainfî que par Le philofophe on entend Arijlote, 5c par Le
poète on défigne Homère ; mais" alors Philofophe 8c Poète ,
n’étant point joints à des noms propres, font pris fubftan-
tivement, Sc par conféquent ne font point des Épithètes.
On doit ufer avec art des Epithètes ou Adjeâifs ; on
ne doit jamais ajouter au fubftantif une idée accelFoire,
déplacée, vaine, qui ne dit rien démarqué. Les Épithètes
doivent rendre le difeours plus énergique. M. de Fénelon
ne fe contente pas de dire , que Vorateur., comme le poète ,
doit employer des figures , des images , & des traits ; il dit
eu’ ;/ doit employer des figures ornées, des images vives , &
des traits hardis," lorfque lefujet le demande.
Les Épithètes qui ne fe prèfenrent pas naturellement 8c
qui fon tirées de loin, rendent le difeours froid Se ennuyeux.
On ne doit jamais fe fervir d’Épithètes par oftèntarion ; on
n’en , doit faire ufage que- pour appuyer fur les objets fur
Jefquêls on veut atréter l’attention. ( M. DU MARS A I S. )
le poète n’emploie que pour la liaîlôn 8c qu’il ne
laiflTe entrevoir que de loin. Le peintre place lôuvent
lùr l’arrière-fond des figures ilôlées ou des groupes ,
fîmplement pour remplir quelques vides ou pour
l’arrondilTement. S’il leur donnoit du relief par des
coups de pinceau vigoureux , il manqueroit lôn
but, ces figures feroient trop d’ effet 8c détourne-
roient l’oeil des objets principaux qui doivent le
fraper. Il en eft de même des idées aceelfaires en
Éloquence 8c en Poéfîe ; il ne faut pas expolèr au
grand jour ce q u i, de fa nature, doit relier dans
le lointain. Quand le poète veut nous rendre attentifs
aux exploits de lôn héros, qu’il évite de
tourner notre attention, pour une Épithète déplacée,
fur le bruit de lôn chariot ou fur le hennilfement
de lôn couffîer.
C ’eft furtout lorlqu’on fait parler les autres , qu’il
faut être circonlpeft dans Tufage des Epithètes.
Il faut pefèr exactement quelles idées doivent
nécelîàirement entrer dans la penfée que le per—
fonnage veut exprimer, 8c ne lui rien prêter au
delà. Il faut lè louvenir que les Épithètes ne fan t
que fabordonnées au terme principal ; fi celui ci
dit tout ce qu’il y a à dire , eu égard au lieu &
aux circonftances , l’Épithète eft de trop.
On remarque , en étudiant les révolutions du
bon goût, que, dans les temps anciens comm*
i dans les modernes, la décadence du goût a toujours
été annoncée par la profufîon des Epithètes.
Dans la Grèce, chez les romains , 8c en France, aufli
tôt que le beau-fiède de l’Éloquence 8c de la.Poéfîe
a fait place à l’amour du clinquant, on a vu les
Épithètes lè multiplier.
Pour éviter cet excès , leur ulàge doit être refa
treint aux lèuls cas où l ’idée principale ne faffit
pas pour donner à la penlce une beauté fenfîble %
une énergie elihétique. Et afin de mieux déterminer
ces cas, il eft bon de le rappeler qu’il y a trois
efaèees d’énergie elihétique. : l’une, qui remplît
l’imagination de. tableaux frapants ; l’autre, qui
prélènte à l’elprit des. notions grandes 8c lumineulès;
8c la troifîème , qui excite le fentiment 8c produit
les mouvements de l’aime. /
G’eft en conlequence de l’un ou de l’autre de ces
trois buts qu’il fautchoifîr les Épithètes, félon qu’on
le propolè , ou de peindre à l’imagination , ou d’é*t
clairer le jugement, ou dé toucher le coeur.
Les Épithètes pittorelques prîtes des chofès faillibles
lônt indilpenfables , lorfque l’orateur ou le
poète veut peindre à l’aide du dilcours. Elles lèrvent
ou à exprimer dîverfes petites circonftances qui font
partie du tableau , ou à épargner les deteriptions
prolixes qui rendroient le dilcours ianguiffant.
S’agit-il, non de peindre , mais de donner à une
penfée un tour plus fqrt, plus nouveau, plus concis,
ou plus naïf? c’eft encore à l ’aide dès Epithètes
qu’on y parviendra plus aifément. Enfin fî l’on le
propofe de toucher le coeur , quel que fait le genre
de la paffion, rien de plus efficace que des Epithètes
bien choifîes pour exciter le fentiment,
B b bb b x