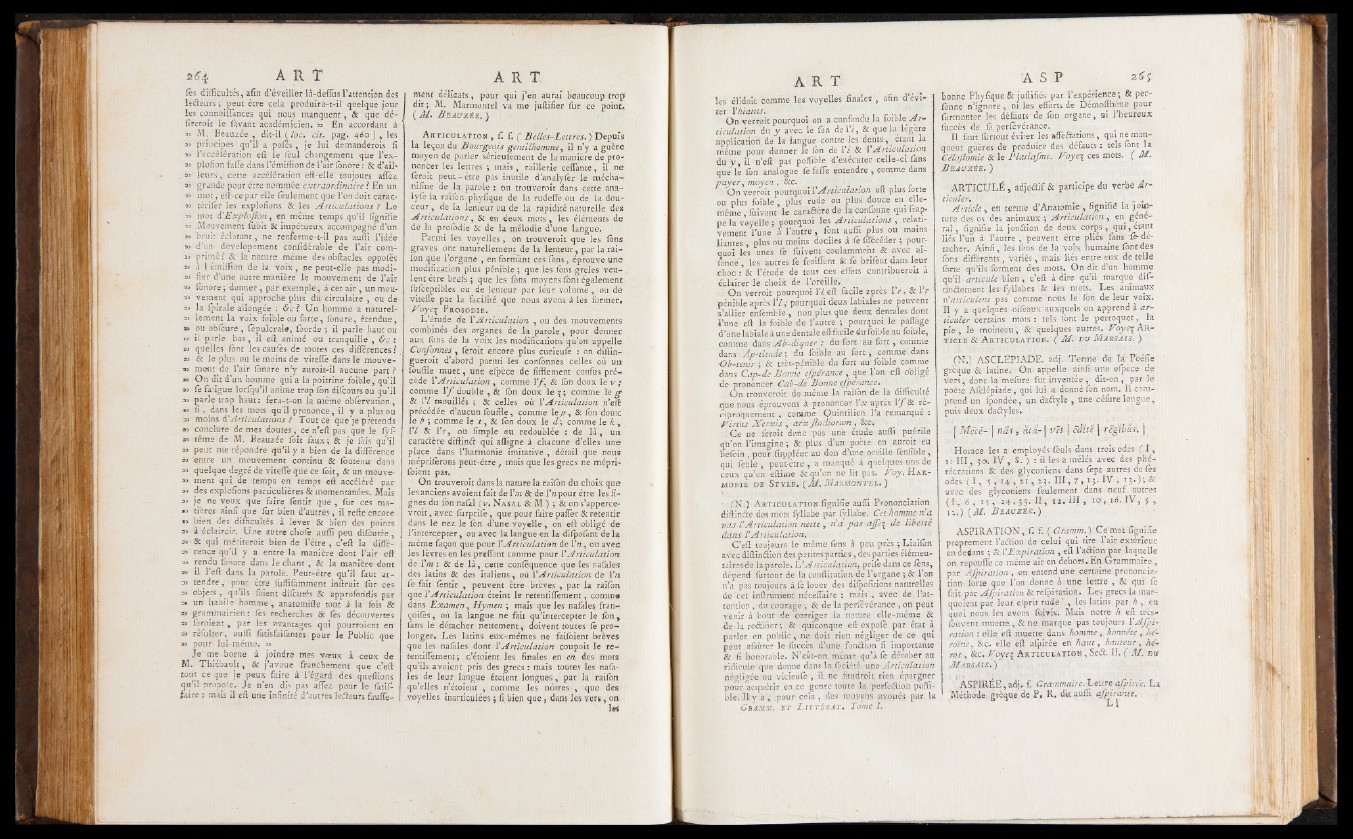
fès difficultés, afin d’éveiller là-deffus l ’attention des
ledeurs ; peut être cela produira-t-il quelque jour
les connoiffanees qui nous manquent, & que dé-
fireroit le lavant académicien. ® En accordant à
b> M. Beauzée , dit-il ( loc. cit. pag. 460 ) , les
o» principes qu’il a pôles , je lui demanderois fi
ai l’accélération eft le fèul changement que l ’ex-
oi plofion faffe dans fémiffion de l’air lonore : & d’ail-,
. as leurs, cette accélération eft-elle toujpurs allez
35 grande pour être nommée extraordinaire ? En un
35 mot, eft-ce par elle feulement que l'on doit carac-
33 térilèr les explofions & les Articulations ? Le
33 mot èV Explofion, en même temps qu’il lignifie
o> .Mouvement lubit & impétueux accompagné d’un
»» bruit éclatant, ne renferme-t-il pas auffi l’idée
»5 d’un dèvelopement confidérable de l’air com-
35 primé? & la nature, même des obftacles oppofés
35 à 1 émiffion de la v o ix , ne peut-elle pas modi-
33 fier d’une autre manière le mouvement de l’air
s> lonore ; donner, par exemple, à cet air , un mou-
33 vement qui approche plus du circulaire , ou de
33 la fpirale allongée : &c ? Un homme a naturel-
os lement la voix foible ou forte, lonore, étendue,
» ou obfeure, fépulcrale, lourde ; il parle haut ou
»» il parle bas, il eft animé ou tranquille , &c :
as quelles lont les caufes de toutes ces différences?,
as & le plus ou le moins de viteflè dans le mouve-
03 ment de l’air lonore vVy auroit-il aucune part .?
»9 On dit d’un homme qui a la poitrine foible, qu’il
os le fatigue lorlqu’il anime trop fôn difeour-s ou qu’il
33 parle trop haut: fera-t-on la même obfèrvation,
»3 fi , dans les mots quil prononce, il y a plus ou
33 moins $ Articulations ? Tout ce que je prétends
»3 conclure de mes doutes, ce n'eft pas que le fyfi
33 tême de M. Beauzée foit faux; & je fais qu’il
os peut me répondre qu’il y a bien de la différence
33 entre un mouvement continu & fôutenu dans
33 quelque degré de viteffe que ce fôit, & un mouve-
33 ment qui de temps en temps eft accéléré par
os des explofions particulières & momentanées. Mais
as je ne veux que faire fèntir que , fur ces ma-
»3 ttères ainfi que fiir bien d’autres , il refte encore
*3 bien des difficultés à lever & bien des points
33 à éclaircir. Une autre choie auffi peu dilcutée,
» -& qui mériteroit bien‘de l’être , c’eft la diffé-
3» rence qu’il y a entre la manière dont l ’air eft
33 rendu lonore dans le chant , & la manière dont
m il l’eft dans la parole. Peut-être qu’il faut at-
33 tendre, pour être fuffilàmment inftruit fur ces
33 objets , î qu ils fôient difeutés & approfondis par
3» un habile homme , anatomifte tout à la fois &
33 grammairien : fes recherches & lès découvertes
33 feraient, par les avantages qui pourroient en :
33 réfùlter ^ auffi fàtisfaifantes pour le Public que I
03 pour lui-même. 33
Je' me borne à joindre mes voeux à ceux de
M. Thiébault, & j’avoue franchement que c’eft
tout ce que je peux faire à l’égard des queftions
qu’il propose. Je n’en dis pas affez pour le làtif
feire : mais il eft une infinité d’autres ledeurs fauffeiïjent
délicats, pour qui j’èn aurai beaucoup trop"
dit ; M. Marmontel va me juftifier fur ce point.
( M B e a u z é e . )
A r t icu l a t io n , C. f. ( Belles-Lettres. ) Depuis
la leçon du Bourgeois gentilhomme, il n’y a guère
moyen de parler sérieufement de la manière de prononcer
les lettres ; mais , raillerie ceffante, il ne
lèroit peut - être pas inutile d’analylèr le mécha-,
nilme de la parole : on troüveroit dans cette analyse
la railbn phyfique de la rudeffe ou de la douceur
, de la lenteur ou de la rapidité naturelle des
Articulations, & en deux mots, les éléments de
de la profôdie & de la mélodie d’une langue.
Parmi les voyelles , on troüveroit que les fôns
graves ont naturellement de la lenteur, parla rai-
fon que 1 organe , en formant ces Ions, éprouve une
modification plus pénible ; que les fôns grêles veulent
être brefs ; que les fôns moyens font également
fùfceptibles ou de lenteur par leur volume , ou de
viteffe par la facilité que nous avons a ie s former.
V o y e \ P ro sod ie.
L ’étude de ¥ Articulation , ou des mouvements
combines des organes de la parole, pour donner
aux fôns de la voix les modifications qu’on appelle
Confonnes, fèroit encore plus curieufè : on diftin-
gueroit d’abord parmi les confônnës celles où un
fôuffle muet, une efpèce de fîfflement confus précède
l’Articulation , comme 1 ’ƒ* & fôn doux le v ,*
comme Y f'double , & fôn doux le comme le g
8t VI mouillés ; & celles ou VArticulation n’eli
précédée d’aucun fôuffle, comme le /? , & fôn doux
le b ; comme le t , & fôn doux le d\ comme le k ,
VI & l’r , ou fimpie ©u redoublée : de là , un
caractère diftinét qui affigne à chacune d’elles une
place dans l’harmonie im.itative , détail que nous
méprifèrons peut-être, mais que les grecs ne mépri-
fôient pas.
On troüveroit dans la nature la raifôn du choix que
les anciens avaient fait de Vm & de l’npour être les lignes
du fônnafàl (v. N a sal & M ) ; & on s’apperce-
vroit, avec fùrprifè, que pour faire paffèr & retentir
dans le nez le fôn d’une voyelle , on eft obligé de
l’intercepter, ou avec la langue en la difpofànt delà
même façon que pour Y Articulation de Vn, ou avec
les lèvres en les preffant comme pour VArticulation
de 1’t7z: & de là , cette confequence que les nafàles
des latins & des italiens, où VArticulation de Vn
Ce fait fèntir , peuvent être brèves , par la râîfon
queVArticulation éteint le retentifïèment, comm®
dans Examen, Hymen ; mais que les nafâleç fran-
çôifès, où la langue ne fait qu’intercepter le fôn,
fans le détacher nettement, doivent toutes fè prolonger.
Les latins eux-mêmes ne faifôient brèves
que les nafàles dont VArticulation coupoit le re-
tentifïement; c’étoient les finales en en des mots
qu’ils avoient pris des grecs : mais toutes les nafàles
de leur langue étoient longues, par la raifôn
qu’elles n’étoient , comme les nôtres , que des
voyelles inarticulées ; f^bien que, dans les vers, on
les élidoit comme les voyelles finales, afin d’évi-
ter l’hiatus. ,
On verroit pourquoi on a confondu la foible A r ticulation
du y avec le fôn de l’i , & que la légère
application de la langue contre les dents,. étant la
même pour donner le fôn de Vi & VArticulation
du ÿ , il n’eft pas poffible d’exécuter celle-ci fans
que le fôn analogue fefaffe entendre , comme dans
payer, moyen, &c. . , . _ c
On verroit pourquoi Y Articulation eft plus forte
ou plus foible, plus rude ou plus douce en elle-
même , fuivant le caradère de la confonne qui frappe
la voyelle ; pourquoi les Articulations » relativement
l’une à l’autre , font auffi plus ou moins
liantes , plus ou moins dociles à fè fuécéder ; pourquoi
les unes fè fùivent coulamment & avec ai-
fance', les autres fe froiffent & Ce brifènt dans leur
choc : & l ’étude de tous ces effets contribueroit à
éclairer le choix de l’oreille. ^ ^ }
On verroit pourquoi YL eft facile apres 1 r , & 1 r
pénible après l’/y pourquoi deux labiales ne peuvent
s’allier enfemble , non plus que deux dentales dont
l’une eft la foible de l’autre ; pourquoi le paffage
d’une labiale à une dentale eft facile du foible au foible,
comme dans Ab-dicpier ; du fort au fort, comme
dans Ap-titude ; du foible au fort, comme dans
Ob-tenïr ; & très-pénible du fort au foible comme
dans Cap-de Bonne efpérance , que 1 on eft oblige
de prononcer Cab-dè Bonne ejperance* ; J ,
On troüveroit de même la raifôn de la difficulté
que nous éprouvons à prononcer 1’-«? apres 1 f & réciproquement
, comme Quintilien l’a remarque :
yirtus Xerxis , arx Jludiorum , &c.
. Ce ne fèroit donc •pas une étude auffi puerile
qu’on l’imagine ; & plus d’un poète en auroit eu
befoin ,'pour fùppléer au don d’une oreille fenfible,
qui feule , peut-être , a manqué à quelques-uns de
ceux qu’on eftitne & qu’on ne lit pas. Foy. H a r monie
de St y l e . ( M . Ma rm on te l. )
• (N.) A r t icu l a t io n fignifie auffi Prononciation
diftinéte des mots fyllabe par fÿllabe. Cet homme n a
vas VArticulation nette , n a pas ajfe\ de liberté
dans VArticulation.
C ’eft toujours le même fèns à peu près ; Liaifôn
avec diftinâion des petites partes , desparties élémentaires
de la parole. L ’Articulation, prifè dans ce fèns,
dépend furtout de la conftitution de l’organe ; & l’on
n’a pas toujours à fè louer des difpofitions naturelles
de cet inftrument néceffaire : mais , avec de l’attention
, du courage , & de la perfévéranee , on peut
venir à bout de corriger la nature elle-même &
de la redifier; & quiconque eft expofé par état à
parler en public, ne doit rien négliger de ce qui
peut afsùrer le fùccès d’une fondion fi importante
& fi honorable. N’eût-on même qu’à fe dérober au
ridicule que donne dans la fbciété une Articulation
négligée ou vicieufe , il ne faudroit rien épargner
pour acquérir en, ce genre toute la perfedion poffible.
Il y a , pour cela , dès moyens avoués par la
6’H AMM. ET L i t t é r a t . Tome I .
bonne Phyfique & juftifiés par l’expérience; & per-
fonne n’ignore, ni les efforts de Demofthène pour
furmonter les défauts de fon organe, ni l’heureux
fùccès de fà perfévéranee. , ^
Il faut furtout éviter les affedations, qui ne manquent
guères de produire des défauts : tels font la
Céloftomie & le Pladafme. Voye\ ces mots. ( M .
B e a u z é e . )
A R T ICU LÉ , adjeâif & participe du verbe Ar-
tiçider. ' • J i . . . .
A r ticle , en terme d’Anatomie., fignifié la j 01®"
ture des os des animaux ; Articulation, en general
, fignifie la jondion de deux corps , qui, étant
liés l’un à l’autre , peuvent être pliés fans fè* détacher.
Ainfi, les fôns de la voix humainefont des
fôns différents., variés, mais liés entre eux de telle
forte qu’ils forment des mots. On dit d’un homme
qu’il articule bien, c’eft à dire qu’il marque dif—
tindement les -fyllabes & les mots. Les animaux
ri articulent pas comme nous le fôn de leur voix.
Il y a quelques oifèaux auxquels on apprend à articuler
certains mots.: tels font le perroquet, la
pie , le moineau, & quelques ’autres. Voye\ A r t
i c l e & A r t i c u l a t i o n . ( M- t>u Marsais. )
(N.) ASCLEPIADE. adj. Terme de la Poéfie
grèque & latine. On- appelle ainfi une efpèce de
vers, dont là mefure fut inventée', dit-on, par le’
poète Afclépiade, qui lui a donné fon nom. 11 Comprend
un fpondée, un dadyle , ûne célùre longue,
puis deux dadyles.
I Mëcê- | nas , ata- [ vïs | édite | rêgibüs. |
Horace les a employés lêuls dans, trois odes ( I ,
1: I I I , 30. IV , 8. ) : il les a mélés avec des phé-
récratiens & des glyconiens dans lèpt autres de Ces
odes ( 1 , 5 , 1 4 , 1 1 , 1 3 . I I I , 7> >;• IV , 13 .); &
avec des glyconiens feulement dans neuf ‘autres
, (T., 6 , 1 5 ,- 1 4 ,3 3 - 1 1 , 1 2 ,1 1 1 , 10 , id - IV , 5 ,
: r i . ) (M. B e a u z é e . )
ASPIRATION, f. f. ( Gramiri.) Ce mot fignifie
proprement l’aftion de celui qui tire l’air extérieur
en dedans ; & l’Expiration , eft l’aâion par laquelle
on repouffe ce même air en dehors.,En Grammaire,
par Âfpiration, on entend une certaine prononciation
forte que l’on donne a une lettre , & qui (e
fait par Afpiration & refpiration. Les grecs la mar-
quoient par leur elprit rude ’ , les latins par h , en
quoi nous les avons lùivis. Mais notre h eft très-
lôuvent muette, & ne marque pas toujours l'A fp iration
: elle eft muette dans homme, honnête . héroïne,
&c. elle eft alpirée en haut, hauteur, hé*
ros , ®!c. Voye\ A r t i c u l a t i o n , Sefi. II. ( M . du
3/at.sais. )
ÀSP1RÉ E , adj. f. Grammaire. Lettre afpire’e. La
Méthode, grèque de P. R. d« auffi afpirante.