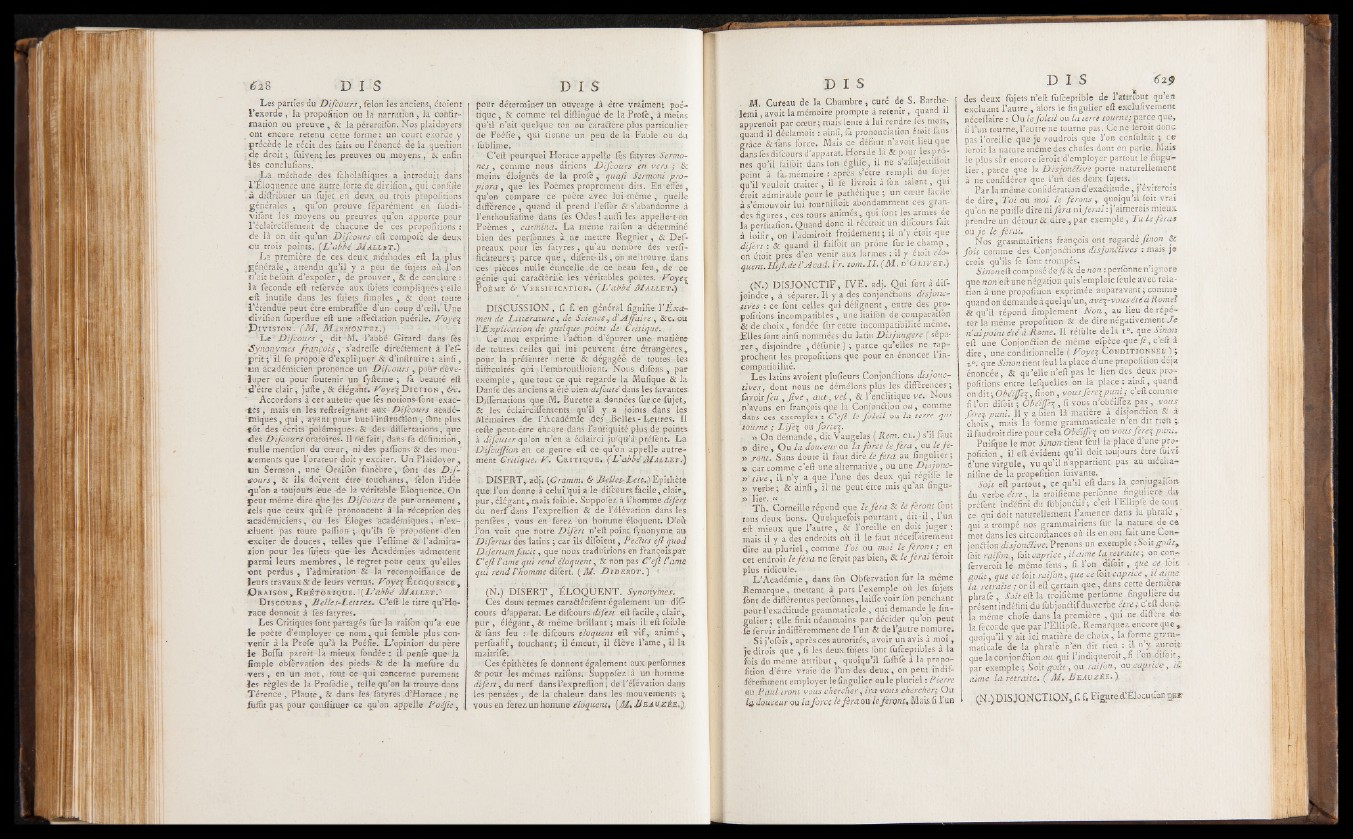
<328 D I S
Les parties du Difcours, folon les anciens, étoient
ï ’exorde , la -propofîtion du la narration, la confirmation
ou preuve, 8c la péreraifbn. Nos plaidoyers
ont encore retenu cette forme: un court exor'de y
précède le récit des faits ou l’énoncé de la queftion
J «de droit; Suivent les preuves-ou moyens , & enfin
ÎÊs conclufiôns.
La méthode des foholaftiques a introduit dansj
l ’Éloquence une autre forte, de-divlfîon, qui confîfte
à diftribuer un fujet eri deux ou trois propofitions
générales , qu’on prouve feparémènt en fubdi-:
vifânt les moyens ou preuves qu’on apporte pour
l ’éclairciffement de chacune de ces propofîtiohs :
de là on dit qu’un; D i f c o u r s eft 'compofé de deux
ou trois points.. (JL*abbé. M a l l e t .)
La premiçre de çes deux méthqdes eft la plus '
générale , attendu qu’il y a peu de. fiijets pù.^’on j
n’ait befoin d’expofor , de prouver, & de conclure : |
la féconde eft refervée aux fùjetsrcompliqués ;• elle :
«ft inutile dans les fiijets Amples , & dont toute
l ’étendue peut être émbraflee d’un coup d’oeil. Une
divifion fuperflue eft une affectation puérile, Ploy ez ;
P i v i s i o n . ( M ï M à r 'm o n t e l . ) "■ ■
L e : D i f cou f s dit ;M. -l’abbé Girard- dans fés
Sy n o n ym e s f r a n ç o i s , - s’adreffe difeCVèment à l ’ef-
prit ; il fé propOlè d’expHquèr & d’inftfüire : ainfî, .
u n académicien prononce un D i f c o u r s ^ o v î r dève- j
loper ou pour foutenir un fyfteme ; fà "beauté eft
d’être clair, ju f t e & élégant. V o y e \ D i c t i o n , & c .
Accordons à cet auteur que fés notions-font exa’6 -
le s , mais en les reftreignant aux D i f c o u r s academiques,
qui , ayant pour but-l’inftruétionfont plus
tôt des écrits polémiques» & des differtâtions, que
des Difcours oratoires. Il rfé fait, dans* fa définition, .
nulle mention du 'coeur, ni-des pàffiofts & des- mou-'
arements que l’orateur doit y exciter. Un Plaidoyer ,
*m Sermon , une Oraifon funèbre', (ont des D i f - -
t o u r s , 8c ils, ddivent être tbu'Chânts, félon l ’idée
qu’on a toujours’ feue -de là véritable Éloquente^ On
peut même dire qué lés D ifc o 'ù r s dè pur ornement, i
tels que ceux qui-fe prononcent à la-réception dés ;. !
académiciens , ou les Éloges académiques , n’e-x- j
cluent pas toute paffiôn-;. qu’ils fé prdpéfont-d’en •
exciter de douces, telles que l’éftime-& l’admira-
ïion pour les fiijets que les Académies admettent
parmi leurs membres , le regret pour ceux qu’elles
ont perdus , l’admiration & la réconnoifîànce dé
leurs travaux & de leurs vertus. V ô ÿ e \ É l o q u e n c e ,
O r a ï s ô n , R h é t o r i q u e . ' ( L ’a b b é M a l l e t J - Discours , B e lle s -L e ttr e s * . C ’eft le titre qu Horace
donnoit à fès fàtyres.
Les Critiques font partagés fur la raifon qu’a eue
le poète d’émployer ce nom, qui fémble plus convenir
à la Profo qu’a la Poéfie. L ’opinion du père
lé Boflu paroît la mieux fondée : i l penfé que- la
Simple obfe-rvaïion des pieds & de la mefure du
v ers, en un mot, tout ce qui concerne purement
les règles de la Profbdie, telle qu’on la trouve dans
Térence , Plaute, & dans les. fàtyrès d’Horace , ne
Jfuffit pa% pour conftimer ce qu’on, appelle P o é f ie ,
D I S
pour détermïnef un ouvrage à être vràinvent poétique
, & comme tel diftingué de la Profé, à moins
qu’il n’ait quelque ton ou caraâère plus particulier
Ue Poéfie, qui tienne un peu de la Fable ou du
: füblime. -
C’eft pourquoi Horace appelle fés fàfiyres Sermo-
nes, comme nous dirions Difcours en vers ; &
moins éloignés d'e la profe, quaji Sermoni. pro-
piora y que les Poèmes proprement dits. En-effet,
qu’on compare ce -poète avec lui-même , quelle
différence , quand il prend l’effor & s’abandonne à
l’enthoufiafme dans fés Odes 1 auffi les appeile-t-c.il
Poèmes , carmina. La même raifbn a déterminé
bien des perfonnes a.ne mettre Régnier, & Def-
préaux pour fés Satyres, qu’au nombre des verfi-
fickteurs ; parce que , difontVils, on .ne’trouve dans
:Ces'pièces nulle étincelle.de ce beau feu, de ce
fénie qui- caraftérité les véritables, .poètes. Voyer^
oème & V e r s if ic a t io n . (U a b b é Mallet.)
DISCUSSION, fi f. en général Signifie l ’Éoca-*
men de Littérature, de Science, d.’A f fa ir e ,, 8ce. ou
l’jE x p lic a t io n de : quelque point de Critiqué. , /
Ce -, mot exprime l ’aétion d’épurer un,e< matière
de • toutes : celles qui lui peuvent être çtrangère.s,,
pour, la; prêfènter : nette & dégagée, de toutes les.
difficultés qui * l'embrouilloient. Np.us difons , par
exemple, que tout ce qui regarde la Mufîque 8c la
Danfé des. anciens a.été bien dificuté dans les lavantes.
Difter.tati.ons que ,M„ Burette a données fù;r£e Sujet,
& les éclairciffements; qu’il y a joints dans les
Mémoires de l’Académie d e^R e lle s- Lettres. Il
refte peut-être eficore dans l’anriquité plus, de points,
à difeuter qu’on n’en a éclairci jufqùr’àipr.éfent. La
Dlfcuff on en ce .genre eft ce qu’on appelle autrement
Critique. V. C r it iq u e^ ('L'atbbéMollet.)
DISERT,, ad;. (Gramm. & Belles-; Lett,i) Epithète
que. l’on donne à celui qui a le difeôursfacile, clair
pur, élégant, mais foible. Suppoféz. à l’homme diferp
du nerf dans Texpreffion & de l’élévation dans les.
penfefes , vous en ferez-un hofnme éloquent. D’où
l’on voit que notre Dïfen n’eft point fynonyme au
Difertus des latins ; car ils difbient, Peéhi's eft quod
Difertum facit, que nous traduirions en françoispat
C'ejl Tarde qui rend'éloquent, & non pas C’ejl Tame
qui rendVhomme difért: {M. Diderot.) *
(N.) DISERT ÈLOQÜËNT. Synonymes.^
Ces doux termes caraétérifent également un discours
d^apparat. Le difcours-difen eft facile, clair-,.,
pur , élégant, & même brillant ; mais il eft foible
& fans feu : le difcours éloquent eft v if, animé -,
perfuafif, touchant; il émeut;, il élève l’ame, il la
makrifé.
Ces épithètes Ce donnent également aux perfonnes
&■'pour les mêmes raifons; Suppofezlà un homme
d i f en y du nerf dansL’expreffion; de l ’élévation dans
les pensées , de la chaleur, dans les mouvements
vous en ferez un homme éloquent« (M* Br A u.zée.)
d i s
M. Cureau de la Chambre, curé de S. Barthe-
lem i, avoit la mémoire prompte à retenir, quand il
apprenoit par coeur; mais lente à lui rendre fes mots,
quand il déclamoit : ainfî, fa prononciation étoif finis \
grâce 8c fians force. Mais ce défaut n’a voit lieu que
d a l l é s d i f c o u r s d 'a p p a r a t . Horsde là Sc p o u r les p r ô nes
qu’il faifoit dans fon ég-life, il ne s’affujettiüoit
point à fa#mémoire : après s’être rempli du fujet
qu’il vouloit traiter , il fo livroit à fon talent, qui
étoit admirable pour le pathétique ; un coeur faciie\
à s’émoùvoir lui tournifloit abondamment ces grandes
figures, ces tours animés, qui font les armes d e
la perfuafion. Quand donc il récitolt un difcours fait
à loifîr, on l’admiroit froidement; il n’y étoit que
difert ; & quand i f faifoit un prône fur le c h a m p ,
on étoit près d’en venir aux larmes ; il y étoit éloquent.
tiifl.de T Acad. F r . wm, I I . (JM. d Oliv e i .)
(N.) DISJONCTIF, IVE . adj. Qui fort à dif-
joindre , à séparer. Il y a des conjonctions disjonc-
tiv'es : ce font celles qui défîgnent, entre des çro-
pofitions incompatibles , une liaifbn de comparaifon
& de choix, fondée fur cette incompatibilité même.
.Elles font ainfî nommées du latin Disjungeré ( sépa-
rer, disjoindre , défùnîr ) ; parce qu’elles ne rapprochent
les propofitions que pour en énoncer lin -
compatibilité.
Lés latins '»voient plu fieu rs Conjonftions disjonc-
tives, dont nous ne démêlons plus les différences;
lavoirfeu.yjive , aut, vel, 8c l’enclitique vtf* Nous
.n’avons, en françois que la Conjonction ou, comme
dans ces exemples : C'eft le foleil. ou la terre qui
'tourne ; Life\ ou forte\. '
On demande, dit Vaugelas ( R em . c l ,J s’il faut
» dire', Ou la douceur ou la fo r c e le f e r a , ou l e f e -
» fon t. Sans doute il faut dire le f e r a au.fîngulier ;
» car comme c ’eft une alternative , ou une D i s jo n c -
»■ t iv e , il n’y a que l ’une des deux, qui régiife le
» verbe; 8c ainfî, il ne peut être mis qu’au fîngu-
» lier. « - f
Th. Corneille répond que. le f e r a . 8c le feront font
tous deux bons. Quelquefois pourtant, d it- il, 1 un
eft mieux que l ’autre, 8c l’oreille en doit juger ;
mais il y a des endroits oii il le faut nécefïàirement
dire au pluriel, comme T o i ou m o i te fe r o n s ; en
cet endroit le f e r a ne forpît pas bien, & le f e r a i fèroit
plus ridicule.
L’Académie J dans fon Obforvation fur la même
Remarque, mettant à part l’exemple ou les fiijets
font de différentes perfonnes, laiffe voir fon penchant
pour 1’exaCtitude grammaticale , qui. demande le fîn-
gulier ; elle, finit néanmoins par décider qu’on peut
le forvir indifféremment de l’un 8c de l’autre nombre.
Si j’ofols, après ces autorités, avoir un avis à moi ,
je dirois que , fi les deux.fiijets.font fufoeptibles à la
fois du meme attribut, quoiqu’il fiuffifo à la propo-
fîtion d?être vraie de l’im des deu-x, on peut indifféremment
employer le fîngulier ou le pluriel : P ierre
ou P a u l iront v o u s ch e r ch e r , ira v o u s chercher; Ou
1$. douceur ou la f o r c e le f é r u ou le fe r o n t* Maisfi 1 un
D I S S29
des deux fiijets n’eft fiifoeptible de l’attribut qu’en
excluant l’autre , alors le fîngulier eft exclufîvement
néceffaire : Ou le foleil ou la terre tourne j parce que,
fi l’un tourne, l’autre ne tourne pas. Ce ne foroit donc
pas l’oreille que je voudrois que l’on confultât ; ce
lèroit la nature même des chofes dont on parle. Mais
le plus sur encore foroit d’employer partout le fîngulier
^ parce que la Disjonclive porte naturellement
à ne confîdérer que l’un des deux fiijets.
Par la même confîdération d’exaCtitude, j’eviterois
de dire, Toi ou moi le ferons , quoiqu’il foit vrai
qu’on ne puiffe dire ni fera ni ferai : j’aimerois mieux
prendre un détour 8c dire, par exemple, Tu le feras
.ou je le ferai. _ . . .
Nos grammairiens françois ont regardé finon 8c
foit comme des Conjonctions disjonclives : mais je
crois qu’ils fo font trompés. - Sinoneü. composé d e / 8c de non : perfonne n’ignore
que non eft une négation qui s’emploie foule avec relation
à une proposition exprimée auparavant ; comme
j quand ori demande à quelqu’un, ave^-vous ete à Romeï
i & qu’il répond Amplement Non, au lieu de répe-
i ter la même propofîtion 8c de dire négativement Je:
n ai point été à. Rome. Il réfiilte delà i° . que Sinon
eft une Conjonction de même efpèce que f , c’eft à
dire, une conditionnelle ( Voyei{ C o n d it io n n e l );
z°. que Sinon tient foui la place d une propofîtion déjà
énoncée, 8c qu’elle n’eft pas le lien des deux pro-
pofîtions entre lefquelles, on la place : ainfî, quand
on àïtyObéiffe\ï finon, vous fere^puni ; c’eft comme
fi l’on difoit ; Obéijfc\ , fi vous n’obéifTez pas-, fous^
fcre% puni. Il y a bien la matière a disjontffioii 8c a
choix , mais la forme grammaticale n’en dit rien
il faudroit dire pour Cela Obêiffe\ ou vous fére\ puni*
Puifque le mot Sinon tient foui la place d^une-propofîtion
, il eft. évident qu'il doit toujours être fùivÜ
d’une virgule, vu qu’il n appartient pas au me en a—
ni fine de la propofîtion fuivante. v _
Soit eft partout, ce qu’il eft dans-la conjugalfou
du verbe être, la troifîème perfonne fînguiière du
préient indéfini du fübjonCtif; c’eft 1 Ellipfo de tout:
ce qui doit naturellement l’amener dans la phrafo ,
qui a trompé nos grammairiens fur la nature de ce
mot dans les circonftances où ils en ont fait une Con—
jonftion disjonclive-. Prenons un exemple zSoit gputy.
foit raifon-, foit caprice, il aime la retraite -, on eon—
forveroît le même fons , fi l’on difoit, que ce foit'
goût, que ce foit raifon, que ce-foit caprice , il aime,
la retraite; or il eft certain que, dans cette dernière
phrafe, iu k e ft la troifîème perfonne fînguiière du.
présent indéfini du fiubjondifduverbe êxre ; c’eft donç:
la même chofo dans la première , qui ne. diffère de.*
la féconde que par l’Ellipfè. Remarquez..encore que
quoiqu’il y ait ici matière de choix ,*. la forme g pm -
maticale de la phrafe n’en dit rien : il n y, au roi t
que la conjonction ou. qui l’indiqueroit ,.fî 1 o n / i foit,.
par exemple--; Soit goût, ou raifon, ou caprice, i f
aime ht retraite. ( M. BeauzAe. ),
(N.) DISJO NCTIO N,/, f. Elgutedtlocuûan g s£