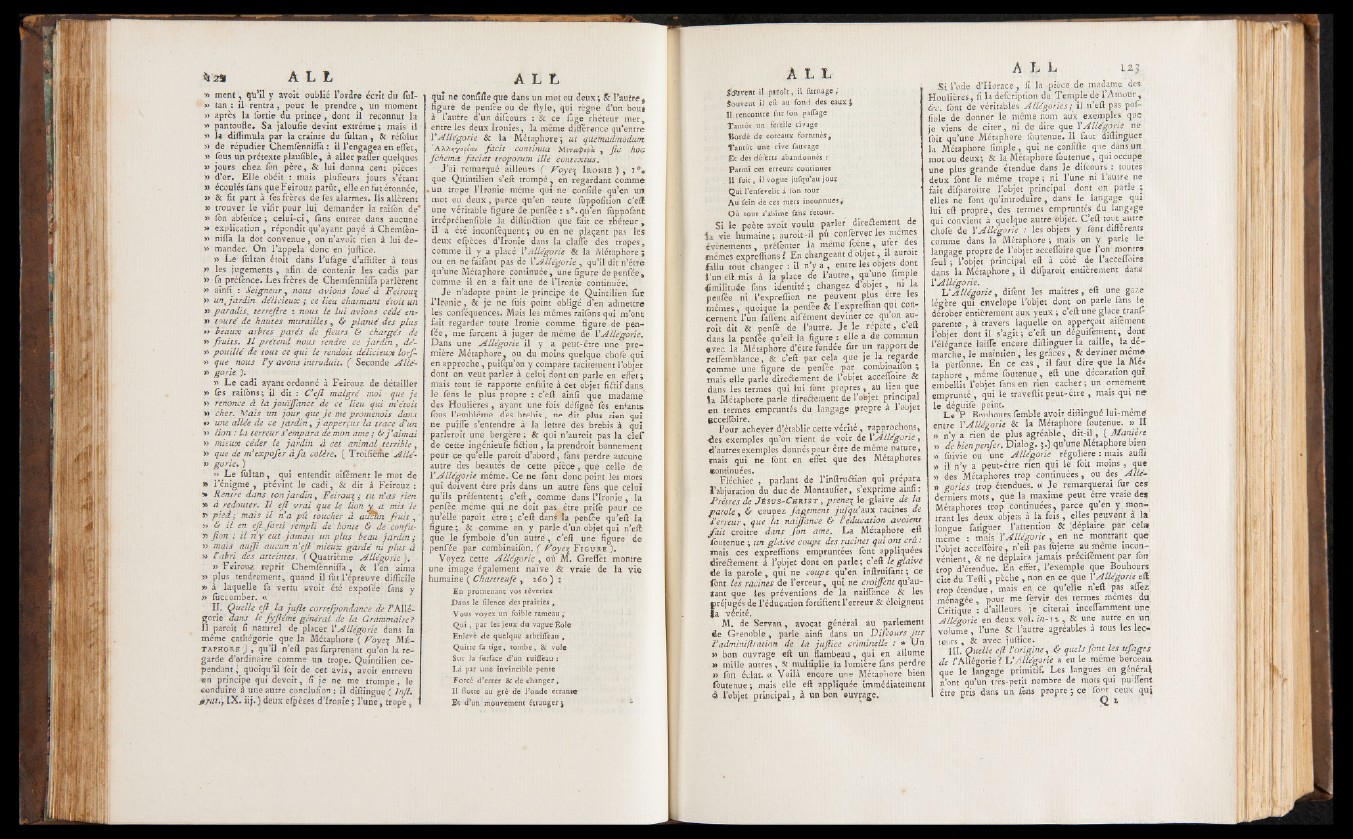
Va» A L L
» ment, qu'il y avoit oublié l’ordre écrit du ful-
» tan ; il rentra, pour le prendre , un moment
» après la fortie du prince, dont il reconnut la
» pantoufle# Sa jaloufie devint extrême ; mais il •
» la diflimula paT la crainte du fiiltan, & réfolut
» de répudier Chemfenniflà : il l’engagea en effet,
» fous un prétexte plaufîble, à aller palier quelques
» jours chez fon père, & lui donna cent pièces
» d’or. Elle obéit : mais plufîeurs jours s’étant
» écoulés fans que Feirouz parût, elle en fut étonnée,
» & fit part à (es frères de fes alarmes. Ils allèrent
» trouver le vifir pour lui demander la raifbn de*
» (on ablèrice ; celui-ci, (ans entrer dans aucune
» explication , répondit qu’ayant payé à Chemfèn-
» nilïà la dot convenue, on n’avoît rien à lui de-
» mander. On l’appela donc en juftice.
» Le fùltan étoit dans Tufàge d’aflïfter à tous
x> les jugements, afin de contenir les cadis par
» (à préience. Les frères de Chemfénniiïà parlèrent
» ainfî : Seigneur, nous avions loue' à Feirouz
» un K jardin délicieux ce lieu charmant étoit un
» paradis, terrejlre : nous le lui avions cédé en-
» touré de hautes murailles, & planté des plus
» beaux arbres parés de fleurs & chargés de
» fruits. I l prétend nous rendre ce jardin, défi
pouillé de tout ce qui le rendait délicieux lorf-
» que nous l ’y avons introduit. ( Seconde A llé -
» gont ɧ
» Le cadi ayant ordonné à Feirouz de détailler
» fés rai(bns ; il dit : C’ejl malgré moi que je
» renonce à la jouijfance de ce lieu qui m’étoit
» cher. Mais un jour que j e me promenois dans
•3 une allée de ce jardin, j apperçus la trace d’un
f> lion : la terreur s ’empara de mon ame ; & j ’aimai
» mieux céder le jardin à cet animal terrible,
» que de m’expofer à f a colère, ( Troifième A llé-
» go rie , )
Le (ùltan, qui entendit aifément le mot de
» l ’énigme , prévint le cadi, & dit à Feirouz :
* Rentre dans ton jardin, Feirou^ | tu n’as rien
» à redouter. I l efi vrai que le lion y a mis le
x» pied ,* mais i l ré a pu toucher à awStm f r u i t , ’
39 & i l en efi fo r t i rempli de honte & de confi-
» fion : i l n’y eut jamais un plus beau jardin f
» mais aujji aucun n’ejl mieux gardé ni plus à \
» Fabn des atteintes. (Quatrième Allégo rie).
» Feirouz reprit Chemfènniffa, & l’en aima
» plus tendrement, quand il (ùt l’épreuve difficile
» à laquelle (à vertu avoit été èxpofée fans y
» fîiccomber. «
II. Quelle eft la Jufie correfpondance de /’Allégorie
dans le fyfteme général de la Grammaire?
Il paroit fi naturel de placer l ’ A l lé g o r ie dans la
même cathégorie que la Métaphore ( V o v e \ Mé ta
ph o r e j , qu’il n’eft pas fîirprenant qufon la regarde
d’ordinaire comme un trope. Quintilien cependant
] quoiqu’il (oit de cet avis, avoit entrevu
*n principe qui devoit, fi je ne me trompe, le
conduire à une autre conclufîon : il diflingue ( In j l .
# ?& • ) IX. iij. ) deux elpèees d’ironie ; l’une, trope, '
A L L
qui ne confifle que dans un mot ou deux; & l’autre,
figure de penfée ou de ftyle, qui règne d’un bout
à l’autre d’un difoours : & ce (âge rhéteur met,
entre les deux Ironies, la meme différence qu’entre
l ’A l lé g o r i e & la Métaphore ; ut qüemadmodum
’AXXtjyopluv f a c i t con tinu a Meraipop« , f i e hûG
fe h em a f a c ia t troporum i ll e c o n t e x tu s .
J ’ai remarqué ailleurs ( V o y e \ Ir o n ie ) , i ° ,
que Quintilien s’eft trompé, en regardant comme
.un trope l’Ironie même qui ne confifle qu’en un
mot ou deux, parce qu’en toute fiippofition c’eft
une véritable figure de penfée : i° . qu’en fiippofimt
irrépréhenfîblè la diftinétion que fait ce rhéteur ,
il a été inconféquent ; ou en ne plaçant pas les
deux efpèces d’ironie dans la clafle des tropes,
comme il y a placé l ’ A llég o r ie & la Métaphore;
ou en ne faifimt pas de l’A l lé g o r i e , qu’il ditn’être
qu’une Métaphore continuée, une figure de penfée,
comme il en a fait une de l’Ironie continuée.
Je n’adopte point le principe de Quintilien (ut
l’Ironie, & je ne luis point obligé d’en admettre
les conféquences. Mais les mêmes raifons qui m’ont
fait regarder toute Ironie comme figure de peu-
fée, me forcent à juger de même de l’A l lé g o r ie .
Dans une A l lé g o r ie il y a peut-être une première
Métaphore, ou du moins quelque chqfe qui
en approche, puifqu’on y compare tacitement l’objet
dont on veut parler à celui dont on parle en effet;
mais tout fe rapporte enfiiite à cet objet fi&if dans
le (êns le plus propre : c’eft ainfî que madame
des Houlières, ayant une fois défîgné (es enfants
(bus l’emblème des brebis , ne dit plus rien qui
ne purfle s’entendre à la lettre des brebis à qui
parleroit une bergère ; & qui n’auroit pas la clef
de cette ingénieute fiétion , la prendroit bonnement
pour ce qu’elle paroît d’abord, (àns perdre aucune
autre des beautés de cette pièce, que celle de
l ’A l lé g o r i e même. Ce ne font donc point les mots
qui doivent être pris dans un autre (èns que celui
qu’ils préféntent; c’efl, comme dans l’Ironie, la
penfée même qui ne doit pas être prife pour ce
qu’elle paroît être; c’eft daniia penfée qu’eft la
figure ; & comme on y parle d’un objet qui n’eft
que le (ymbole d’un autre, c’eft une figure de
penfée par combinaifon. ( P o y e^ F ig u r e ).
Voyez cette A l lé g o r i e , où M. Grelfet montre
une image également naïve & vraie de la vi©
humaine ( Chartreufe , %6o ) :
En promenant vos rêveries
Dans le filence des prairies ,
Vous Voyez un foible rameau,'
Q u i, par les jeux du vague Éole
Enlevé de quelque arbrifleau ,
Quitte fa tige, tombe, & vole
Sur la furface d’ un ruifleau :
Là par une invincible pente
Forcé d’errer 8c de changer,
11 flotte au gté de l’onde errante
Es d’un mouvement étranger ^ f *
À L L
Æ'âttvest il patoît, il fumage ;
Souvent il eft au fond des eaux £
Il rencontre fur fon partage
Tantôt un fertile rivage
Bordé de coteaux fortunés.
Tantôt une rive fauvage
Et des défères abandonnés r
Parmi ces erreurs continues
Il fuit, il vogue jufqu’au jour
Qui l’enferelit à Ton tour
Au fein de ces mers inconnues f
Où roue s’abîme fans retour.
Si le poète avoit voulu parler dire&ement de
| i vie humaine; auroit-il pû cpnferver les memes
évènements, préfénter la même (cène, uler des
mêmes expreflions ? En changeant dobjet, il auroit
iàllu tout changer : il n’y a , entre les objets dont
l ’un eft mis à la place de l ’autre, qu une fimple
Similitude (arts identité ; changez d objet, ni la
penfée ni l’expreffion ne peuvent plus etre les
mêmes, quoique la penfée & l ’expreffion qui concernent
l’un faiïent aifément deviner ce qu on au-
roit dit & penfé de l’autre. Je le répète, c eft
dans la penfée qu’eft la figure : elle a de commun
«.vec la Métaphore d’être fondée (ur un rapport de
reflemblance, & c’eft par cela que je la regarde
Comme une figure de penfée par combinaifén ;
mais elle parle direélement de l’objet accenoire &
dans les termes qui lui font propres, au lieu que
la Métaphore parle direéfcement de l’objet principal
en termes empruntés du langage propre à l’objet
gcceflbire.
Pour achever d’établir cette vérité, rapprochons,
-des exemples qu’on vient de voir de 1 Allégorie,
d’autres exemples donnés pour être de même nature,
mais qui ne font en effet que des Métaphores
«ontinuces. , f
Fléchier , parlant de l’infirudion qui prépara
l ’abjuration du duc de Montaufîer, s’exprime ainfî:
Prêtres de J ésus-Christ , prene\ le glaive de la
parole, & coupez fagement jufqu’anx racines de
l ’erreur, que la naijjance & F éducation avoient
fa it croître dans Jon ame. La Métaphore eft
fou tenue ; un glaive coupe des racines qui ont cru:
mais ces expreflions empruntées font appliquées
diredement à l’objet dont on parle ; c’eft le glaive
de la parole , qui ne coupe qu’en inftruifanc ; ce
font les racines de l’erreur, qui ne croijfem qu’au-
tant que les préventions de la naiflance & les
préjugés de l’ éducation fortifient l’erreur & éloignent
|a vérité.
M. de Servan, avocat général au parlement
de Grenoble, parle ainfî dans un Difcours jur
Vadminijlradon de la jufiiee criminelle : » Un
» bon ouvrage eft un flambeau, qui en allume
» mille autres, & multiplie la lumière (ans perdre
» fon éclat. « Voilà encore une Métaphore bien
foutenue à ; mais elle eft appliquée immédiatement l’objet principal, à un bon ouvrage.
A L L iz3
Si l ’pde d’Hotace, fi la pièce de madame, des
Houlières, fila defeription du Temple de l’Amour,
&c. Iont de véritables Allégories ; ü tt’eft pas pof-
iibie de donner le mente nom aux exemples que
je viens de citer, ni de dire que l’Allégorie ne
foit qu’une Métaphore lôutenue. Il faut diffinguec
la Métaphore fimple, qui ne confifle que dans un
mot ou deux; & la Métaphore lôutenue, qui occupe
une plus grande étendue dans le difcours : toutes
deux font le même trope ; ni l’une ni l ’autre ne
fait difparoître l ’objet principal dont on parle ;
elles ne font qu’introduire, dans le langage qui
lui efl propre, des termes empruntés du langage
qui convient à quelque autre objet. C ’eft tout autre
chofe de Y Allégorie : les objets y font différents
comme dans la Métaphore ;. mais on y parle le
langage propre de l’objet acceffoire que l’on montre
leul ; l’objet principal eft à côté de racceftoire
dans la Métaphore, il difparoît entièrement dans
l’Allégorie.
L ’Allégorie, dilètit les maîtres, eft une gaze
légère qui envelope l ’objet dont on parle làns le
dérober entièrement aux yeux ; c’eft une glace tranf
parente , à travers laquelle on apperçoit aifément
l’objet dont il s’agit; c’eft un déguifement, dont
l’élégance laiflè encore diftinguer la taille, H de-
marche, le maintien, les grâces , & deviner même
la perfonne. En ce cas , il faut dire que la Mca
taphore , même lôutenue , eft une décoration qui
embellit l’objet fins en rien cacher ; un ornement
emprunté, qui le traveftitpeut-etre , mais qui nff
le déguilè point. ; . . .
Le f . Bouhours lêmble avoir diftingué lut-memtf
entre Y Allégorie & la Métaphore lôutenue. » Il
» n’y a rien de plus agréable, dit-il, ( Manière
» de bienpenfer. Dialog. 3.) qu’une Métaphore bien
» fuivie ou une Allégorie régulière : mais aufli
» il n’y a peut-être rien qui le foit moins , que
» des Métaphores trop continuées, ou des A llé -
» gories trop étendues, tt Je remarquerai lùr ces
derniers mots;, que la maxime peut être vraie des
Métaphores trop continuées, parce qu’en y montrant
les deux objets à la fois, elles peuvent à la
longue fatiguer l’attention & [déplaire par cela
même : mais Y Allégorie , en ne montrant que
l’objet acceffoire, n eft pas lùjette au meme inconvénient,
& ne déplaira jamais précifément par lôn
trop d’étendue. En effet, l’exemple que Bouhours
cite du Tefti, pèche , non en ce que XAllégorie eft
trop étendue , mais en ce qu’elle n’eft pas allez
ménagée, pour me lèrvir des termes mêmes du
Critique : d’ailleurs je citerai inceflamment une
Allégorie en deux vol. in-11 , & une autre en un
volume , l’une & l’autre agréables à tous les lecteurs
, & avec juftice.
III. Quelle efi l'origine, & quels font les ufages
de l’Allégorie ? L ’Allégorie a eu le même berceau
que le langage primitif. Les langues en générai
n’ont qu’un très-petit nombre de mots qui puifTent
être pris dans un Cens propre 3 ce lont ceux qujj Q