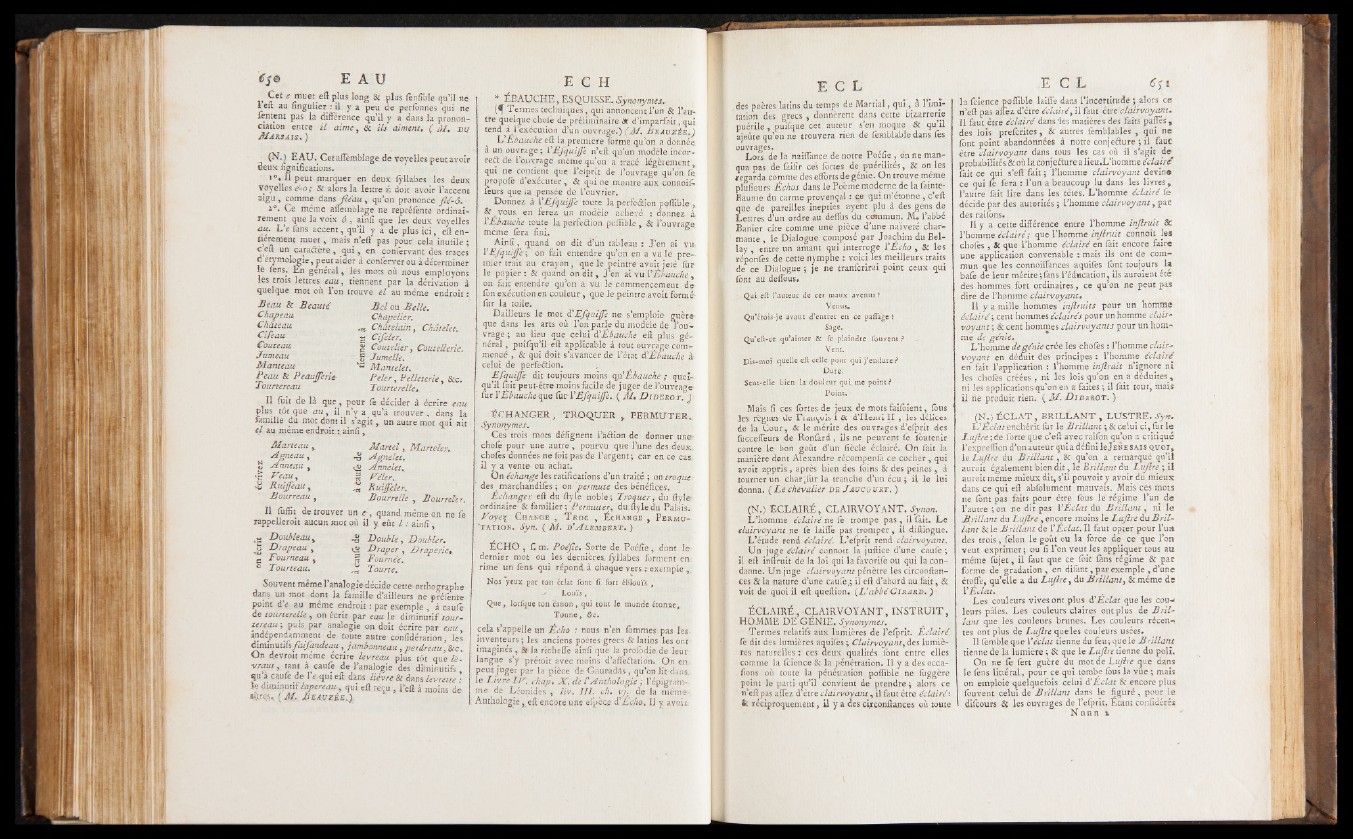
rt j* E A U E C H
? Cet e muet eft plus long & plus fènfible qu'il ne
1 eft au Singulier : il y a peu de perfonnes qui ne
(entent pas la différence qu’il y a dans la pronon-
dation entrç il aime_, & Us aiment, ( AJ, x>tr
A l A. RS A ï s . J
(N.) EAU. Cet affemblage de voyelles peut avoir
fieux lignifications.
i Il peut marquer en deux lÿllabes les deux
voyelles e'-o; & alors la lettre É doit avoir l’accent
a igu, comme dan s fléau, qu’on prononce JU-o.
i° . Ce même aflemblage ne reprélênte ordinairement
que la voix 6 , ainfi que les deux voyelles
au. L’e fins accent, qu’il y a de plus ic i, efl entièrement
muet, mais n’eft pas pour cela inutile ;
c^efl un caraâère , qui , en confervant des traces
d étymologie, peut aider à conferver ou à déterminer
le fèns. En general, les mots où nous employons
les trois, lettres eau, tiennent par la dérivation à
quelque mot où l’on trouve el au même endroit :
Beau & Beauté
Chapeau
Bel ou Belle•
Château
Chapelier.
Cifeau
Couteau
Jumeau
Manteau
Peau & PeauJJeri&
Tourtereau
*rt Châtelain, Châtelet-.
g Cifeler..
ç Coutelier y Coutellerie.
§ Jumelle.
** Mantelet.
Peler, Pelleterie, &c.
Tourterelle«
Il fuit de la que, pour fè décider à écrire eau
plus tôt- que au, il n’y a qu’à trouver , dans la
famille du mot dont il s’agit y un autre mot qui ait
cl au même endroit. ainfi,
Marteau %
Agneau,Martel, Marteler,
Agnelet.
u Anneau %
Aruielet^
>£ Veau y
Ruijfeau,
Bourreau ,
I Vêler..
R uijfeler.
Bourre lie , Bourreler..
Il fùffit de trouver un e-, quand même on ne fe
rappelleroit aucun mot où il y eût l : ainfi
+* Doubleau y
•xj Double, Doubler.
Ö Drapeau ,
c Fourneau y
Oi Draper , Draperie.•
rt Fournée..
° Tourteau.
Tourte..
* ÉBAUCHE, ESQUISSE*.Synonymes..
(T Termes techniques, qui annoncent l’un & l'autre
quelque choie de préliminaire Ôt d’imparfait, qui.
tend à l’exécution d’un ouvrage.) (M, Beauzêe.)
L Ebauche eft la première forme qu’on, a donnée
a un ouvrage ; YEfquiJJ'e n’eft qu’un modèle incor-
reâ; de l’ouvrage même qu’on a tracé légèrement ,
qui ne contient que l’elprit de l’ouvrage qu’on fe
propofè d’executer , & qui ne montre aux. connoifi
leurs que ia pensée de l’ouvrier.
Donnez à Y Ejqiùjfe toute la perfection poffible y
& „ vous, en ferez un modèle achevé : donnez à,
Y Ebauche toute la perfeâion poffible y & l’ouvrage,
même fera fini.
Ainfi, quand on- dit d’un tableau : J’en ai vu
YEfquiJfe ; on fait entendre qu’on en a vu le premier
trait au crayon, que le peintre avoit jeté fur
■ le papier : & quand on d it, J’en ai vu Y Ébauche y
on fait entendre qu’on a vu le commencement de
; fôn exécution en couleur , que le peintre avoit formé-
fur la toile.
Dailleurs le mot ÜEfquiJfe ne s’emploie: guère
_ que dans les arts où l’on parle du modèle de J ’ou-
. vrage ; au lieu que celui C Ébauche efl plus gé-
• néral, puifqu’ile f t applicable à tout ouvrage commencé
^ & qui doit s’avancer de l’état d’Ébauche à
celui de perfection.
Efquijfe dit toujours moins Ebauche ; quoiqu'il
foit peut-être moins facile de juger de l’ouvrage
fur YÉbauche que fut YEfquiJJe., ( M. D i d e r o t . J
ÉCHANGER, TROQUER , PERMUTER,.
Synonymes,
Ces trois mots défignent l’àftion de donner une-
chofè pour une autre , pourvu que l’iine des deux,
chofês données ne foit pas de l’argent; car en ce cas,,
il. y a vente- ou achat.
On échange les ratifications d’ùn traité ; on troque-
des marchandifès ; on permute des bénéfices.
Échanger efl du flyle noble; Troquer, du flyle?
ordinaire & familier; Permuter, du. flyle du Palais.
Voye\ C hange ,. T roc , É change , P erm u t
a t io n . Syn. ( M. d'Alembert. )
ÉCHO , C m. Poéfie, Sorte de Poéfie, dont Je-
dernier mot ou les dernières, fÿllabes forment en-
rime' un fèns qui répond à chaque vers exemple
Souvent même l’analogie décide cette-orthographe
dans un mot dont la famille d’ailleurs ne p-réfente
point d’e au même endroit : par exemple -, à caufè
de tourterelle , on écrit par eau le diminutif tourtereau
; puis par analogie on doit écrire par eauy
indépendamment de toute autre confïdération, les
ôirolnuùfsfaifandeau , jambonneau , perdreau, &c.
On flevroit même écrire leyreau plus tôt que iC
vraut, tant àcaufe de l’analogie des diminutifs
qu’à caufè de IV qui efl dans lièvre & dans levrette :
k diminutif lapereauqui efl reçu , l’efl à moins de
litres*, ( M.- Beajsz£e~),.
Nos yeux, par ton éclat font fi fort éblouis ,
. > Louis,
QueIorfque ton canon, qui tout le monde étonne,
Tdnne., &c.
cela s’appelle un Écho : nous n’en fômnies- pas lés.
inventeurs ; les anciens poètes.grecs & latins les ont
imaginés , &• la richefïè ainfi que la profbdie. de leur
langue s’y prétoit avec moins d’affe&ation-. On en
peut juger par la pièce de Gauradâs, qu’on lit-dans,
le Livre IV. chap, X. de C Anthologie ; l’épigram--
me de Léonides , liv. III. ch. vj. de la même-
Anthologie, efl encore une efpèop d’Êcho, Il y ayoit.
E C L
des poètes latins du temps de Martial, qui, a 1 imitation
des grecs , donnèrent dans cette bizarrerie
puérile, puifque cet auteur s’en moque & qu’il
ajoûte qu’on ne trouvera rien de femblabie dans fes
ouvrages..
Lors de la naifiànce de notre Poéfie, on ne manqua
pas de feifir ces (brtes de puérilités, & on les
regarda comme des efforts de génie. On trouve même
plufieurs Échos dans le Poème moderne de Iafiinte-
Baume du carme provençal : ce qui m’étonne, c’eft
que de pareilles inepties ayent plu à des gens de
Lettres d’un ordre au deffus du commun. M. l’abbé
Banier cite comme une pièce d’une naïveté charmante
, le Dialogue composé par Joachim du Bellay
, entre un amant qui interroge l’Écho , & lys
réponfès de cette nymphe : voici les meilleurs traits
de ce Dialogue ; je ne tranfcrirai point ceux qui
lônt au deflous.
Qui eft l’auteur de ces maux avenus ?
Venus.
Qu’étois-je avant d’entrer en ce paflà’ge î
Sage.
Qu’eft-ce qu’aimer & fe plaindre fouvent ?
Vent,
Dis-moi quelle eft celle pour qui j’endure?
Dure.
Sent-elle bien la'douleur qui.me point?
Point. -
Mais fi ces fortes de jeux de mots fàifbient, fous
les règnes de François 1 & d’Henri II , les délices
de la Cour, & le mérite des ouvrages d’efprit des
fûcceflèurs de Ronfârd, ils ne peuvent fe fbutenir
contre le bon goût d’un fiècle éclairé. On fait la
manière dont Alexandre récompenfà ce cocher, qui
avoît appris , après bien des foins & des peines , à
tourner un char^fiir la tranche d’un écu ; il le lui
donna. ( Le chevalier d e Jaucourt. )
(N.) E c l a i r é , c l a ir v o y a n t , jymm.
L ’homme éclairé ne fè trompe pas , il fait. Le
clairvoyant ne fè laiffe pas tromper, il difiingue.
L’étude rend éclairé. L’efprit rend clairvoyant.
Un juge éclairé connoit la juflice d’une caufè ;
il efl inftruit de la loi qui la favorifè ou qui la con-
danne. Un juge clairvoyant pénètre les circonflan-
ces & la nature d’une caufè.; il efl d’abord au fait, &
voit de quoi il efl queflion. (L’abbé G i r a r d . )-
ÉCLAIRÉ, CLAIRVOYANT, IN ST R U IT ,
HOMME DE GÉNIE. Synonymes.
Termes relatifs aux lumières de l’efprit. Éclairé
fè dit des lumières àquifès ; Clairvoyanty des lumières
naturelles : ces deux qualités font entre elles
comme la fcience & la pénétration. Il y a des occa-
fions où toute la pénétration poffible ne fiiggère
point le parti qu’il convient de prendre ; alors ce
n’efl pas affez d’être clairvoyant, il faut être éclairé :
& réciproquement, il y a des cirçonflances où toute
E C L
la fcience poffible laiffe dans l’incertitude ; alors ce
n’efl pas affez d’être é c la ir é , il faut être c la ir v o y a n t .
Il faut être é c la ir é dans ‘les matières des faits paffes ,
des lois preferites, & autres fèmblables , qui ne
font point abandonnées à notre conje&ure ; il^ faut
être c la irv o y a n t dans tous les cas où il s’agit de
probabilités & où la conjeâure a lieu.L’nomme é c la i r é
fait ce qui s’eff fait ; l’homme c la irv o y a n t devin®
ce qui fè fera : l’un a beaucoup lu dans les livres ,
l’autre fait lire dans les têtes. L ’homme é c la ir é fe
décide par des autorités ; l’homme c la ir v o y a n t , pac
des raifons*
Il y a cette différence entre l’homme in flru it &
l’homme é c la ir é ,* que l’homme in ftru it connoît le«
chofès , & que l’homme é c la ir é en fait encore faire
une application convenable : mais ils ont de commun
que les connoiflances aquifès font toujours la
bafe de leur mérite ; fans l’éducation, ils auroient été
des hommes fort ordinaires, ce qu’on ne peut pas
dire de l’homme c la irv o y a n t•
Il y a mille hommes in jlru its pour un homme
é c la ir é ; cent hommes é c la ir é s pour un homme c la ir v
o ya n t ; & cent hommes c la ir v o y a n ts pour un homme
de g é n ie«
L’homme de g én ie c r ée les chofès : l’homme c la ir v
o ya n t en déduit des principes : l’homme éclairé^
en fait l’application : l’homme in flr u it n’ignore ni
les chofès créées , ni les lois qu’on en a déduites „
ni les applications qu’on en a faites ; il fait tout* mais
il ne produit rien. (, M . D i d e r o t . )
(N.) ÉCLAT , BRILLANT , LUSTRE. Syn,
~ÙÉ c la t e n c h é r i t fu r l e B r i l la n t ; & c e lu i c i , fu r l e
L u jlr e ÿ ô e fo r te q u e c ’e f l a v e c r a i f b n q u ’o n a c r it iq u é
l’e x p r e ff io n d ’u n a u t e u r q u i a d é f in i IcJ e n e s a i s q u o i ,
l e L u j lr e d u B r i l l a n t , & q u ’o n a r em a r q u é q u ’il
a u r o it é g a l em e n t b ie n d i t , le B r illa n t d u L u jlr e ; i l
a u r o it m êm e m i e u x d i t , s’i l p o u v o it y a v o ir d u m i e u x
d a n s c e q u i eft a b f o lum e n t m a u v a is . M a is ces m o ts
n e fo n t p a s fa its p o u r ê t r e fo u s l e r é g im e l ’u n d e
l ’a u t r e ; o n n e d i t p a s Y É c la t d u B r i l l a n t , n i l e
B r i l la n t d u L u jlr e , e n c o r e m o in s l e L u j lr e d u B r i l la
n t & l e B r il la n t d e Y É c la t . Il f a u t o p t e r p o u r l ’u a
d e s t r o i s , f é lo n l e g o û t o u l a fo r c e d e c e q u e l’o n
v e u t e x p r im e r ; o u fi l ’o n v e u t le s a p p l iq u e r to u s a u
m êm e f u j e t , i l f a u t q u e c e fo it fa n s r é g im e & p a r
fo rm e d e g r a d a tio n , e n d i f â n t , p a r e x em p le , d ’u n e
é to ff e , q u ’e lle a d u I^u jlrey d u B a l la n t , & m êm e d e
Y É c la t .
Les couleurs vives ont plus & E c la t ($\e les couleurs
pâles. Les couleurs claires ont plus de B r i l la
n t que les couleurs brunes. Les couleurs récentes
ont plus de Lsujlre que les couleurs usées.
Il fèmble que Y é c la t tienne du feu; que le B r i l la n t
tienne de la lumière ; & que le L u jlr e tienne du poli.
On ne fè fert guère du mot de L u jlr e que dans
le fèns littéral, pour ce qui tombe fous la vue ; mais
on emploie quelquefois celui à !E c la t & encore plus
fouvent celui de B r il la n t dans le figuré, pour le
difeours 8c les ouvrages de l’efprit. Étant confidérés
Nnnn &
>: K