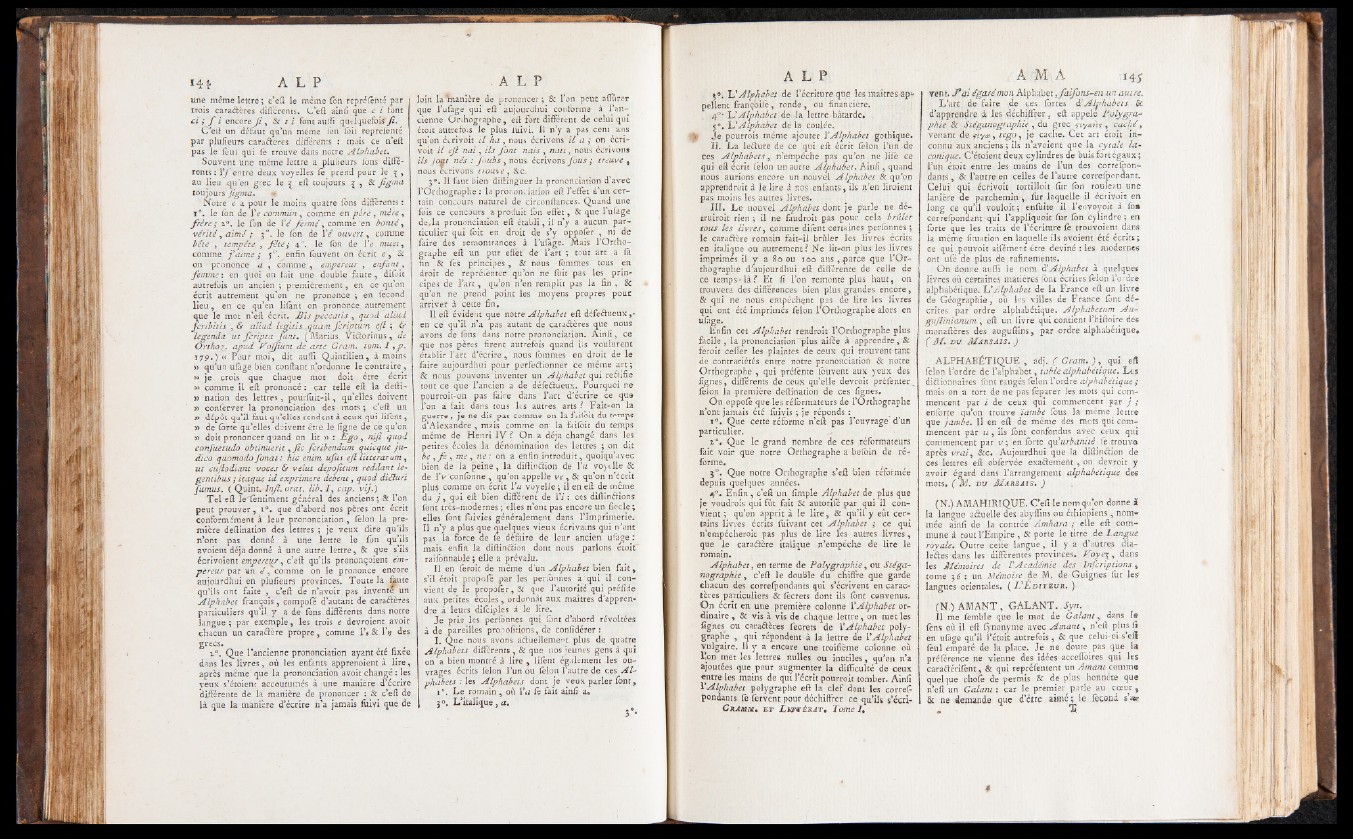
i4t À L P
une même lettre ; c’eff: le même (on repréfènté par
trois caraétères différents. C’eft ainfi que c i font
ci ,* f i encore f i , & t i font auffi quelquefois'fi.
C'en un défaut qu’un même fon (bit repréfènté
par plufîeurs carafteres differents : mais ce n’eft
pas le fèui qui fè trouve dans notre A lphabet.
Souvent une meme lettre a plufîeurs fons différents
:~Vf entre deux voyelles fè prend pour le q ,
au lieu qu’en grec le ^ eft toujours { , & figma
toujoursfignia.
Notre e a pour le moins quatre fons différents :
i° . le fon de Ve commun, comme en père , mère,
frère ; z°. le fon de IV fermé, comme'en bonté,
vérité, aimé ,• 30. le fon de IV ouvert, comme
bête , tempête, y fête y 4“. le fon de IV muet y
comme f aime ; 50. enfin fouvent on écrit e , &
on prononce a , comme , empereur , enfant,
femme : en quoi on fait une double faute, difoit
autrefois un ancien ; premièrement, en ce qu’on
écrit autrement qu’on ne prononce ; en fécond
lieu , en ce qu’en lifànt on prononce, autrement
que le mot n’eft écrit. JBis peccatis , quod aliud
fcribitis , & aliud legitis.quant fcriptum efi ; &
Legendà ut fcripta finit. ( Marius Viétorinus , de
Ôrthor. apud P'ojfium de arte Gram. tom. I , p.
17p.) « Pour moi, dit auffi Quinfilien, à moins
» qu’un ufàge bien confiant n’ordônne le contraire ,
» je crois que chaque mot doit être écrit
s» comme il efi prononcé : car telle efi la defti-
» nation des lettres, pourfùit-il, qu’elles doivent
» conferver la prononciation des mots ; c’eft un
» dépôt qu’il faut qu’elles rendent à ceux qui lifènt.,
» de forte qu’elles doivent être le ligne de ce qu’on
» doit prononcer quand on lit » : E g o , nifi quod
confuetudo obtinuerit, fie feribendum quicque ju -
dico quomodo fonat : hic enim ufus efi litterarum,
ut eufiodiant voces & velut depofitum reddant le-
gentibus ; itaque id exprimere debent, quod dicturi
fumus. ( Quint,. Infi. orat. lib. 7 , cap. vij.) '
T e l efi leTentiment général des anciens; & l’on
peut prouver, i° . que d?abord nos pères ont écrit
conformément à leur prononciation, félon la première
deftination des lettres ; je veux dire qu’ils
n’ont pas donné à une lettre le fon qu’ils
avoient déjà donné à une autre lettre, & que s’ils,
écrivoient empereur y c’eft qu’ils prononçoient empereur
par un é , comme on le prononce encore
aujourdhui en plufieurs provinces. Toute la faute
qu’ils ont faite , c’eft de n’avoir pas invente un
Alphabet francois , compofé d’autant de caradères
particuliers qu’il, y a de fons differents dans notre
langue ; par exemple, les trois e devroient avoir
chacun un caradère propre, comme IV & IV des
gre/cs.
i° . Que l ’ancienne prononciation ayant été fixée
dans les livres, où les enfants apprenoient à lire ,
après même que la prononciation avoit changé : les
veux s’étoienc accoutumés à une manière d’écrire
différente de la manière de prononcer : & c’eft de
là que la manière d’écrire h’a jamais fùivi que de
A L P
loin la Manière de prononcer ; & l’on peut aïïïirer
que l’ufàge qui eft aujourdhui conforme à l’ancienne
Orthographe, eft fort différent de celui qui
étoit.autrefois le plus fùivi. Il n’y a pas cent ans
qu’on écrivoit il h a , nous écrivons il a ; on écri-
voit il efi nai , ils font nais , natt, nous écrivons
ils Jout nés : foubs , nous écrivons fous ; treuve ,
nous écrivons trouve y & c.
30. Il faut bien diftinguer la prononciation d’avec
l’Orthographe : la prononciation eft l’effet d’un certain
concours naturel de cirçonftances. Quand une
fois ce concours a produit fon effet, & que l’ufage
de.la prononciation eft établi, il n’y a aucun particulier
qui foit en droit de s’y oppofér , ni de
faire des remontrances à l ’ufàge. Mais l’Orthographe
eft un pur effet de l’art ; tout art a fà
fin & les principes, & nous - femmes tous en
droit de représenter qu’on ne fuit pas les principes'de
l’ar t, qu’on n’en remplit pas la fin , &
qu’on ne prend point les moyens propres pour
arriver à cette fin.
Il eft évident que notre Alphabet eft défedueux,*
en ce qu’il n’a pas autant de caradères que nous
avons de fons dans notre prononciation. Ainfi, ce
que nos pères firent autrefois quand ils voulurent
établir l’art d’écrire, nous femmes en droit de le
faire aujourdhui pour perfedionner ce même art ;
& nous pouvons inventer un Alphabet qui redifie
tout ce que l’ancien a de défedueux. Pourquoi ne
pourroit-on pas faire dans l’art d’écrire ce que
l’on a fait dans tous les autres arts ? Fait-on la
guerre , je ne dis pas comme on la faifoit du temps
d’Alexandre , mais comme on- la faifoit du temps
même de Henri IV l On a déjà changé dans les
petites écoles la dénomination des lettres ; on dit
be , fe y me , ne : on a enfin introduit, quoiqu’avec
bien de la peine , la diftindion de Vu voyelle &
de l’v'confonne , qu’on appelle ve , & qu’on n’écrit
plus comme on écrit Vu voyelle ; il en eft de même
du j y qui eft bien différent de IV’ : ces diftindions
font très-modernes ; elles n’ont pas encore un fiecle ;
elles font fuivies généralement dans l’ Imprimerie.
Il n’y a plus que quelques vieux écrivains qui n’ont
pas la force de fè défaire dè leur ancien ufàge :
mais, enfin la diftindion dont nous parlons etoiC
raifonnable ; elle a prévalu.
Il en feroit de même d’un Alphabet bien fait,
s’il étoit propofé par les personnes à qui il convient
dç le propofer, & que l’autorité qui préfîde
aux petites écoles , ordonnât aux maîtres d’apprendre
à leurs difoiples à le lire.
Je prie les perfonhes qui font d’abord révoltées
à de pareilles propofitfons, de confidérer :
I. Que nous avons adueilement plus de quatre
Alphabets differents , & que nos jeunes gens à qui
on a bien montré à lire , lifènt également les ouvrages
écrits félon l ’un ou félon 1 autre de ces A l phabets
:les Alphabets dont je veux parler font,
i° . Le romain, où Va fo fait ainfi a*
30. L ’italique, a,
3°*
A L P
3O; L ’Alphabet de l’écriture que les maîtres-apv
pelient françbifè, ronde, ou financière.
40' Ad Alphabet de la lettre bâtarde, .
5°. Ad Alphabet delà coulée,
iljf Je pourrois même ajouter VAlphabet gothique.
II. La ledure de ce qui eft écrit félon l ’un de
ces Alphabets y n’empêche pas qu’on ne lifé ce
qui eft écrit félon un autre Alphabet. Ainfi, quand
nous aurions encore un nouvel Alphabet & qu’on
appretidroit à Je lire à nos enfants, ils n’en liroient
pas moins les autres livres.
III. Le nouvel Alphabet dont je parle ne dé-
truiroit rien ; il ne faudroit pàs pour cela brûler
tous les livres y comme difent certaines perfonnes ;
le caradère romain fait-il brûler les livres écrits
en italique ou autrement? Ne lit-on plus les livres
imprimés il y a 80 ou 100 ans , parce que l’Orthographe
d’aujourdhui eft différente de celle de
ce temps-là f Et fi l ’on remonte plus haut, on
trouvera des différences bien plus grandes encore,
& qui ne nous empêchent pas de lire les livres
qui ont été imprimés félon l’Orthographe alors en
ufàge.
Enfin cet Alphabet rendroit l’Orthographe plus
facile , la prononciation'plus aifee à apprendre, &
feroit ceffer les plaintes de ceux qui trouvent tant
de contrariétés entre notre prononciation & notre
Orthographe , qui préfénte fouvent aux yeux des
fignes, differents de ceux qu’elle devroit préfénter
félon la première deftination de ces fignes.
On oppofé que les réformateurs de l’Orthographe
n’ont jamais été foivis ; je réponds :
i° . Que cette réforme n’eft pas l ’ouvrage d’un
particulier.
2°. Que le grand nombre de c es réformateurs
fait voir que notre Orthographe a befbin de réforme.
30. Que notre Orthographe s’eft bien réformée
depuis quelques années.
4°. Enfin , c’eft un fimple Alphabet de plus que
je 'voudrois qui fut fait & autorifé par qui il convient
; qu’on apprît à le lire, & qu’il y eût certains
livres écrits fuivant cet Alphabet ; ce qui
11’empêcheroit pas plus de lire les autres livres,
que le caradère italique n’empêche de lire le
romain.
Alphabet y en terme de Polygraphie, ou Stéga-
nographie, c’eft le double du chiffre que garde
chacun des correfpondants qui s’écrivent en caractères
particuliers & lécrets dont ils font convenus.
On écrit en une première colonne VAlphabet ordinaire
, & vis à vis de chaque lettre, on met les
fignes ou caradères fecrets de VAlphabet poly-
graphe , qui répondent à la lettre de VAlphabet
Vulgaire. Il y a encore une troifîème colonne où
iîon met les lettres nulles ou inutiles, qu’on n’a
ajoutées que pour augmenter la difficulté de ceux
entre les mains de qui l’écrit pourroit tomber. Ainfi
1*Alphabet polygraphe eft la clef dont les correspondants
fè férvent pour déchiffrer ce qu’ils s’éçri-
C juïhm, e t L vfvérat, Tome 7,
A M A 14. j
Vent. J 9 cil égaré mon Alphabet yfaifons-en un autre.
L ’art de faire de ces, fortes d’Alphabets
d’apprendre À les-déchiffrer , eft appelé Polygra-
phie & Stéganographie , du grec f£y«vW , caché
venant de <?iya>, tego, je cache. Cet art étoit inconnu
aux anciens ; ils n’avoient que la cytale la conique.
C ’étoient deux cylindres de buis fort égaux;
l ’un étoit entre les mains de l’un des çorrefpon-
dants , & l’autre en celles de l’autre correfpondant.
Celui qui écrivoit. tortilloit fur fon rouleau une
lanière de parchemin , fur laquelle il écrivoit en
long ce qu’il vouloit ; enfùite il l’envoyoit à fb*
correfpondant qui l’appliquoit fur fon cylindre; en
forte que les traits de l ’écriture fè trouvoient dans
la même ficuation en laquelle ils avoient été écrits ;
ce qui pou voit aifément être deviné : les moderne«
ont ufé de plus de raffinements.
On donne auffi le nom d’Alphabet à quelques
livres où certaines matières font écrites félon l.’o_dre
alphabétique. Ad Alphabet de la France eft un livre
de Géographie, ou les villes de France font décrites
par ordre alphabétique. Alphabetum A u -
gufiinianum , eft un livre qui contient l’hifteire des
monaftères des auguftins, par ordre alphabétique*
( M . du. M ars a ï s . .).
ALPHABÉTIQUE , adj. ( Gram. ) , qui efï
félon l’ordre de l’alphabet, table alphabétique. Les
didionnaires font rangés félon l’or.dre alphabétique ,*
mais on a tort de ne pas féparer les mots qui commencent
par i de ceux qui commencent par j ,*
enfbrte qu’on trouve ïàmbe fous la même lettre
que jambe. Il en eft de même des mots qui commencent
par u y ils font confondus avec ceux qui
commencent par v ; en fbrte qu’urbanité fe.trouve
après vrai y &e. Aujourdhui que la diftindion de
ces lettres eft obférvée exadeinent , on devroit y
avoir égard dans l ’arrangement alphabétique de«
mots, (M . du M ars a i s . )
(N.) AMAHIRIQUE. C’eft le nom qu’on donne à
la langue aduelle des abyffins ou éthiopiens , nommée
ainfi de la contrée Amhara ,* elle eft commune
à tout l’Empire , & porte le titre de Langue
royale. Outre cette langue, il y a d’autres dia-
ledes dans les différentes provinces. Voye\, dans
les Mémoires de VAcadémie des Infcriplions,
tome 36 : un Mémoire de M. de Guignes fiir le«
langues orientales. ( L 'E diteur, f
(N.) AM A N T , G A L A N T . Syn. >
Il me fèmble que le mot de Galant, dans le
fons où il eft fynonyme avec Amant, n’eft plus fi
en ufàge qu’il l’étoit autrefois, & que celui-ei s’efi
féul emparé de la place. Je ne doute pas que I4
préférence ne vienne des idées acceffoires qui les
caradérifènt, & qui repréféntent un Amant comm®
quelque chofé de permis & de plus honnete que
n’eft un Galant : car le premier^ parle au coeur $
& ne demande que d’être aimé; le fécond s’a«